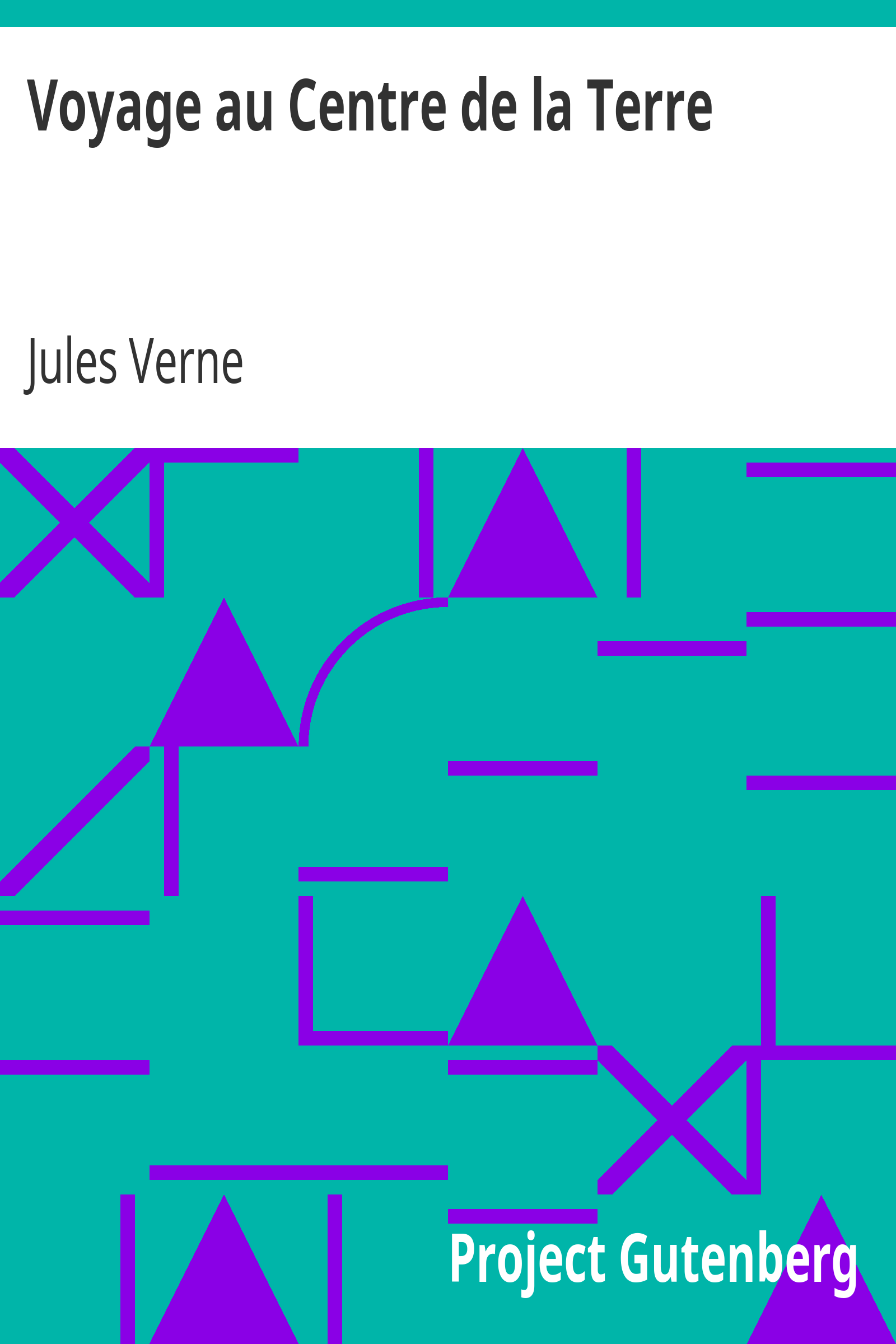Voyage au Centre de la Terre
Play Sample
XVII
Le véritable voyage commençait.Jusqu'alors les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés; maintenant celles-ci allaient véritablement naître sous nos pas.
Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer.Le moment était venu.Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter.Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur.Hans acceptait si tranquillement l'aventure, avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougis à l'idée d'être moins brave que lui.Seul, j'aurais entamé la série des grands argumente; mais, en présence du guide, je me tus; un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie Virlandaise, et je m'approchai de la cheminée centrale.
J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre, ou trois cents pieds de tour.Je me penchai au-dessus d'un roc qui surplombait, et je regardai; mes cheveux se hérissèrent.Le sentiment du vide s'empara de mon être.Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi et le vertige monter à ma tête comme une ivresse.Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme.J'allais tomber.Une main me retint.Celle de Hans.Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la Frelsers-Kirk de Copenhague.
Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation.Ses parois, presque à pic, présentaient cependant de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente; mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut.Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir, mais comment la détacher, lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure?
Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de quatre cents pieds; il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvait se défiler; une fois descendus de deux cents pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en halant sur l'autre. Puis, on recommencerait cet exercice usque ad infinitum
«Maintenant, dit mon oncle après avoir achevé ces préparatifs, occupons-nous des bagages; ils vont être divisés en trois paquets, et chacun de nous en attachera un sur son dos; j'entends parler seulement des objets fragiles.»
L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie.
«Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres; toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes; moi, du reste des vivres et des instruments délicats.
—Mais, dis-je, et les vêtements, et cette masse de cordes et d'échelles, qui se chargera de les descendre?
—Ils descendront tout seuls.
—Comment cela?demandai-je fort étonné.
—Tu vas le voir.»
Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter.Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles, et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre.
J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air.Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un oeil satisfait la descente de ses bagages, et ne se releva qu'après les avoir perdus de vue.
«Bon, fit-il.A nous maintenant.»
Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles!
Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments; Hans prit celui des outils, moi celui des armes.La descente commença dans l'ordre suivant: Hans, mon oncle et moi.Elle se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme.
Je me laissai couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre m'arc-boutant au moyen de mon bâton ferré.Une idée unique me dominait: je craignais que le point d'appui ne vint à manquer.Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes.Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main.
Lorsqu'une de ces marches glissantes venait à s'ébranler sous le pas de Hans, il disait de sa voix tranquille:
—«Gif akt!»
—Attention!» répétait mon oncle.
Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée.
Hans tira la corde par l'un de ses bouts; l'autre s'éleva dans l'air; après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierres et de laves, sorte de pluie, ou mieux, de grêle fort dangereuse.
En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquai que le fond du trou était encore invisible.
La manoeuvre de la corde recommença, et une demi-heure après nous avions gagné une nouvelle profondeur de deux cents pieds.
Je ne sais si le plus enragé géologue eût essayé d'étudier, pendant cette descente, la nature des terrains qui l'environnaient.Pour mon compte, je ne m'en inquiétai guère; qu'ils fussent pliocènes, miocènes, éocènes, crétacés, jurassiques, triasiques, perniens, carbonifères, dévoniens, siluriens ou primitifs, cela me préoccupa peu.Mais le professeur, sans doute, fit ses observations ou prit ses notes, car, à l'une des haltes, il me dit:
«Plus je vais, plus j'ai confiance; la disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy.Nous sommes en plein sol primordial, sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau; je repousse absolument le système d'une chaleur centrale; d'ailleurs, nous verrons bien.»
Toujours la même conclusion.On comprend que je ne m'amusai pas à discuter.Mon silence fut pris pour un assentiment, et la descente recommença.
Au bout de trois heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée.Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement; ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher, l'obscurité se faisait peu à peu.
Cependant nous descendions toujours; il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mate et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme.
Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manoeuvres de corde, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé.
Nous avions alors répété quatorze fois cette manoeuvre qui durait une demi-heure.C'était donc sept heures, plus quatorze quarts d'heure de repos ou trois heures et demie.En tout, dix heures et demie.Nous étions partis à une heure, il devait être onze heures en ce moment.
Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manoeuvres d'une corde de deux cents pieds donnaient deux mille huit cents pieds.
En ce moment la voix de Hans se fit entendre:
—«Halt!» dit-il.
Je m'arrêtai court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle.
«Nous sommes arrivés, dit celui-ci.
—Où?demandai-je en me laissant glisser près de lui.
—Au fond de la cheminée perpendiculaire.
—Il n'y a donc pas d'autre issue?
—Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite.Nous verrons cela demain.Soupons d'abord et nous dormirons après.»
L'obscurité n'était pas encore complète.On ouvrit le sac aux provisions, on mangea et l'on se coucha de son mieux sur un lit de pierres et de débris de lave.
Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds, qui se transformait en une gigantesque lunette.
C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être sigma de la petite Ourse.
Puis je m'endormis d'un profond sommeil.
XVIII
A huit heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller.Les mille facettes de lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillaient comme une pluie d'étincelles.
Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants.
«Eh bien!Axel, qu'en dis-tu?fit mon oncle en se frottant les mains.As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse.Plus de bruit de charrettes, plus de cris de marchands, plus de vociférations de bateliers!
—Sans doute, nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits; mais ce calme même a quelque chose d'effrayant.
—Allons donc, s'écria mon oncle, si tu t'effrayes déjà, que sera-ce plus tard?Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre?
—Que voulez-vous dire?
—Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île!Ce long tube vertical, qui aboutit au cratère du Sneffels, s'arrête à peu près au niveau de la mer.
—En êtes-vous certain?
—Très certain; consulte le baromètre, tu verras!»
En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à vingt-neuf pouces.
«Tu le vois, reprit le professeur, nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère, et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre.»
Cet instrument allait, en effet, nous devenir inutile, du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'Océan.
«Mais, dis-je, n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit fort pénible?
—Non.Nous descendrons lentement, et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée.Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures; nous, nous en aurons trop peut-être.Mais j'aime mieux cela.Ne perdons pas un instant.Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne?
Je me souvins alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir.Mon oncle interrogea Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit:
«Der huppe!»
—Là-haut.»
En effet, ce paquet était accroché à une saillie de roc, à une centaine de pieds au-dessus de notre tête.Aussitôt l'agile Islandais grimpa comme un chat et, en quelques minutes, le paquet nous rejoignit.
«Maintenant, dit mon oncle, déjeunons; mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire.»
Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlée de genièvre.
Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations; il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes:
Lundi 1er juillet.
Chronomètre: 8 h.17 m.du matin.
Baromètre: 29p. 7 l.
Thermomètre: 6°.
Direction: E. -S. -E.
Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut donnée par la boussole.
«Maintenant, Axel, s'écria le professeur d'une voix enthousiaste, nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe.Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence.»
Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Ruhmkorff suspendu a son cou; de l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne, et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie.
Hans portait le second appareil, qui fut également mis en activité.Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables.
«En route!» fit mon oncle.
Chacun reprit son ballot.Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits, et, moi troisième, nous entrâmes dans la galerie.
Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête, et j'aperçus une dernière fois, par le champ de l'immense tube, ce ciel de l'Islande «que je ne devais plus jamais revoir.»
La lave, à la dernière éruption de 1229, s'était frayé un passage à travers ce tunnel.Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant; la lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité.
Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à quarante-cinq degrés environ; heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures, tenaient lieu de marches, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde.
Mais ce qui se faisait marche sous nos pieds devenait stalactites sur les autres parois; la lave, poreuse en de certains endroits, présentait de petites ampoules arrondies; des cristaux de quartz opaque, ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres, semblaient s'allumer à notre passage.On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre.
«C'est magnifique!m'écriai-je involontairement.Quel spectacle, mon oncle!Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradations insensibles?Et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux?
—Ah!tu y viens, Axel!répondit mon oncle.Ah!tu trouves cela splendide, mon garçon!Tu en verras bien d'autres, je l'espère.Marchons!marchons!»
Il aurait dit plus justement «glissons,» car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées.C'était le «facilis descensus Averni», de Virgile.La boussole, que je consultais fréquemment, indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur.Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre.Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite.
Cependant la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible; cela donnait raison aux théories de Davy, et plus d'une fois je consultai le thermomètre avec étonnement.Deux heures après le départ, il ne marquait encore que 10°, c'est-à-dire un accroissement de 4°.Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale.Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile.Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route, mais il gardait pour lui le résultat de ses observations.
Le soir, vers huit heures, il donna le signal d'arrêt.Hans aussitôt s'assit; les lampes furent accrochées à une saillie de lave.Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas.Au contraire.Certains souffles arrivaient jusqu'à nous.Quelle cause les produisait?A quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine?C'est une question que je ne cherchai pas à résoudre en ce moment; la faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner.Une descente de sept heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de forces.J'étais épuisé.Le mot halte me fit donc plaisir à entendre.Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave, et chacun mangea avec appétit.Cependant une chose m'inquiétait; notre réserve d'eau était à demi consommée.Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines, mais jusqu'alors celles-ci manquaient absolument.Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet.
«Cette absence de sources te surprend?dit-il.
—Sans doute, et même elle m'inquiète; nous n'avons plus d'eau que pour cinq jours.
—Sois tranquille, Axel, je te réponds que nous trouverons de l'eau, et plus que nous n'en voudrons.
—Quand cela?
—Quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave.Comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois?
—Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs?Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement?
—Qui te fait supposer cela?
—C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte.
—D'après ton système, répondit mon oncle; et qu'indique le thermomètre?
—Quinze degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de neuf degrés depuis notre départ.
—Eh bien, conclus.
—Voici ma conclusion.D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par cent pieds.Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre.Ainsi, à Yakoust en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par trente-six pieds; cela dépend évidemment de la conductibilité des roches.J'ajouterai aussi que, dans le voisinage d'un volcan éteint, et à travers le gneiss, on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour cent vingt-cinq pieds.Prenons donc cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable, et calculons.
—Calcule, mon garçon.
—Rien n'est plus facile, dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet.Neuf fois cent vingt-cinq pieds donnant onze cent vingt-cinq pieds de profondeur.
—Rien de plus exact.
—Eh bien?
—Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à dix mille pieds au-dessous du niveau de la mer.
—Est-il possible?
—Oui, ou les chiffres ne sont plus les chiffres!»
Les calculs du professeur étaient exacts; nous avions déjà dépassé de six mille pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitz-Bahl dans le Tyrol, et celles de Wuttemberg en Bohème.
La température, qui aurait dû être de quatre-vingt-un degrés en cet endroit, était de quinze à peine.Cela donnait singulièrement à réfléchir.
XIX
Le lendemain, mardi 30 juin, à six heures, la descente fut reprise.
Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons.Ce fut ainsi jusqu'à midi dix-sept minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans, qui venait de s'arrêter.
«Ah!s'écria mon oncle, nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée.»
Je regardai autour de moi; nous étions au centre d'un carrefour, auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites.Laquelle convenait-il de prendre?Il y avait là une difficulté.
Cependant mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi ni devant le guide; il désigna le tunnel de l'est, et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois.
D'ailleurs toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre; il fallait s'en remettre absolument au hasard.
La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale; parfois une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique; les artistes du moyen âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l'ogive pour générateur.Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes.A de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors, et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux.
La chaleur se maintenait à un degré supportable.Involontairement je songeais à son intensité, quand les laves vomies par le Sneffels se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui.Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu!
«Pourvu, pensai-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive!»
Ces réflexions, je ne les communiquai point à l'oncle Lidenbrock; il ne les eût pas comprises.Son unique pensée était d'aller en avant.Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout il valait mieux admirer.
A six heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné deux lieues dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur.
Mon oncle donna le signal du repos.On mangea sans trop causer, et l'on s'endormit sans trop réfléchir.
Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples: une couverture de voyage dans laquelle on se roulait, composait toute la literie.Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune.Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du nouveau monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant les heures du sommeil; mais ici, solitude absolue et sécurité complète.Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre.
On se réveilla le lendemain frais et dispos.La route fut reprise.Nous suivions un chemin de lave comme la veille.Impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait.Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal.Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la terre.Cette disposition devint si manifeste vers dix heures du matin, et par suite si fatigante, que je fus forcé de modérer notre marche.
«Eh bien, Axel?dit impatiemment le professeur.
—Eh bien, je n'en peux plus, répondis-je
—Quoi!après trois heures de promenade sur une route si facile!
—Facile, je ne dis pas non, mais fatigante à coup sûr.
—Comment!quand nous n'avons qu'à descendre!
—A monter, ne vous en déplaise!
—A monter!fit mon oncle en haussant les épaules.
—Sans doute.Depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées, et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la terre d'Islande.»
Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu.J'essayai de reprendre la conversation.Il ne me répondit pas et donna le signal du départ.Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée.
Cependant j'avais repris mon fardeau avec courage, et je suivais rapidement Hans, que précédait mon oncle.Je tenais à ne pas être distancé; ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue.Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe.
D'ailleurs, la route ascendante devenait plus pénible, je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre.C'était un espoir.Chaque pas le confirmait.
À midi un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie.Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles.Au revêtement de lave succédait la roche vive; le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement.Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne[1].
[1] Ainsi nommée parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures.
«C'est évident, m'écriai-je, les sédiments des eaux ont formé, à la seconde époque de la terre, ces schistes, ces calcaires et ces grès!Nous tournons le dos au massif granitique!Nous ressemblons à des gens de Hambourg, qui prendraient le chemin de Hanovre pour aller à Lubeck.»
J'aurais dû garder pour moi mes observations.Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence, et l'oncle Lidenbrock entendit mes exclamations.
«Qu'as-tu donc?dit-il.
—Voyez!répondis-je en lui montrant la succession variée des grès, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés.
—Eh bien?
—Nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux!
—Ah!tu penses?
—Mais regardez, examinez, observez!»
Je forçai le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie.Je m'attendais à quelque exclamation de sa part.Mais, loin de là, il ne dit pas un mot, et continua sa route.
M'avait-il compris ou non?Ne voulait-il pas convenir, par amour-propre d'oncle et de savant, qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'est, ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité?Il était évident que nous avions quitté la route des laves, et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels.
Cependant je me demandai si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains.Ne me trompais-je pas moi-même?Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique?
«Si j'ai raison, pensai-je, je dois trouver quelque débris de plante primitive, et il faudra bien me rendre à l'évidence.Cherchons.»
Je n'avais pas fait cent pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux.Cela devait être, car, à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de quinze cents espèces végétales ou animales.Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquille.Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes; le professeur Lidenbrock ne pouvait s'y tromper; mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable.
C'était de l'entêtement poussé hors de toutes limites.Je n'y tins plus.Je ramassai une coquille parfaitement conservée, qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel; puis je rejoignis mon oncle et je lui dis:
«Voyez!
—Eh bien, répondit-il tranquillement, c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites.Pas autre chose.
—Mais n'en concluez-vous pas?…
—Ce que tu conclus toi-même?Si.Parfaitement.Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves.Il est possible que je me sois trompé; mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie.
—Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverais fort si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant.
—Et lequel?
—Le manque d'eau.
—Eh bien!nous nous rationnerons, Axel.
XX
En effet, il fallut se rationner.Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours.C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper.Et, fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelque source vive dans ces terrains de l'époque de transition.
Pendant toute la journée du lendemain la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux.Nous marchions presque sans mot dire.Le mutisme de Hans nous gagnait.
La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible; parfois même elle semblait s'incliner.Mais cette tendance, peu marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait pas, et la période de transition s'affirmait davantage.
La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois; on aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrains.Des spécimens de marbres magnifiques revêtaient les murailles, les uns, d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres, de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges, plus loin, des échantillons de ces griottes à couleurs sombres, dans lesquels le calcaire se relevait en nuances vives.
La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs; mais, depuis la veille, la création avait fait un progrès évident.Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait; entre autres, des poissons Ganoïdes et ces Sauropteris dans lesquels l'oeil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile.Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelle formation.
Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet.Mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde.
Il attendait deux choses: ou qu'un puits vertical vînt à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente; ou qu'un obstacle l'empêchât de continuer cette route.Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée.
Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençai à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie.
Après dix heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement.Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles, faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat.A un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyai sur sa paroi.
Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire.Je regardai de plus près.Nous étions en pleine houillère.
«Une mine de charbon!m'écriai-je.
—Une mine sans mineurs, répondit mon oncle.
—Eh!qui sait?
—Moi, je sais, répliqua le professeur d'un ton bref, et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes.Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu.L'heure du souper est venue.Soupons.»
Hans, prépara quelques aliments.Je mangeai à peine, et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration.La gourde du guide à demi pleine, voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes.
Après leur repas, mes deux compagnons s'étendirent sur leurs couvertures et trouvèrent dans le sommeil un remède à leurs fatigues.Pour moi, je ne pus dormir, et je comptai les heures jusqu'au matin.
Le samedi, à six heures, on repartit.Vingt minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation; je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère; les voûtes en eussent été étançonnées, et véritablement elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre.
Cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de hauteur.Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine.Le massif terrestre, cédant à quelque puissante poussée, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois.
Toute l'histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses.Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compacts, et comme écrasés par les couches supérieures.
À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante.Une atmosphère de vapeurs enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil.
De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau; peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant.Les «climats» n'existaient pas encore, et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'Equateur et aux pôles.D'où venait-elle?De l'intérieur du globe.
En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde; son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre; les plantes, privées des bienfaisantes effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours.
Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophylites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers.
Or c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine.L'écorce élastique du globe obéissait aux mouvements de la masse liquide qu'elle recouvrait.De là des fissures, des affaissements nombreux; les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables.
Alors intervint l'action de la chimie naturelle, au fond des mers, les masses végétales se firent tourbe d'abord; puis, grâce à l'influence des gaz, et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète.
Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon que la consommation de tous les peuples, pendant de longs siècles encore, ne parviendra pas à épuiser.
Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre.Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert.L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables.A quoi bon, d'ailleurs, quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées?Aussi, telles je voyais ces couches intactes, telles elles seraient encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde.
Cependant nous marchions, et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques.La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes.Seulement, mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbure d'hydrogène.Je reconnus immédiatement, dans cette galerie, la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou, et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes.
Heureusement nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Ruhmkorff.Si, par malheur, nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main, une explosion terrible eût fini le voyage en supprimant les voyageurs.
Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir.Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route.Les ténèbres, toujours profondes à vingt pas, empêchaient d'estimer la longueur de la galerie, et je commençai à la croire interminable, quand soudain, à six heures, un mur se présenta inopinément à nous.À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage.Nous étions arrivés au fond d'une impasse.
«Eh bien!tant mieux!s'écria mon oncle, je sais au moins à quoi m'en tenir.Nous ne sommes pas sur la route de Saknussemm, et il ne reste plus qu'à revenir en arrière.Prenons une nuit de repos, et avant trois jours nous aurons regagné le point où les deux galeries se bifurquent.
—Oui, dis-je, si nous en avons la force!
—Et pourquoi non?
—Parce que, demain, l'eau manquera tout à fait.
—Et le courage manquera-t-il aussi?fit le professeur en me regardant d'un oeil sévère.»
Je n'osai lui répondre.
XXI
Le lendemain le départ eut lieu de grand matin.Il fallait se hâter.Nous étions à cinq jours de marche du carrefour.
Je ne m'appesantirai pas sur les souffrances de notre retour.Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort; Hans avec la résignation de sa nature pacifique; moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant; je ne pouvais avoir de coeur contre cette mauvaise fortune.
Ainsi que je l'avais prévu, l'eau fit tout à fait défaut à fa fin du premier jour de marche; notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre; mais cette infernale liqueur brûlait le gosier, et je ne pouvais même en supporter la vue.Je trouvais la température étouffante; la fatigue me paralysait.Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement.On faisait halte alors; mon oncle ou l'Islandais me réconfortaient de leur mieux.Mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau.
Enfin, le mardi, 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi morts au point de jonction des deux galeries.Là je demeurai comme une masse inerte, étendu sur le sol de lave.Il était dix heures du matin.
Hans et mon oncle, accotés à la paroi, essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuit.De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées.Je tombai dans un profond assoupissement.
Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras:
«Pauvre enfant!» murmura-t-il avec un véritable accent de pitié.
Je fus touché de ces paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur.Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes.Il se laissa faire en me regardant.Ses yeux étaient humides.
Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté.A ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres:
«Bois,» fit-il.
Avais-je bien entendu?Mon oncle était-il fou?Je le regardais d'un air hébété.Je ne voulais pas le comprendre.
«Bois,» reprit-il.
Et relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres.
Oh!jouissance infinie!une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait.
Je remerciai mon oncle en joignant les mains.
«Oui, fit-il, une gorgée d'eau!la dernière!entends-tu bien?la dernière!Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde.Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire!Mais non, Axel, je la réservais pour toi.
—Mon oncle!murmurai-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux.
—Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi mort, et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer.
—Merci!merci!» m'écriai-je.
Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelque force.Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient; l'inflammation de mes lèvres s'était adoucie.Je pouvais parler.
«Voyons, dis-je, nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre; l'eau nous manque; il faut revenir sur nos pas.»
Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder; il baissait la tête; ses yeux fuyaient les miens.
«Il faut revenir, m'écriai-je, et reprendre le chemin du Sneffels.Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère!
Revenir!fit mon oncle, comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même.
—Oui, revenir, et sans perdre un instant.»
Il y eut un moment de silence assez long.
«Ainsi donc, Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre, ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie?
—Le courage!
—Je te vois abattu comme avant, et faisant encore entendre des paroles de désespoir!»
A quel homme avais-je affaire et quels projets son esprit audacieux formait-il encore?
«Quoi vous ne voulez pas?…
—Renoncer à cette expédition, au moment où tout annonce qu'elle peut réussir!Jamais!
—Alors il faut se résigner à périr?
—Non, Axel, non!pars.Je ne veux pas ta mort!Que Hans t'accompagne.Laisse-moi seul!
—Vous abandonner!
—Laisse-moi, te dis-je!J'ai commencé ce voyage; je l'accomplirai jusqu'au bout, ou je n'en reviendrai pas.Va-t'en, Axel, va-t'en!»
Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation.Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure et menaçante.Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible!Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme, et, d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir.
Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée.Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons; nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre; mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu, prêt à partir si l'on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître.
Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui!Mes paroles, mes gémissements, mon accent, auraient eu raison de cette froide nature.Ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt.A nous deux nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur.Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Sneffels!
Je m'approchai de Hans.Je mis ma main sur la sienne, il ne bougea pas.Je lui montrai la route du cratère.Il demeura immobile.Ma figure haletante disait toutes mes souffrances.L'Islandais remua doucement la tête, et désignant tranquillement mon oncle:
«Master», fit-il.
—Le maître, m'écriai-je!insensé!non, il n'est pas le maître de ta vie!il faut fuir!il faut l'entraîner!m'entends-tu!me comprends-tu?»
J'avais saisi Hans par le bras.Je voulais l'obliger à se lever.
Je luttais avec lui. Mon oncle intervint.
«Du calme, Axel, dit-il.Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur.Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer.»
Je me croisai les bras, en regardant mon oncle bien en face.
«Le manque d'eau, dit-il, met seul obstacle à l'accomplissement de mes projets.Dans cette galerie de l'est, faite de laves, de schistes, de houilles, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide.Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'ouest.»
Je secouai la tête avec un air de profonde incrédulité.
«Écoute-moi jusqu'au bout, reprit le professeur en forçant la voix.Pendant-que tu gisais, là sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie.Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe, et, en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique.Là nous devons rencontrer des sources abondantes.La nature de la roche le veut ainsi, et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction.Or, voici ce que j'ai à te proposer.Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres nouvelles, ses équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande, et il a découvert le nouveau monde.Moi, le Colomb de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore.Si, ce temps écoulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre.»
En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage.
«Eh bien!m'écriai-je, qu'il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine.Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort!En route!»
XXII
La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie.Hans marchait en avant, selon son habitude.Nous n'avions pas fait cent pas, que le professeur, promenait sa lampe le long des murailles, s'écriait:
«Voilà les terrains primitifs!nous sommes dans la bonne voie!marchons!marchons!
Lorsque la terre se refroidit peu à peu aux premiers jours du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles.Le couloir actuel était une fissure de ce genre, par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif; ses mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial.
A mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté.La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale, et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes, les schistes, les gneiss, les micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit.
Or, jamais minéralogistes ne s'étaient rencontrés dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place.Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains.
A travers l'étage des schistes colorés de belles nuances vertes serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platine et d'or.Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance!Ces trésors, les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs, que ni la pioche, ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau.
Aux schistes succédèrent les gneiss, d'une structure stratiforme, remarquables par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis, les micaschistes disposés en grandes lamelles rehaussées à l'oeil par les scintillations du mica blanc.
La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles, et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements.
Vers six heures du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser; les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre; le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz, pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les quatre étages de terrain du globe.Nous étions murés dans l'immense prison de granit.
Il était huit heures du soir.L'eau manquait toujours.Je souffrais horriblement.Mon oncle marchait en avant.Il ne voulait pas s'arrêter.Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelque source.Mais rien.
Cependant mes jambes refusaient de me porter.Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte.C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint.
Enfin mes forces m'abandonnèrent; je poussai un cri et je tombai.
«A moi!je meurs!»
Mon oncle revint sur ses pas.Il me considéra en croisant ses bras; puis ces paroles sourdes sortirent de ses lèvres:
«Tout est fini!»
Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai les yeux.
—Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes deux compagnons immobiles et roulés dans leur couverture.Dormaient-ils?Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil.Je souffrais trop, et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède.Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille.
«Tout était fini!» car dans un pareil état de faiblesse il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe.
Il y avait une lieue et demie d'écorce terrestre!Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules.Je me sentais écrasé et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit.
Quelques heures se passèrent.Un silence profond régnait autour de nous, un silence de tombeau.Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait cinq milles d'épaisseur.
Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit; l'obscurité se faisait dans le tunnel.Je regardai plus attentivement, et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main.
Pourquoi ce départ?Hans nous abandonnait-il?Mon oncle dormait.Je voulus crier.Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées.L'obscurité était devenue profonde, et les derniers bruits venaient de s'éteindre.
«Hans nous abandonne!m'écriai-je.Hans!Hans!»
Ces mots, je les criais en moi-même.Ils n'allaient pas plus loin.Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect.Son départ ne pouvait être une fuite.Au lieu de remonter la galerie, il la descendait.De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas.Ce raisonnement me calma un peu, et je revins à un autre d'ordre d'idées.Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos.Allait-il donc à la découverte?Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelque murmure dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi?
XXIII
Pendant une heure j'imaginai dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur.Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête.Je crus que j'allais devenir fou!
Mais enfin un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre.Hans remontait.La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir.Hans parut.
Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement.Mon oncle se leva.
«Qu'est-ce donc?fit-il.
—«Vatten,» répondit le chasseur.
Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte.Je ne savais pas un seul mot de danois, et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide.
«De l'eau!de l'eau!m'écriai-je on battant des mains, en gesticulant comme un insensé.
—De l'eau!répétait mon oncle.«Hvar?» demanda-t-il à l'Islandais.
—«Nedat,» répondit Hans.
Où?En bas!Je comprenais tout.J'avais saisi les mains du chasseur, et je les pressais, tandis qu'il me regardait avec calme.
Les préparatifs du départ ne furent pas longs, et bientôt nous descendions un couloir dont la pente atteignait deux pieds par toise.
Une heure plus tard, nous avions fait mille toises environ et descendu deux mille pieds.
En ce moment, nous entendions distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné.Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre; mais alors mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient.
«Hans ne s'est pas trompé,» dit-il, ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent.
—Un torrent?m'écriai-je.
—Il n'y a pas à en douter.Un fleuve souterrain circule autour de nous!»
Nous hâtâmes le pas, surexcités par l'espérance.Je ne sentais plus ma fatigue.Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà; le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissant et bondissant.Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité.Mais en vain.
Une demi-heure s'écoula encore.Une demi-lieue fut encore franchie.
Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà.Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il «sentit» ce torrent à travers le roc, mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide: il ne s'y était pas désaltéré.
Bientôt même il fut constant que, si notre marche continuait, nous nous éloignerions du torrent dont le murmure tendait à diminuer.
On rebroussa chemin.Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché.
Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à deux pieds de moi avec une violence extrême.Mais un mur de granit nous en séparait encore.
Sans réfléchir, sans me demander si quelque moyen n'existait pas de se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier moment de désespoir.
Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres.
Il se leva et prit la lampe.Je le suivis.Il se dirigea vers la muraille.Je le regardai faire.Il colla son oreille sur la pierre sèche, et la promena lentement en écoutant avec le plus grand soin.Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment.Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à trois pieds au-dessus du sol.
Combien j'étais ému!Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur!Mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir, et le presser de mes caresses, quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même.
«Sauvés!m'écriai-je, sauvés!
—Oui, répétait mon oncle avec frénésie, Hans a raison!Ah!le brave chasseur!Nous n'aurions pas trouvé cela!»
Je le crois bien!Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit.Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe.Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait!Et si le torrent, se faisant jour à travers le roc, allait nous envahir!Ces dangers n'avaient rien de chimérique; mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter, et notre soif était si intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'Océan.
Hans se mit à ce travail, que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli.L'impatience emportant notre main, la roche eût volé en éclats sous ses coups précipités.Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large d'un demi-pied.J'entendais le bruit du torrent s'accroître, et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres.
Bientôt le pic s'enfonça de deux pieds dans la muraille de granit; le travail durait depuis plus d'une heure; je me tordais d'impatience!Mon oncle voulait employer les grands moyens.J'eus de la peine à l'arrêter, et déjà il saisissait son pic, quand soudain un sifflement se fit entendre.Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée.
Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur.Je compris pourquoi lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation: la source était bouillante.
«De l'eau à cent degrés!m'écriai-je.
—Eh bien, elle refroidira,» répondit mon oncle.
Le couloir s'emplissait de vapeurs, tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines; bientôt après, nous y puisions notre première gorgée.
Ah!quelle jouissance!quelle incomparable volupté!Qu'était cette eau?D'où venait-elle?Peu importait.C'était de l'eau, et, quoique chaude encore, elle ramenait au coeur la vie prête à s'échapper.Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même.
Ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriai:
«Eh!mais c'est de l'eau ferrugineuse!
—Excellente pour l'estomac, répliqua mon oncle, et d'une haute minéralisation!Voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Toeplitz!
—Ah!que c'est bon!
—Je le crois bien, une eau puisée à deux lieues sous terre; elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable.Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là!Aussi je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire.
—Bien!» m'écriai-je.
Et le nom de «Hans-bach» fut aussitôt adopté.Hans n'en fut pas plus fier.Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé.
«Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau.
—A quoi bon?répondit mon oncle, je soupçonne la source d'être intarissable.
—Qu'importe!remplissons l'outre et les gourdes, puis nous essayerons de boucher l'ouverture.»
Mon conseil fut suivi.Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupe, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi.Ce ne fut pas chose facile.On se brûlait les mains sans y parvenir; la pression était trop considérable, et nos efforts demeurèrent infructueux.
«Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur, à en juger par la force du jet.
—Cela n'est pas douteux, répliqua mon oncle, il y a là mille atmosphères de pression, si cette colonne d'eau a trente-deux mille pieds de hauteur.Mais il me vient une idée.
—Laquelle?
—Pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture?
-Mais, parce que…»
J'aurais été embarrassé de trouver une bonne raison.
«Quand nos gourdes seront vides, sommes-nous assurés de trouver à les remplir?
—Non, évidemment.
—Eh bien, laissons couler cette eau: elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route!
—Voilà qui est bien imaginé!m'écriai-je, et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir, dans nos projets.
—Ah!tu y viens, mon garçon, dit le professeur en riant.
—Je fais mieux que d'y venir, j'y suis.
—Un instant!Commençons par prendre quelques heures de repos.»
J'oubliais vraiment qu'il fit nuit.Le chronomètre se chargea de me l'apprendre.Bientôt chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil.
XXIV
Le lendemain nous avions déjà oublié nos douleurs passées.Je m'étonnai tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandai la raison.Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre.
On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse.Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin.Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas, avec un guide industrieux comme Hans, et un neveu «déterminé» comme moi?Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau!On m'eût proposé de remonter à la cime du Sneffels que j'aurais refusé avec indignation.
Mais il n'était heureusement question que de descendre.
«Partons!» m'écriai-je en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe.
La marche fut reprise le jeudi à huit heures du matin.Le couloir de granit, se contournant en sinueux détours, présentait des coudes inattendus, et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe; mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est.Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole, pour se rendre compte du chemin parcouru.
La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec deux pouces de pente par toise, tout au plus.Le ruisseau courait sans précipitation en murmurant sous nos pieds.Je le comparais à quelque génie familier qui nous guidait à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les chants accompagnaient nos pas.Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique.
Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route, lui, «l'homme des verticales».Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rayon terrestre, suivant son expression, il s'en allait par l'hypothénuse.Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre.
D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient; la naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle.
En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal, et relativement peu de chemin vertical.
Le vendredi soir, 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à trente lieues au sud-est de Reykjawik et à une profondeur de deux lieues et demie.
Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant.Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ses pentes.
«Voilà qui nous mènera loin, s'écria-t-il, et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier!»
Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident.La descente commença.Je n'ose l'appeler périlleuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice.
Ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif, du genre de celles qu'on appelle «faille»; la contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite.Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celles-ci n'y laissèrent aucune trace.Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes.
De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité.On s'asseyait alors sur quelque saillie, les jambes pendantes, on causait en mangeant, et l'on se désaltérait au ruisseau.
Il va sans dire que, dans cette faille, le Hans-bach s'était fait cascade au détriment de son volume; mais il suffisait et au delà à étancher notre soif; d'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible.En ce moment il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que, par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais.
Le 6 et le 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de deux lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de cinq lieues au-dessous du niveau de la mer.Mais, le 8, vers midi, la faille prit, dans la direction du sud-est, une inclinaison beaucoup plus douce, environ quarante-cinq degrés.
Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie.Il était difficile qu'il en fût autrement.Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage.
Enfin, le mercredi 15, nous étions à sept lieues sous terre et à cinquante lieues environ du Sneffels.Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santés se maintenaient dans un état rassurant, et la pharmacie de voyage était encore intacte.
Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celles-là même qu'il a publiées dans le récit scientifique de son voyage.Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation.Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de cinquante lieues, je ne pus retenir une exclamation.
«Qu'as-tu donc?demanda-t-il.
—Rien, seulement je fais une réflexion.
—Laquelle, mon garçon?
—C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande.
—Crois-tu?
—Il est facile de nous en assurer.»
Je pris mes mesures au compas sur la carte.
«Je ne me trompais pas, dis-je; nous avons dépassé le cap Portland, et ces cinquante lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer.
—Sous la pleine mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains.
—Ainsi, m'écriai-je, l'Océan s'étend au-dessus de notre tête!
—Bah!Axel, rien de plus naturel!N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sous les flots?»
Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple; mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper.Et cependant, que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête, ou les flots de l'Atlantique, cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide.Du reste, je m'habituai promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est, et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs.
Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste; mon oncle remit à Hans ses trois rixdales hebdomadaires, et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos.
XXV
Je me réveillai donc, le dimanche matin, sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat.Et, quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable.D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes.Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité.En notre qualité de fossiles, nous faisions fi de ces inutiles merveilles.
La grotte formait une vaste salle; sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle.A une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté.
Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes.
«D'abord, dit-il, je vais faire des calculs, afin de relever exactement notre situation; je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre, voyage, une sorte de section verticale du globe, qui donnera le profil de l'expédition.
—Ce sera fort curieux, mon oncle; mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision?
—Oui.J'ai noté avec soin les angles et les pentes; je suis sûr de ne point me tromper.Voyons d'abord où nous sommes.Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique.
Je regardai l'instrument, et, après un examen attentif, je répondis:
«Est-quart-sud-est.
—Bien!fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides.J'en conclus que nous avons fait quatre-vingt-cinq lieues depuis notre point de départ.
—Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique?
—Parfaitement.
—Et, dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être, et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan?
—-Cela se peut.
—-Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison?
—-Sois tranquille, Axel, elles ne parviendront pas à l'ébranler.Mais revenons à nos calculs.Nous sommes dans le sud-est, à quatre-vingt-cinq lieues de la base du Sneffels, et, d'après mes notes précédentes, j'estime à seize lieues la profondeur atteinte.
—Seize lieues!m'écriai-je.
—Sans doute.
—Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre.
—Je ne dis pas non.
—Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de quinze cents degrés devrait exister.
—Devrait, mon garçon.
—Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion.
—Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories.
—Je suis forcé d'en convenir, mais enfin cela m'étonne.
—Qu'indique le thermomètre?
—Vingt-sept degrés six dixièmes.
—Il s'en manque donc de quatorze cent soixante-quatorze degrés quatre dixièmes que les savants n'aient raison.Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur.Donc, Humphry Davy ne se trompait pas.Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter, Qu'as-tu à répondre?
—Rien.»
À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire.Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon, je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentisse point les effets.J'aimais mieux admettre, en vérité, que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois.
Mais, sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornai à prendre la situation telle qu'elle était.
«Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse.
—-Va, mon garçon, à ton aise.
—Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de quinze cent quatre-vingt-trois lieues à peu près?
—-Quinze cent quatre-vingt-trois lieues et un tiers.
—-Mettons seize cents lieues en chiffres ronds.Sur un voyage de seize cents lieues, nous en avons fait douze?
—-Comme tu dis.
—-Et cela au prix de quatre-vingt-cinq lieues de diagonale?
—-Parfaitement.
—En vingt jours environ?
—En vingt jours.
—Or seize lieues font le centième du rayon terrestre.A continuer ainsi, nous mettrons donc deux mille jours, ou près de cinq ans et demi à descendre!»
Le professeur ne répondit pas.
«Sans compter que, si une verticale de seize lieues s'achète par une horizontale de quatre-vingts, cela fera huit mille lieues dans le sud-est, et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre!
—Au diable tes calculs!répliqua mon oncle avec un mouvement de colère.Au diable tes hypothèses!Sur quoi reposent-elles?Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but?D'ailleurs j'ai pour moi un précédent, ce que je fais là un autre l'a fait, et où il a réussi je réussirai à mon tour.
—Je l'espère; mais, enfin, il m'est bien permis…
—Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte.»
Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle, et je me tins pour averti.
«Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre.Qu'indique-t-il?
—-Une pression considérable.
—-Bien.Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement.
—-Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreilles.
—-Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons.
—-Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle.Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense.Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage?
—-Sans doute; un sourd finirait par y entendre à merveille.
—Mais cette densité augmentera sans aucun doute?
—-Oui, suivant une loi assez peu déterminée; il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons.Tu sais que c'est à la surface même de la terre que son action se fait le plus vivement sentir, et qu'au centre du globe les objets ne pèsent plus.
—-Je le sais; mais dites-moi, cet air ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau?
—-Sans doute, sous une pression de sept cent dix atmosphères.
—-Et plus bas?
—Plus bas, cette densité s'accroîtra encore.
—-Comment descendrons-nous alors?
—Eh bien nous mettrons des cailloux dans nos poches.
—Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout.»
Je n'osai pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur.
Il était évident, cependant, que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter, en dépit de tous les raisonnements du monde.
Mais je ne fis pas valoir cet argument.Mon oncle m'aurait encore riposté par son éternel Saknussemm, précédent sans valeur, car, en tenant pour avéré le voyage du savant Islandais, il y avait une chose bien simple à répondre:
Au seizième siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés; comment donc Saknussemm avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe?
Mais je gardai cette objection pour moi, et j'attendis les événements.
Le reste de la journée se passa en calculs et en conversation.Je fus toujours de l'avis du professeur Lidenbrock, et j'enviai la parfaite indifférence de Hans, qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément où le menait la destinée.
XXVI
Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre.Si la moyenne des «difficultés» ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but.Et quelle gloire alors!J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lidenbrock.Sérieusement.Cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais?Peut-être.
Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne; par certaines journées, on gagnait une lieue et demie à deux lieues vers le centre.Descentes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles.Cet impassible Islandais se dévouait avec un incompréhensible sans-façon, et, grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls.
Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour.Je crois même qu'il nous gagnait.Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau.Qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots.Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes.
Pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté.Je ne retrouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité.Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail.
Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de trente lieues; c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête trente lieues de rocs, d'océan, de continents et de villes.Nous devions être alors à deux cents lieues de l'Islande.
Ce jour-là le tunnel suivait un plan peu incliné.
Je marchais en avant; mon oncle portait l'un des deux appareils de Ruhmkorff, et moi l'autre.J'examinais les couches de granit.
Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul.
«Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route.Allons, il faut les rejoindre.Heureusement le chemin ne monte pas sensiblement.»
Je revins sur mes pas.Je marchai pendant un quart d'heure.Je regardai.Personne.J'appelai.Point de réponse.Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain.
Je commençai à me sentir inquiet.Un frisson me parcourut tout le corps.
«Un peu de calme, dis-je à haute voix.Je suis sûr de retrouver mes compagnons.Il n'y a pas deux routes!Or, j'étais en avant, retournons en arrière.»
Je remontai pendant une demi-heure.J'écoutai si quelque appel ne m'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin.Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie.
Je m'arrêtai.Je ne pouvais croire à mon isolement.Je voulais bien être égaré, non perdu.Égaré, on se retrouve.
«Voyons, répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre.Il suffira de remonter encore.A moins que, ne me voyant pas, et oubliant que je les devançais, ils n'aient eu la pensée de revenir en arrière.Eh bien!même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai.C'est évident!»
Je répétai ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu.D'ailleurs, pour associer ces idées si simples, et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long.
Un doute me prit alors.Étais-je bien en avant?Certes.Hans me suivait, précédant mon oncle.Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule.Ce détail me revenait à l'esprit.C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route.
«D'ailleurs, pensai-je» j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe, et qui ne saurait casser, mon fidèle ruisseau.Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons.»
Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant.
Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle, lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit!Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltéré pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre.
Avant de remonter, je pensai qu'une ablution me ferait quelque bien.
Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du
Hans-bach!
Que l'on juge de ma stupéfaction!
Je foulais un granit sec et raboteux!Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds!
XXVII
Je ne puis peindre mon désespoir; nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments.J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif.
Machinalement je promenai mes mains brûlantes sur le sol.Que ce roc me sembla desséché!
Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau?Car, enfin, il n'était plus là!Je compris alors la raison de ce silence étrange, quand j'écoutai pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille.Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau.Il est évident qu'à ce moment, une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hans-bach obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues!
Comment revenir.De traces, il n'y en avait pas.Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit.Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème.Ma situation se résumait en un seul mot: perdu!
Oui!perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable!Ces trente lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable!Je me sentais écrasé.
J'essayai de ramener mes idées aux choses de la terre.C'est à peine si je pus y parvenir.Hambourg, la maison de König-strasse, ma pauvre Graüben, tout ce monde sous lequel je m'égarais, passa rapidement devant mon souvenir effaré.Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M.Fridriksson, le Sneffels!Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance ce serait signe de folie, et qu'il valait mieux désespérer!
En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête?Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons?
«Oh!mon oncle!» m'écriai-je avec l'accent du désespoir.
Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour.
Quand je me vis ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeai aux secours du ciel.Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connue qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire.Je recourus à la prière, quelque peu de droits que j'eusse d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, et je l'implorai avec ferveur.
Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence.
J'avais pour trois jours de vivres, et ma gourde était pleine.Cependant je ne pouvais rester seul plus longtemps.Mais fallait-il monter ou descendre?
Monter évidemment!monter toujours!
Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation.Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels.
Comment n'y avais-je pas songé plus tôt!Il y avait évidemment là une chance de salut.Le plus pressé était donc de retrouver, le cours du Hans-bach.
Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie.La pente en était assez raide.Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas de choix du chemin à suivre.
Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas.J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des anfractuosités.Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit, et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation.Elle était sans issue.Je me heurtai contre un mur impénétrable, et je tombai sur le roc.
De quelle épouvante?de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire.Je demeurai anéanti.Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit.
Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible.Il fallait mourir de la plus effroyable des morts!Et, chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à trente lieues dans les entrailles de terre soulèverait de graves questions scientifiques!
Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées.Je haletais.
Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit.Ma lampe s'était faussée en tombant.Je n'avais aucun moyen de la réparer.Sa lumière pâlissait et allait me manquer!
Je regardai le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil.Une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries.Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive!A chaque instant il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que «le noir» m'envahissait.
Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe.Je la suivis, je l'aspirai du regard, je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fût donné d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses.
Quel cri terrible m'échappa!Sur terre au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits; elle est diffuse, elle est subtile; mais, si peu qu'il en reste, la rétine de l'oeil finit par la percevoir!Ici, rien.L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot.
Alors ma tête se perdit.Je me relevai, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux; je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage, et attendant toujours que quelque muraille imprévue vint offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser!
Où me conduisit cette course insensée?Je l'ignorerai toujours.Après plusieurs heures, sans doute à bout de forces, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence!
XXVIII
Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes.Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire.Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps.Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet!
Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang.Je m'en sentais inondé!Ah!combien je regrettai de n'être pas mort «et que ce fût encore à faire!» Je ne voulais plus penser.Je chassai toute idée et, vaincu par la douleur, je me roulai près de la paroi opposée.
Déjà je sentais l'évanouissement me reprendre, et, avec lui, l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint frapper mon oreille.Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre, et j'entendis les ondes sonores se perdre peu a peu dans les lointaines profondeurs du gouffre.
D'où provenait ce bruit?de quelque phénomène sans doute, qui s'accomplissait au sein du massif terrestre.L'explosion d'un gaz, ou la chute de quelque puissante assise du globe.
J'écoutai encore.Je voulus savoir si ce bruit se renouvellerait.Un quart d'heure se passa.Le silence régnait dans la galerie.Je n'entendais même plus les battements de mon coeur.
Tout à coup mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines.Je tressaillis.
«C'est une hallucination!» pensais-je.
Mais non.En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix.Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas.Cependant on parlait.J'en étais certain.
J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho.Peut-être avais-je crié à mon insu?Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi.
«Oui, certes, on parle!on parle!»
En me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement.Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles.Ils m'arrivaient comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées, pour ainsi dire.Le mot «förlorad» était plusieurs fois répété, et avec un accent de douleur.
Que signifiait-il?Qui le prononçait?Mon oncle ou Hans, évidemment.Mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre.
«A moi!criai-je de toutes mes forces, à moi!»
J'écoutai, j'épiai dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir.Rien ne se fit entendre.Quelques minutes se passèrent.Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit.Je pensai que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons.
«Car ce sont eux, répétai-je.Quels autres hommes seraient enfouis à trente lieues sous terre?»
Je me remis à écouter.En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité.Le mot «förlorad» revînt encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur.
«Non, dis-je, non.Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre.La paroi est faite de granit; elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser!Ce bruit arrive par la galerie même!Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier!»
J'écoutai de nouveau, et cette fois, oui!cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace!
C'était mon oncle qui le prononçait?Il causait avec le guide, et le mot «förlorad» était un mot danois!
Alors je compris tout.Pour me faire entendre il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil de fer conduit l'électricité.
Mais je n'avais pas de temps à perdre.Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit.Je m'approchai donc de la muraille, et je prononçai ces mots, aussi distinctement que possible:
«Mon oncle Lidenbrock!»
J'attendis dans la plus vive anxiété.Le son n'a pas une rapidité extrême.La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse; elle n'augmente que son intensité.Quelques secondes, des siècles, se passèrent, et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille.
«Axel, Axel!est-ce toi?»
………………………..
«Oui!oui!» répondis-je!»
………………………..
«Mon pauvre enfant, où es-tu?»
………………………..
«Perdu dans la plus profonde obscurité!»
………………………..
«Mais ta lampe?»
………………………..
«Éteinte.»
………………………..
«Et le ruisseau?»
………………………..
«Disparu.»
………………………..
«Axel, mon pauvre Axel, reprends courage!»
………………………..
«Attendez un peu, je suis épuisé; je n'ai plus la force de répondre.Mais parlez-moi!»
………………………..
«Courage, reprit mon oncle; ne parle-pas, écoute-moi.Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie.Impossible de te trouver.Ah!je t'ai bien pleuré, mon enfant!Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hans-bach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil.Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique!nos mains ne peuvent se toucher!Mais ne te désespère pas, Axel!C'est déjà quelque chose de s'entendre!»
………………………..
Pendant ce temps j'avais réfléchi.Un certain espoir, vague encore, me revenait au coeur.Tout d'abord, une chose m'importait à connaître.J'approchai donc mes lèvres de la muraille, et je dis:
«Mon oncle?»
………………………..
«Mon enfant?» me fut-il répondu après quelques instants.
………………………..
«Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare.»
………………………..
«Cela est facile.»
………………………..
«Vous avez votre chronomètre?»
………………………..
«Oui.»
………………………..
«Eh bien, prenez-le.Prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez.Je le répéterai, et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse.»
………………………..
«Bien, et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi.»
………………………..
«C'est cela, mon oncle»
………………………..
«Es-tu prêt?»
………………………..
«Oui.»
………………………..
«Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom.»
………………………..
J'appliquai mon oreille sur la paroi, et dès que le mot «Axel» me parvint, je répondis immédiatement «Axel,» puis j'attendis.
………………………..
«Quarante secondes,» dit alors mon oncle; il s'est écoulé quarante secondes entre les deux mots; le son met donc vingt secondes à monter.Or, à mille vingt pieds par seconde, cela fait vingt mille quatre cents pieds, ou une lieue et demie et un huitième.»
………………………..
«Une lieue et demie!» murmurai-je.
………………………..
«Eh bien, cela se franchit, Axel!»
………………………..
«Mais faut-il monter ou descendre?»
………………………..
«Descendre, et voici pourquoi.Nous sommes arrivés à un vaste espace, auquel aboutissent un grand nombre de galeries.Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes ces fentes, ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons.Relève-toi donc et reprends ta route; marche, traîne-toi, s'il le faut, glisse sur les pentes rapides, et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin.En route, mon enfant, en route!»
………………………..
Ces paroles me ranimèrent.
«Adieu, mon oncle, m'écriai-je; je pars.Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles, du moment que j'aurai quitté cette place!Adieu donc!»
………………………..
«Au revoir, Axel!au revoir!»
………………………..
Telles furent les dernières paroles que j'entendis.Cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre, échangée à plus d'une lieue de distance, se termina sur ces paroles d'espoir!Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir.
Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques; il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche; il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires.Je me souvins qu'en maint endroit ce phénomène fut observé, entre autres, dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres, et surtout au milieu de curieuses cavernes de Sicile, ces latomies situées près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'Oreille de Denys.
Ces souvenirs me revinrent à l'esprit, et je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous.En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas en route.
Je me levai donc.Je me traînai plutôt que je ne marchai.La pente était assez rapide; je me laissai glisser.
Bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion, et menaçait de ressembler à une chute.Je n'avais plus la force de m'arrêter.
Tout à coup le terrain manqua sous mes pieds.Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits; ma tête porta sur un roc aigu, et je perdis connaissance.
XXIX
Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendu sur d'épaisses couvertures.Mon oncle veillait, épiant sur mon visage un reste d'existence.A mon premier soupir il me prit la main; à mon premier regard il poussa un cri de joie.
«Il vit!il vit!s'écria-t-il.
—Oui, répondis-je d'une voix faible.
—Mon enfant, fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine, te voilà sauvé!»
Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles, et plus encore des soins qui les accompagnèrent.Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement.
En ce moment Hans arriva.Il vit ma main dans celle de mon oncle; j'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement.
«God dag,» dit-il.
—Bonjour, Hans, bonjour, murmurai-je.Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment?
—Demain, Axel, demain; aujourd'hui tu es encore trop faible; j'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas déranger; dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout.
—-Mais au moins, repris-je, quelle heure, quel jour est-il?
—-Onze heures du soir; c'est aujourd'hui dimanche, 9 août, et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois.»
En vérité, j'étais bien faible; mes yeux se fermèrent involontairement.Il me fallait une nuit de repos; je me laissai donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours.
Le lendemain, à mon réveil, je regardai autour de moi.Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin.Il y régnait une demi-obscurité.Aucune torche, aucune lampe n'était allumée, et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte.J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève, et parfois les sifflements de la brise.
Je me demandai si j'étais bien éveillé, si je rêvais encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires.Cependant ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point.
«C'est un rayon du jour, pensai-je, qui se glisse par cette fente de rochers!Voilà bien le murmure des vagues!Voilà le sifflement de la brise!Est-ce que je me trompe, ou sommes-nous revenus à la surface de la terre?Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition, ou l'aurait-il heureusement terminée?»
Je me posais ces insolubles questions, quand le professeur entra.
«Bonjour, Axel!fit-il joyeusement.Je gagerais volontiers que tu te portes bien!
—-Mais oui, dis-je on me redressant sur les couvertures.
—Cela devait être, car tu as tranquillement dormi.Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour, et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles.
—-En effet, je me sens ragaillardi, et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir!
—-Tu mangeras, mon garçon: la fièvre t'a quitté.Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel onguent dont les Islandais ont le secret, et elles se sont cicatrisées à merveille.C'est un fier homme que notre chasseur!»
Tout en parlant, mon oncle apprêtait quelques aliments que je dévorai, malgré ses recommandations.Pendant ce temps, je l'accablai de questions auxquelles il s'empressa de répondre.
J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire; comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierres, dont la moins grosse eût suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi.Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombai sanglant et inanimé.
«Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois.Mais, pour Dieu!ne nous séparons plus, car nous risquerions de ne jamais nous revoir.»
«Ne nous séparons plus!» Le voyage n'était donc pas fini?J'ouvrais de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question:
«Qu'as-tu donc, Axel?
—Une demande à vous adresser..Vous dites que me voilà sain et sauf?
—Sans doute.
—-J'ai tous mes membres intacts?
—-Certainement.
—Et ma tête?
—Ta tête, sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules.
—-Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé,
—Dérangé?
—Oui.Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe?
—-Non certes!
—Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise!
—-Ah!n'est-ce que cela?
—M'expliquerez-vous?
—Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable; mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot.
—Sortons donc!m'écriai-je en me levant brusquement.
—-Non, Axel, non!le grand air pourrait te faire du mal.
—-Le grand air?
—Oui, le vent est assez violent.Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi.
—Mais je vous assure que je me porte à merveille.
—-Un peu de patience, mon garçon.Une rechute nous mettrait dans l'embarras, et il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue.
—-La traversée?
—Oui, repose-toi encore aujourd'hui, et nous nous embarquerons demain.
—Nous embarquer!»
Ce dernier mot me fit bondir.
Quoi!nous embarquer!Avions-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition?Un bâtiment était-il mouillé dans quelque port intérieur?
Ma curiosité fut excitée au plus haut point.Mon oncle essaya vainement de me retenir.Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda.
Je m'habillai rapidement; par surcroît de précaution, je m'enveloppai dans une des couvertures et je sortis de la grotte.
XXX
D'abord je ne vis rien; mes yeux, déshabitués de la lumière, se fermèrent brusquement.Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé.
«La mer!m'écriai-je.
—Oui, répondit mon oncle, la mer Lidenbrock; et, j'aime à le penser, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom!»
Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au delà des limites de la vue.Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création.Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier aux milieux clos et immenses; une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré, et quelques embruns m'arrivaient au visage.Sur cette grève légèrement inclinée; à cent toises environ de là lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur.Quelques-uns, déchirant le rivage de leur arête aiguë, formaient des caps et des promontoires rongés par la dent du ressac.Plus loin, l'oeil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon.
C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage.
Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière «spéciale» en éclairait les moindres détails.Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits, qui n'est qu'une réflexion sans chaleur.Non.Le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la lune, accusaient évidemment une origine purement électrique.C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu, qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan.
La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel, si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui, par l'effet de la condensation, devaient, à de certains jours, se résoudre en pluies torrentielles.J'aurais cru que, sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire, et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air.Mais alors «il faisait beau».Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés; des ombres vives se dessinaient à leurs volutes inférieures, et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité.Mais, en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière.L'effet en était triste et souverainement mélancolique.Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids, et cet espace n'eût pas suffi, tout immense qu'il fût, à la promenade du moins ambitieux des satellites.
Je me souvins alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la terre à une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression, tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leurs mystérieuses orbites.Aurait-il dit vrai?
Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation.Sa largeur, on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise.Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues.Où cette voûte s'appuyait-elle sur ses contreforts de granit?L'oeil ne pouvait l'apercevoir; mais il y avait tel nuage suspendu dans l'atmosphère, dont l'élévation devait être estimée à deux mille toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité considérable de l'air.
Le mot «caverne» ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu.Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe.
Je ne savais pas, d'ailleurs, par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation.Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire?Je connaissais bien, par les récits des voyageurs, certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions.
Si la grotte de Guachara, en Colombie, visitée par M.de Humboldt, n'avait pas livré le secret de sa profondeur au savant qui la reconnut sur un espace de deux mille cinq cents pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au delà.L'immense caverne du Mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à cinq cents pieds au-dessus d'un lac insondable, et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de dix lieues sans en rencontrer la fin.Mais qu'étaient ces cavités auprès de celle que j'admirais alors, avec son ciel de vapeurs, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs?Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité.
Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence.Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations.Je croyais assister, dans quelque planète lointaine, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature «terrestrielle» n'avait pas conscience.A des sensations nouvelles il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas.Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi.
L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé; j'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique; d'ailleurs la vivacité d'un air très dense me ranimait, en fournissant plus d'oxygène à mes poumons.
On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de quarante-sept jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines.
Aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure.Mon oncle, déjà fait à ces merveilles, ne s'étonnait plus.
«Te sens-tu la force de te promener un peu?me demanda-t-il.
—-Oui, certes, répondis-je, et rien ne me sera plus agréable.
—-Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage.»
J'acceptai avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau.Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpés les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet.Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades, qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes; quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes, et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement.
Parmi ces ruisseaux; je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hans-bach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde.
«Il nous manquera désormais, dis-je avec un soupir.
—-Bah!répondit le professeur, lui ou un autre, qu'importe?»
Je trouvai la réponse un peu ingrate.
Mais en ce moment mon attention fut attirée par un spectacle inattendu.A cinq cents pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux.Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques; les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage, et, au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés.
Je hâtai le pas.Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières.Ne faisaient-elles point partie des deux cent mille espèces végétales connues jusqu'alors, et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres?Non.Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration.
En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque.Mon oncle les appela immédiatement de leur nom.
«Ce n'est qu'une forêt de champignons,» dit-il.
Et il ne se trompait pas.Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères aux milieux chauds et humides.Je savais que le «Lycoperdon giganteum» atteint, suivant Bulliard, huit à neuf pieds de circonférence; mais il s'agissait ici de champignons blancs, hauts de trente à quarante pieds, avec une calotte d'un diamètre égal.Ils étaient là par milliers; la lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage, et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine.
Cependant je voulus pénétrer plus avant.Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues.Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer.
Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons.Plus loin s'élevaient par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré.Ils étaient faciles à reconnaître; c'étaient les humbles arbustes de la terre, avec des dimensions phénoménales, des lycopodes hauts de cent pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lepidodendrons à tiges cylindriques bifurquées, terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses.
«Étonnant, magnifique, splendide!s'écria mon oncle.Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition.Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres aux premiers siècles du globe!Regarde, Axel, admire!Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête!
—Vous avez raison, mon oncle; la Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur.
—-Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre; mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie.
—Une ménagerie!
—Oui, sans doute.Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements épars sur le sol.
—Des ossements!m'écriai-je.Oui, des ossements d'animaux antédiluviens!»
Je m'étais précipité sur ces débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible[1].Je mettais sans hésiter un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés.
[1] Phosphate de chaux.
«Voilà la mâchoire inférieure du Mastodonte, disais-je; voilà les molaires du Dinotherium, voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au Mégatherium.Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme; les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes.Tenez, j'aperçois des squelettes entiers.Et cependant…
—Cependant?dit mon oncle.
—Je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit.
—Pourquoi?
—Parce que la vie animale n'a existé sur la terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions, et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive.
—Eh bien!Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection, c'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire.
—Comment!à une pareille profondeur au-dessous de la surface de la terre?
—Sans doute, et ce fait peut s'expliquer géologiquement.À une certaine époque, la terre n'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l'attraction.Il est probable que des affaissements du sol se sont produits, et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts.
—Cela doit être.Mais, si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés?»
A cette idée j'interrogeai, non sans effroi, les divers points de l'horizon; mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts.
J'étais un peu fatigué: j'allai m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas.De là mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte.Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales.Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent.Un brick et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise.Je m'attendais presque à voir quelque navire sortant toutes voiles dehors et prenant le large sous la brise du sud.
Mais cette illusion se dissipa rapidement.Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain.Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert, descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan.Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon.Quelles demandes se pressaient sur mes lèvres?Où finissait cette mer?Où conduisait-elle?Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés?
Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte.Moi, je le désirais et je le craignais à la fois.
Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte, et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil.
XXXI
Le lendemain je me réveillai complètement guéri.Je pensai qu'un bain me serait très salutaire, et j'allai me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée.Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous.
Je revins déjeuner avec un bel appétit.Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu; il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire.Au dessert, il nous servit quelques tasses de café, et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster.
«Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène.
—Comment, la marée!m'écriai-je.
—Sans doute.
—L'influence de la lune et du soleil se fait sentir jusqu'ici!
—Pourquoi pas!Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle?Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale?Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même.»
En ce moment nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève.
«Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je.
—Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ.
—C'est merveilleux!
—Non: c'est naturel.
—Vous avez beau dire, tout cela me parait extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois mes yeux.Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes!
—Pourquoi pas?Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose?
—Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale.
—Donc, jusqu'ici la théorie de Davy se trouve justifiée?
—Évidemment, et dès lors rien ne contredit l'existence de mers ou de contrées à l'intérieur du globe.
—Sans doute, mais inhabitées.
—Bon!pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue?
—En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici.
—Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires.
—Nous essayerons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles.
—Mais où sommes-nous, mon oncle?car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre?
—Horizontalement, à trois cent cinquante lieues de l'Islande.
—Tout autant?
—Je suis sûr de ne pas me tromper de cinq cents toises.
—Et la boussole indique toujours le sud-est?
—Oui, avec une déclinaison occidentale de dix-neuf degrés et quarante-deux minutes, comme sur terre, absolument.Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin.
—Et lequel?
—C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire.
—Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus?
—Précisément, et il est probable que, si nous arrivions sous les régions polaires, vers ce soixante-dixième degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement.Donc, ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur.
—En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné.
—La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité.
—Et à quelle profondeur sommes-nous?
—A une profondeur de trente-cinq lieues
—Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Ecosse est au-dessus de nous, et, là, les monts Grampians élèvent à une prodigieuse hauteur leur cime couverte de neige.
—Oui, répondit le professeur en riant; c'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide; le grand architecte de l'univers l'a construite on bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée!Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de trois lieues, sous laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise?
—Oh!Je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête.Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets?Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe?
—Retourner!Par exemple!Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici.
—Cependant je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide.
—Aussi je ne prétends point m'y précipiter la tête la première.Mais si les océans ne sont, à proprement parler, que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique.
—Cela n'est pas douteux.
—Eh bien!sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues.
—Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan?
—Trente ou quarante lieues.
—Ah!fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte.
—Ainsi nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain nous prendrons la mer.»
Involontairement je cherchai des yeux le navire qui devait nous transporter.
«Ah!dis-je, nous nous embarquerons.Bien!Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage?
—Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau.
—Un radeau!m'écriai-je; un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop…
—Tu ne vois pas, Axel, mais, si tu écoutais, tu pourrais
entendre!
—Entendre?
—Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'oeuvre.
—Il construit un radeau?
—Oui.
—Comment!il a déjà fait tomber dès arbres sous sa hache?
—Oh!les arbres étaient tout abattus.Viens, et tu le verras à l'ouvrage.»
Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail; quelques pas encore, et je fus près de lui.A ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable; il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de madriers, de courbes, de couples de toute espèce, jonchaient littéralement le sol.Il y avait là de quoi construire une marine entière.
«Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois?
—C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du Nord, minéralisées sous l'action des eaux de la mer.
—Est-il possible?
—C'est ce qu'on appelle du «surtarbrandur» ou bois fossile.
—Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre, et il ne pourra flotter?
—Quelquefois cela arrive; il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites; mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile.Regarde plutôt,» ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves.
Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations.
«Es-tu convaincu?dit mon oncle.
—Convaincu surtout que cela n'est pas croyable!»
Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé; il avait dix pieds de long sur cinq de large; les poutres de surtarbrandur, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide, et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock.
XXXII
Le 13 août, on se réveilla de bon matin.Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant.
Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures, composaient tout le gréement du radeau.Les cordes ne manquaient pas.Le tout était solide.
A six heures, le professeur donna le signal d'embarquer.Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place.
Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant.Il se mit à la barre.Je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage; la voile fut orientée et nous débordâmes rapidement.
Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres.
«Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer.
—Lequel?
—Le nom de Graüben, Port-Graüben, cela fera très bien sur la carte.
—Va pour Port-Graüben.»
Et voilà comment le souvenir de ma chère Virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition.
La brise soufflait du nord-est; nous filions vent arrière avec une extrême rapidité.Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur.
Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse.
«Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins trente lieues par vingt-quatre heures et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés.
Je ne répondis pas, et j'allai prendre place à l'avant du radeau.Déjà la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon; les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ.Devant mes yeux s'étendait une mer immense; de grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre, qui semblait peser sur cette eau morne.Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis ça et là par quelque gouttelette, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation.Bientôt toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et, sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité.
Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots.Je connaissais la puissance végétative de ces plantes, qui rampent à une profondeur de plus de douze mille pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de quatre cents atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires; mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock.
Notre radeau longea des fucus longs de trois et quatre mille pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue; je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières ma patience était trompée, sinon mon étonnement.
Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre aux premiers siècles de sa formation, quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface!
Le soir arriva, et, ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution.C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter.
Après le souper je m'étendis au pied du mât, et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries.
Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé.
Depuis notre départ de Port-Graüben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le «journal du bord», de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation.
Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée.
Vendredi 14 août.—Brise égale du N.-O.Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite.La côte reste à trente lieues sous le vent.Rien à l'horizon.L'intensité de la lumière ne varie pas.Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche, comme serait de l'argent en fusion.
Thermomètre: + 32° centigr.
A midi Mans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde; il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer.Pendant deux heures il ne prend rien.Ces eaux sont donc inhabitées?Non.Une secousse se produit.Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement.
«Un poisson!s'écrie mon oncle.
—C'est un esturgeon!m'écriai-je à mon tour, un esturgeon de petite taille!»
Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion.Ce poisson a la tête plate, arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses; sa bouche est privée de dents; des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue.Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels.
Mon oncle ne s'y trompe pas, car, après un assez court examen, il dit:
«Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain dévonien.
-Comment!dis-je, nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives?
—Oui, répond le professeur en continuant ses observations, et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles.Or, tenir un de ces êtres vivant c'est un véritable bonheur de naturaliste.
—Mais à quelle famille appartient-il?
—A l'ordre des Ganoïdes, famille des Céphalaspides, genre…
—Eh bien?
—Genre des Pterychtis, j'en jurerais; mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines.
—Laquelle?
—Il est aveugle!
—Aveugle!
—Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument.»
Je regarde.Rien n'est plus vrai.Mais ce peut être un cas particulier.La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer.Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en deux heures nous prenons une grande quantité de Pterychtis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les Dipterides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre.Tous sont dépourvus de l'organe de la vue.Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions.
Ainsi donc, cela paraît constant, cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne.
Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage.
Je prends la lunette et j'examine la mer.Elle est déserte.
Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes.
Je regarde dans les airs.Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques?Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture.J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages.
Cependant mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie.Je rêve tout éveillé.Je crois voir à la surface des eaux ces énormes Chersites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants.Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le Leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le mericotherium, venu des régions glacées de la Sibérie.Plus loin, le pachyderme Lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'Anoplotherium, animal étrange, qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul.Le Mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le Megatherium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granits sonores.Plus haut, le Protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues.Plus haut encore, le Ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé.Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique.
Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination.Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore.Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés.Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés.Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour.Toute la vie de la terre se résume en moi, et mon coeur est seul à battre dans ce monde dépeuplé.Il n'y plus de saisons; il n'y a plus de climats; la chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux.La végétation s'exagère; je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol; je m'appuie au tronc des conifères immenses; je me couche à l'ombre des Sphenophylles, des Asterophylles et des Lycopodes hauts de cent pieds.
Les siècles s'écoulent comme des jours; je remonte la série des transformations terrestres; les plantes disparaissent; les roches granitiques perdent leur dureté; l'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense; les eaux courent à la surface du globe; elles bouillonnent, elles se volatilisent; les vapeurs enveloppent la terre, qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse, portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui!
Au centre de cette nébuleuse, quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires; mon corps se subtilise, se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée!
Quel rêve!Où m'emporte-t-il?Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails.
J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau!
Une hallucination s'est emparée de mon esprit…
«Qu'as-tu?» dit mon oncle.
Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir.
«Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer!»
En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans.Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots.
«Est-ce qu'il devient fou?s'écrie le professeur.
—Qu'y a-t-il?dis-je enfin, en revenant à moi.
—Es-tu malade?
—Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé.
Tout va bien, d'ailleurs?
—Oui!bonne brise, belle mer!nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir.»
À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon; mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages.
XXXIII
Samedi 15 août.—La mer conserve sa monotone uniformité.Nulle terre n'est en vue.L'horizon parait excessivement reculé.
J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve.
Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur; il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité.
Je remarque que le professeur Lidenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé, et je consigne le fait sur mon journal.Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité; mais, depuis ma guérison, la nature a repris le dessus.Et cependant, pourquoi s'emporter?Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables?Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité?
«Vous semblez inquiet, mon oncle?dis-je, en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux.
—Inquiet?Non.
—Impatient, alors?
—On le serait à moins!
—Cependant nous marchons avec vitesse…
—Que m'importe?Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande!»
Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de ce souterrain.Or nous avons parcouru un chemin trois fois plus long, et les rivages du sud n'apparaissent pas encore.
«Nous ne descendons pas!reprend le professeur.Tout cela est du temps perdu, et, en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang!
Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang!
«Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par
Saknussemm…
—C'est la question.Avons-nous suivi cette route?Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau?L'a-t-il traversée?Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés?
—En tout cas, nous ne pouvons regretter, d'être venus jusqu'ici.
Ce spectacle est magnifique, et…
—Il ne s'agit pas de voir.Je me suis proposé un but, et je veux l'atteindre!Ainsi ne me parle pas d'admirer!»
Je me le tiens pour dit, et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience.A six heures du soir, Hans réclame sa paye, et ses trois rixdales lui sont comptés.
Dimanche 16 août.—Rien de nouveau.Même temps.Le vent a une légère tendance à fraîchir.En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière.Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre.Il n'en est rien: l'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots.
Vraiment cette mer est infinie!Elle doit avoir la largeur de la
Méditerranée, ou même de l'Atlantique. Pourquoi pas?
Mon oncle sonde à plusieurs reprises; il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de deux cents brasses.Pas de fond.Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde.
Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées.On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux corps durs.
Je regarde le chasseur.
«Tänder!» fait-il.
Je ne comprends pas.Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions.Je ne me soucie pas de le déranger.Je reviens vers l'Islandais.Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée.
«Des dents!» dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer.
Oui!ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal!Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse!Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine!Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée!Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité?
Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures.
Lundi 17 août.—Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire, qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe.Le monde appartenait alors aux reptiles.Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques[1].La nature leur avait accordé la plus complète organisation.Quelle gigantesque structure!quelle force prodigieuse!Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges!
[1] Mers de la période secondaire qui ont formé les terrains dont se composent les montagnes du Jura.
Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres.Nul oeil humain ne les a vus vivants.Ils apparurent sur la terre mille siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le lias, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation.
J'ai vu au Muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait trente pieds de longueur.Suis-je donc destiné, moi, habitant de la terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne?Non!c'est impossible.Cependant la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leur empreinte je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile.
Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer; je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines.
Je suppose que le professeur Lidenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car, après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard.
«Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder!Il a troublé quelque animal marin dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route!…»
Je jette un coup d'oeil sur les armes, et je m'assure qu'elles sont en bon état.Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste.
Déjà de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées.Le danger est proche.Il faut veiller.
Mardi 18 août.—Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan, et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques.Hans est à la barre.Pendant son quart je m'endors.
Deux heures après, une secousse épouvantable me réveille.Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à vingt toises de là.
«Qu'y a-t-il?s'écria mon oncle; avons-nous touché?»
Hans montre du doigt, à une distance de deux cents toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour.Je regarde et je m'écrie:
«C'est un marsouin colossal!
—Oui, réplique mon oncle, et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune.
—Et plus loin un crocodile monstrueux!Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée.Ah!il disparaît!
—Une baleine!une baleine!s'écrie alors le professeur.J'aperçois ses nageoires énormes!Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents!»
En effet, deux colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer.Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés, en présence de ce troupeau de monstres marins.Ils ont des dimensions surnaturelles, et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent.Hans veut mettre la barre au vent, afin de fuir ce voisinage dangereux; mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables: une tortue large de quarante pieds, et un serpent long de trente, qui darde sa tête énorme au-dessus des flots.
Impossible de fuir.Ces reptiles s'approchent; ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler; ils tracent autour de lui des cercles concentriques.J'ai pris ma carabine.Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert?
Nous sommes muets d'effroi.Les voici qui s'approchent!D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent.Le reste du troupeau marin a disparu.Je vais faire feu.Hans m'arrête d'un signe.Les deux monstres passent à cinquante toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre, et leur fureur les empêche de nous apercevoir.
Le combat s'engage à cent toises du radeau.Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises.
Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte, le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue; à chaque instant je les entrevois.Je les montre à l'Islandais.Celui-ci remue la tête négativement.
«Tva», fait-il.
—Quoi!deux!il prétend que deux animaux seulement…
—Il a raison, s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux.
—Par exemple!
—Oui!le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés.C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus!
—Et l'autre?
—L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus!»
Hans a dit vrai.Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs.J'aperçois l'oeil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme.La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite.On l'a justement nommé la baleine des Sauriens, car il en a la rapidité et la taille.Celui-ci ne mesure pas moins de cent pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue.Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de cent quatre-vingt-deux dents.
Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame.Son corps est entièrement revêtu d'une carapace, et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à trente pieds au-dessus des flots.
Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie.Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau.Vingt fois nous sommes sur le point de chavirer.Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre.Les deux bêtes sont enlacées.Je ne puis les distinguer l'une de l'autre!Il faut tout craindre de la rage du vainqueur.
Une heure, deux heures se passent.La lutte continue avec le même acharnement.Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour.Nous restons immobiles, prêts à faire feu.
Soudain l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maëlstrom.Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer?
Mais tout à coup une tête énorme s'élance au dehors, la tête du Plesiosaurus.Le monstre est blessé à mort.Je n'aperçois plus son immense carapace.Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé.L'eau rejaillit à une distance considérable.Elle nous aveugle.Mais bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin, ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés.
Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine, ou va-t-il reparaître à la surface de la mer?
XXXIV
Mercredi 19 août.—Heureusement le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat.Hans est toujours au gouvernail.Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer.
Le voyage reprend sa monotone uniformité, que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier.
Jeudi 20 août.—Brise N.-N.-E.assez inégale.Température chaude.Nous marchons avec une vitesse de trois lieues et demie à l'heure.
Vers midi un bruit très éloigné se fait entendre.
Je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication.
C'est un mugissement continu.
«Il y a au loin, dit le professeur, quelque rocher, ou quelque îlot sur lequel la mer se brise.»
Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil.
L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon.
Trois heures se passent.Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée.
Je le fais remarquer à mon oncle, qui secoue la tête.J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas.Courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme?Que cette manière de descendre plaise au professeur, parce qu'elle se rapproche de la verticale, c'est possible, mais à moi…
En tout cas, il doit y avoir à quelques lieues au vent un phénomène bruyant, car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence.Viennent-ils du ciel ou de l'océan?
Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère, et je cherche à sonder leur profondeur.Le ciel est tranquille; les nuages, emportés au plus haut de la voûte, semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière.Il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène.
J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume.Son aspect n'a pas changé.Mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte; si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer, et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés.Je consulte le courant.Il est nul.Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent.
Vers quatre heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité.De là son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête à un point.Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son poil est devenu fixe.
«Il a vu quelque chose, dit mon oncle.
—Je le crois.»
Hans redescend, puis il étend son bras vers le sud en disant:
«Der nere!»
—Là-bas?» répond mon oncle.
Et saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant une minute, qui me paraît un siècle.
«Oui, oui!s'écrie-t-il.
—Que voyez-vous?
—Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots.
—Encore quelque animal marin?
—Alors mettons le cap plus à l'ouest, car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens!
—Laissons aller,» répond mon oncle.
Je me retourne vers Hans.Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur.
Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal, et qu'il faut estimer à douze lieues au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ses évents, il doit être d'une taille surnaturelle.Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence.Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents.
On va donc en avant.Plus nous approchons, plus la gerbe grandit.Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption?
A huit heures du soir nous ne sommes pas à deux lieues de lui.Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot.Est-ce illusion?est-ce effroi?Sa longueur me parait dépasser mille toises!Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les Cuvier ni les Blumembach?Il est immobile et comme endormi; la mer semble ne pouvoir le soulever, et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs.La colonne d'eau, projetée à une hauteur de cinq cents pieds retombe avec un bruit assourdissant.Nous courons en insensés vers cette masse puissante que cent baleines ne nourriraient pas pour un jour.
La terreur me prend.Je ne veux pas aller plus loin!Je couperai, s'il le faut, la drisse de la voile!Je me révolte contre le professeur, qui ne me répond pas.
Tout à coup Hans se lève, et montrant du doigt le point menaçant:
«Holme!» dit-il.
—Une île!s'écrie mon oncle.
—Une île!dis-je à mon tour en haussant les épaules.
—Évidemment, répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire.
—Mais cette colonne d'eau!
—Geyser[1] fait Hans.
[1] Source jaillissante très célèbre située au pied de l'Hécla.
—Eh!sans doute, geyser, riposte mon oncle, un geyser pareil à ceux de l'Islande!»
Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement.Avoir pris un îlot pour un monstre marin!Mais l'évidence se fait, et il faut enfin convenir de mon erreur.Il n'y a là qu'un phénomène naturel.
A mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses.L'îlot représente à s'y méprendre un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de dix toises.Le geyser, mot que les Islandais prononcent «geysir» et qui signifie «fureur», s'élève majestueusement à son extrémité.De sourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme jet, pris de colères plus violentes, secoue son panache de vapeurs en bondissant jusqu'à la première couche de nuages.Il est seul.Ni fumerolles, ni sources chaudes ne l'entourent, et toute la puissance volcanique se résume en lui.Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante, dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme.
«Accostons,» dit le professeur.
Mais il faut, éviter avec soin cette trombe d'eau, qui coulerait le radeau en un instant.Hans, manoeuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot.
Je saute sur le roc; mon oncle me suit lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste, comme un homme au-dessus de ces étonnements.
Nous marchons sur un granit mêlé de tuf siliceux; le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée; il est brûlant.Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser.Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement, et il marque une chaleur de cent soixante-trois degrés.
Ainsi donc cette eau sort d'un foyer ardent.Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lidenbrock.Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque.
«Eh bien, réplique-t-il, qu'est-ce que cela prouve, contre ma doctrine?
—Rien,» dis-je d'un ton sec, en voyant que je me heurte à un entêtement absolu.
Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que, pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température; mais il me paraît évident, certain, que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres.
Nous verrons bien.C'est le mot du professeur, qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de rembarquement.
Je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser.Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité, puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir.
Enfin nous partons en contournant les roches très accores du sud.
Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état.
Mais avant de déborder je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue, et je les note sur mon journal.Nous avons franchi deux cent soixante-dix lieues de mer depuis Port-Graüben, et nous sommes à six cent vingt lieues de l'Islande, sous l'Angleterre.
XXXV
Vendredi 21 août.—Le lendemain le magnifique geyser a disparu.Le vent a fraîchi, et nous a rapidement éloignés de l'îlot Axel.Les mugissements se sont éteints peu à peu.
Le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi, va changer avant peu.L'atmosphère se charge de vapeurs, qui emportent avec elles l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines, les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre; les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes.
Je me sens particulièrement impressionné, comme l'est sur terre toute créature à l'approche d'un cataclysme.Les «cumulus[1]» entassés dans le sud présentent un aspect sinistre; ils ont cette apparence «impitoyable» que j'ai souvent remarquée au début des orages.L'air est lourd, la mer est calme.
[1] Nuages de formes arrondies.
Au loin les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre; peu à peu ils se gonflent et perdent en nombre ce qu'ils gagnent en grandeur; leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon; mais, au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable; parfois une pelote de vapeurs, encore éclairée, rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque.
Évidemment l'atmosphère est saturée de fluide, j'en suis tout imprégné, mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique.Il me semble que, si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente.
A dix heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs; on dirait que le vent mollit pour mieux reprendre haleine; la nue ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans.
Je ne veux pas croire aux menaces du ciel, et cependant je ne puis m'empêcher de dire:
«Voilà du mauvais temps qui se prépare.»
Le professeur ne répond pas.Il est d'une humeur massacrante, à voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux.Il hausse les épaules à mes paroles.
«Nous aurons de l'orage, dis-je en étendant la main vers l'horizon, ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser!»
Silence général.Le vent se tait.La nature a l'air d'une morte et ne respire plus.Sur le mat, où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en plis lourds.Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et sans ondulations.Mais, si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile, qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête?
«Amenons-la, dis-je, abattons notre mât: cela sera prudent.
—Non, par le diable!s'écrie mon oncle, cent fois non!Que le vent nous saisisse!que l'orage nous emporte!mais que j'aperçoive enfin les rochers rivage, quand notre radeau devrait s'y briser en mille pièces!»
Ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect; les vapeurs accumulêes se résolvent en eau, et l'air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan.Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne.L'obscurité redouble.C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes.
Le radeau se soulève, il bondit.Mon oncle est jeté de son haut.Je me traîne jusqu'à lui.Il s'est fortement cramponné à un bout de câble et parait considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés.
Hans ne bouge pas.Ses longs cheveux, repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile, lui donnent une étrange physionomie, car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses.Son masque effrayant est celui d'un homme antédiluvien, contemporain des Ichthyosaures et des Megatherium.
Cependant le mât résiste.La voile se tend comme une bulle prête à crever.Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ces gouttes d'eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes.
«La voile!la voile!dis-je, en faisant signe de l'abaisser.
—Non!répond mon oncle.
—Nej,» fait Hans en remuant doucement la tête.
Cependant la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensés.Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous le voile de nuage se déchire, la mer entre en ébullition et l'électricité, produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures, est mise en jeu.Aux éclats du tonnerre se mêlent les jets étincelants de la foudre; des éclairs sans nombre s'entre-croisent au milieu des détonations; la masse des vapeurs devient incandescente; les grêlons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux; les vagues soulevées semblent être autant de mamelons ignivomes sous lesquels couve un feu intérieur, et dont chaque crête est empanachée d'une flamme.
Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre; il faut me retenir au mât, qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan………. ………………………………………………………. …………………………
[Ici mes notes de voyage devinrent très incomplètes.Je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives et prises machinalement pour ainsi dire.Mais, dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait, et mieux que ma mémoire elles me donnent le sentiment de notre situation.]…………………………………………………….. …………………………..
Dimanche 23 août.—Où sommes-nous?Emportés avec une incomparable rapidité.
La nuit a été épouvantable.L'orage ne se calme pas.Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante.Nos oreilles saignent.On ne peut échanger une parole.
Les éclairs ne discontinuent pas.Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide, reviennent de bas ou haut et vont frapper la voûte de granit.Si elle allait s'écrouler!D'autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes.Le bruit général ne parait pas s'en accroître; il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine, et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage.
Il y a émission continue de lumière à la surface des nuages; la matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules; évidemment les principes gazeux de l'air sont altérés; des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant.
Où allons-nous?…Mon oncle est couché tout de son long à l'extrémité du radeau.
La chaleur redouble.Je regarde le thermomètre; il indique…
[Le chiffre est effacé.]
Lundi 24 août.—Cela ne finira pas!Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense, une fois modifié, ne serait-il pas définitif?
Nous sommes brisés de fatigue, Hans comme à l'ordinaire.Le radeau court invariablement vers le sud-est.Nous avons fait plus de deux cents lieues depuis l'îlot Axel.
A midi la violence de l'ouragan redouble; il faut lier solidement tout les objets composant la cargaison.Chacun de nous s'attache également.Les flots passent par-dessus notre tête.
Impossible de s'adresser une seule parole depuis trois jours.Nous ouvrons la bouche, nous remuons nos lèvres; il ne se produit aucun son appréciable.Même en se parlant à l'oreille on ne peut s'entendre.
Mon oncle s'est approché de moi.Il a articulé quelques paroles.Je crois qu'il m'a dit: «Nous sommes perdus.» Je n'en suis pas certain.
Je prends le parti de lui écrire ces mots: «Amenons notre voile.»
Il me fait signe qu'il y consent.
Sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau.Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc, et je les ai vus s'enlever à une prodigieuse hauteur, semblables au Ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles.
Nous sommes glacés d'effroi; la boule mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d'une bombe de dix pouces, se promène lentement, en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan.Elle vient ici, là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre.Horreur!Nous allons sauter!Non!Le disque éblouissant s'écarte; il s'approche de Hans, qui le regarde fixement; de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l'éviter; de moi, pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur; il pirouette près de mon pied, que j'essaye de retirer.Je ne puis y parvenir.
Une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère; elle pénètre le gosier, les poumons.On étouffe.
Pourquoi ne puis-je retirer mon pied?Il est donc rivé au radeau?Ah!la chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord; les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu; les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois.Je ne puis retirer mon pied!
Enfin, par un violent, effort, je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même, si…
Ah!quelle lumière intense!le globe éclate!nous sommes couverts par des jets de flammes!
Puis tout s'éteint.J'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau; Hans toujours à sa barre et «crachant du feu» sous l'influence de l'électricité qui le pénètre!
Où allons-nous?où allons-nous? ……………………………………………….
Mardi 25 août.—Je sors d'un évanouissement prolongé; l'orage continue; les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchée dans l'atmosphère.
Sommes-nous toujours sur la mer?Oui, et emportés avec une vitesse incalculable.Nous avons passé sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l'Europe entière, peut-être! ……………………………………………….
Un bruit nouveau se fait entendre!Évidemment, la mer qui se brise sur des rochers!…Mais alors… ………………………………………………. ……………………………………………….