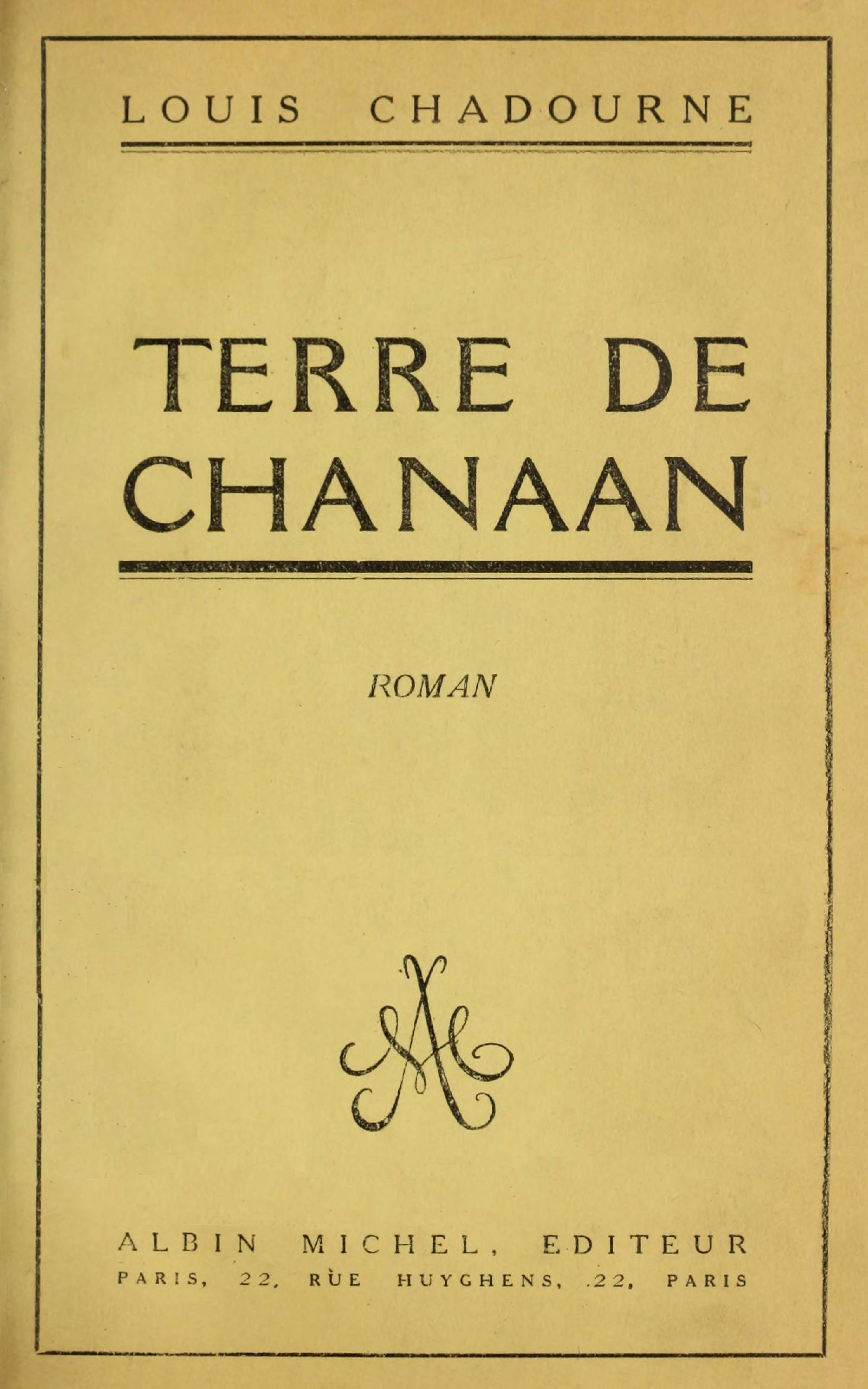Terre de Chanaan
Play Sample
TERRE DE CHANAAN
PREMIÈRE PARTIE
LE MIRAGE
I
LES FORAINS DE L’OCÉAN
Des philosophes ont résolu de supprimer le Hasard. Un mathématicien célèbre, ayant fait sa lecture quotidienne de la Gazette de Monte-Carlo et pointé pendant des années les statistiques de la roulette, a fort bien démontré que ce dieu fantasque n’était qu’un faux dieu et que certains esprits d’élite étaient enfin sur une voie propre à démasquer l’imposteur. Il n’y a pas de place en ce monde où tout obéit au plus rigoureux déterminisme pour les caprices d’un fantôme surgi de l’imagination vulgaire, médiocre supercherie de l’ignorance ; non, de place nulle part, sur la vaste étendue des continents et des mers, sous la calotte céleste, pour ce prestidigitateur qui vient à tout bout de champ culbuter nos châteaux de cartes et tirer de nos chapeaux, de nos poches et de nos vies quotidiennes une effarante kyrielle de contingences hétéroclites.
Toutefois, malgré de si louables efforts et des raisonnements si persuasifs, je continuerai dans le secret de mon cœur à sacrifier à ce Dieu masqué, tragique ou rieur, que je nomme très humblement, et à voix basse « le Seigneur Hasard ».J’attendrai, sans doute, pour renoncer à ma superstition qu’une science plus exacte des probabilités ait fait de la roulette et du trente-et-quarante une opération de père de famille.Il sera temps alors de rendre honneur aux mathématiciens et aux philosophes et de tourner au mur notre divinité moquée, ainsi que font à leurs saints quelques bonnes gens de nos campagnes, selon qu’il vente ou qu’il pleut contre leur gré.
Pour moi, Jean Loubeyrac, replié sur ma cinquantaine grisonnante, dans ce coin du Périgord, berceau de mes modestes ancêtres, où la vie coule avec la même lenteur limpide et monotone que la Dordogne entre ses falaises rousses et ses rives plantées de noyers, c’est en vain que je cherche à démêler les fils embrouillés des vicissitudes dont fut tissée mon existence. De nature paisible, ironique et un peu rêveuse, il faut l’avouer, je n’eus jamais d’autre ambition que ce clos ombragé de châtaigniers d’où je peux aujourd’hui, parvenu au terme d’une aventureuse carrière, réfléchir tout à mon aise sur la fortune et l’« inconstance de son branle divers », comme dit Montaigne, l’inséparable compagnon de mes loisirs. Un grand feu flambant de bois sec, ma pipe, des marrons cuits sous la cendre, un verre de vin doux, voilà pour moi, par un soir d’automne, tel que celui-ci, bise sifflante dans mes arbres et brouillard mouillé sur les chemins, la seule volupté et la seule richesse qui vaillent la peine d’être conquises.
Mais, rien ne peut faire prévoir les brusques fantaisies du Destin.Ce soir même, pour assurée que paraisse mon existence, en entendant gémir les premières voix de l’automne, je me retourne sur mon fauteuil et guigne vers la porte bien close.Qu’un coup de vent fasse sauter le loquet, et cela suffit pour que ce rôdeur sans gêne entre et vous frappe sur l’épaule : « En route, mon bonhomme !» Dame !j’en ai tant vu !Je sais aujourd’hui qu’il faut faire à son foyer la place de l’Inconnu, comme jadis, aux repas, on faisait la place du Passant.
Ah ! monsieur le Mathématicien, vous ne croyez pas au hasard. En dépit des tables statistiques, vous y auriez cru comme moi, si vous l’aviez vu, de vos yeux vu, maigre, dégingandé, étendu de toute sa longue carcasse flâneuse sous le grand soleil du tropique, la tête reposant sur un rouleau de cordage, à l’arrière de la Mariquita, ce matin de juin, il y a quelque vingt-cinq ans, au sortir des Bouches du Serpent.Oui, c’était bien le hasard lui-même, la fantaisie, l’arbitraire, le démon tragi-comique de ma destinée, incarnés à cette place sous les espèces humaines de Jérôme Carvès, prospecteur.
A évoquer cette matinée, sur ces eaux lointaines où le soleil rebondissait en disques d’or, et le vaisseau, toutes voiles dehors, par une bonne brise de noroît ; à l’évoquer, elle surtout, cette étrange figure de mon ami, mon sang coule plus chaud et plus vif dans mes veines.Le vieil homme désabusé se sent tout ragaillardi.
Nette, ma fille, ajoute quelques sarments dans l’âtre.Et encore un coup de ce vin trouble des dernières vendanges pour raviver les ombres !
La Mariquita était un brick, jaugeant deux cents tonneaux, et filant joliment par bonne brise ses quatorze nœuds sur la mer des Antilles. Son capitaine et propriétaire, un mulâtre de la Pointe-à-Pitre, courtaud, musclé, le front bas et la mâchoire carrée, répondait au nom de Cupidon. Le capitaine Cupidon marchait en roulant sur ses fortes cuisses, à l’ordinaire des marins, chiquait, et parlait créole avec une voix grêle aux sonorités puériles, déconcertantes. Il portait aux oreilles d’assez larges anneaux d’or, un pantalon de coutil rayé haut relevé sur la cheville nue et une veste de cotonnade bleue enrichie d’une ancre roussie par le vent de mer et l’humidité. A bord, son chef était orné d’une casquette, mais pour descendre à terre, le mulâtre remplaçait volontiers cette coiffure par un large panama à la mode mexicaine. Un louable souci de l’élégance européenne contraignait aux escales le capitaine Cupidon à chausser ses larges pieds de chaussures de cuir jaune qui lui donnaient beaucoup de mal, tant pour les enfiler que pour les supporter ensuite. Il n’était pas rare que le loup de mer, chassant toute préoccupation de dandysme, se débarrassât de ces encombrants accessoires, et c’est ainsi que Jérôme Carvès et moi fîmes la connaissance de l’honorable Cupidon qui, la face épanouie de bien-être, après une longue torture, ses larges prunelles blanc-bleutées roulant sous l’ombre du chapeau de paille, cheminait sur les quais de Trinidad, ses bottines à la main.
Ce n’est pas sans satisfaction que nous aperçûmes sa silhouette entre les balles de cacao et les barils de rhum.Depuis trois semaines, nous attendions le passage d’un bateau faisant route vers la côte sud-américaine.Le moindre rafiau eût fait notre affaire et nous n’étions pas difficiles quant au confort et au couvert.Cependant, par une fatalité bien connue des voyageurs, la dernière goélette en partance pour Puerto-Leon, notre commune destination, avait largué, la veille de notre arrivée.Nous nous logeâmes non loin de Marine Place, à l’Hôtel de France, tenu par un compatriote qui nous versa toutes sortes de bonnes paroles et autant de whisky-sodas qu’il était nécessaire pour nous faire prendre patience.
Trinidad, perle du Tropique, nous offrit sa Savane claire, où, sous les manguiers et les palmiers, paissent des vaches helvétiques, ses boutiques parfumées de gin et de cannelle, ses vérandas fleuries d’hibiscus et de flamboyants. Mais les délices de Port of Spain sont coûteuses et nos ressources — d’ailleurs médiocres — avaient une fâcheuse tendance à s’épuiser. Nous parcourûmes sous le soleil de plomb — on était au début de la saison chaude — ces interminables quais gris, poussiéreux et charbonneux où s’accumulent les richesses des Iles. Sous les arcades se pressait une foule sordide et bigarrée, des Hindous enturbannés, des Chinois en pantalons de soie noire, des Malais, des métis, des nègres. Une lumière cruelle suintait d’un ciel cotonneux. Les magasins, les entrepôts, les banques, les agences de navigation s’alignaient, laissant entrevoir dans l’ombre des salles étouffantes des silhouettes blanches penchées sur des chiffres, un Chinois derrière son comptoir. Parfois s’échappaient d’une porte des bouffées d’épices, ou l’odeur un peu écœurante du bois de rose.
Nous interrogions les matelots, les portefaix, les débardeurs et ces flâneurs qui, débarqués on ne sait d’où, attendent d’invraisemblables embauchages, humant, les yeux mi-clos, en connaisseurs, appuyés sur un baril ou sur un rouleau de corde, les senteurs mêlées du goudron, du charbon et de la saumure.Dans la vaste rade bordée de cocotiers et que dominent les montagnes volcaniques souvent encapuchonnées de fumées, des steamers étaient à l’amarre, de gros cargos aux flancs rouillés, des charbonniers noirs et rouges, et aussi de fins voiliers, bricks, goélettes, lougres, sloops, et cotres, leur toile repliée et balancée mollement par les houles de l’Atlantique.Des vapeurs étaient sous pression pour la Nouvelle-Orléans ou les Grandes Indes ; des goélettes feraient voile bientôt pour Sainte-Lucie, la Dominique ou Surinam, mais aucune ne nous conduirait jusqu’à ce Puerto-Leon dédaigné des plus infimes trafiquants : Puerto-Leon où nul n’espérait prendre un chargement de cacao, de café ou de gomme balata, mais vers quoi convergeaient les ambitions de Jérôme Carvès ainsi que nos communes destinées.
Ayant successivement parcouru le North Quay, le South Quay, les ruelles avoisinantes, les « saloons » et les académies de billard, lassés de voir s’allonger chaque jour la note de notre dépense, nous errions assez lamentablement sous les ombrages du « Cipriani boulevard », à l’heure où les équipages, les nurses, les babies et les demoiselles sapotilles vont goûter la fraîcheur sur les pelouses de la Savane.
Un orchestre criard déchirait le lourd et silencieux après-midi.Sur le sombre tapis de verdure de la promenade s’arrondissait, éblouissant, pavoisé aux couleurs anglaises, un cirque, un vrai cirque, comme il en passait parfois jadis dans mon village.Un peu de brise gonflait les parois de toile, agitait le pavillon.Une parade annonçait la représentation du soir : un paillasse chevelu maillochait la grosse caisse, un athlète en maillot rose choquait les cymbales, les cascades du piano mécanique ruisselaient dans l’or crépusculaire.Sous les rayons du soleil prêt à disparaître derrière le front de la sourcilleuse soufrière, les cuivres flambaient d’un éclat triomphal ; les loques bariolées d’azur, de violet, d’écarlate avaient des stridences de trompettes et les palmiers de la Savane inclinaient majestueusement leurs éventails, en hommage à l’Ecuyère, corsetée de velours cramoisi, présentant une lourde haquenée grise caparaçonnée comme elle.
Des forains ?Surgis miraculeusement dans cette île !O rumeurs des lointaines vacances — manèges, orgues de Barbarie, féeries de l’enfance !— Des forains de l’Océan !
Sur le placard on lisait en capitales blanches : « Première représentation du Cirque Wang — Great attraction » Le spectacle commencerait à huit heures ; le prix des places était de deux shillings : suivait un copieux programme où figuraient les noms illustres de Miss Carolina, écuyère ; de Miss Letchy, acrobate ; du Dr Van Sleep, dresseur d’animaux savants et de Peter Boom, excentrique. L’affiche indiquait que le Cirque Wang, en tournée à travers les Antilles, et sur les côtes du littoral américain, ne demeurerait à Port of Spain que huit jours.
Nous fûmes exacts au spectacle.M.Peter Boom était fort réussi avec son masque enfariné.Mlle Letchy évoluait vertigineusement au trapèze.Les loges peuplées d’Anglais du Service, visages de brique sur la blancheur des plastrons ; les stalles inférieures, où s’entassait une population hybride de noirs, de sangs-mêlés, d’Hindous et de coolies, applaudirent frénétiquement.Les nègres hurlaient leur enthousiasme pour Miss Carolina et son large cheval pommelé, en ce jargon mêlé d’anglais et de créole qui fait une si curieuse rumeur de volière.Mais Jérôme Carvès et moi avions une idée, la même.
Au premier entr’acte, nous sollicitâmes du policier noir, en vêtement bleu et casque à pointe, qui gardait l’accès des écuries, l’autorisation de voir M.Wang, le directeur.
M.Wang n’estropiait pas l’anglais comme le font bon nombre de ses compatriotes du Céleste Empire.Il était vêtu à l’européenne d’un complet gris et d’un chandail, portait les cheveux courts, mais ne renonçait pas aux lunettes d’or dont les cercles luisaient dans ses orbites jaunes.Il s’inclina fort poliment, sur la présentation de nos cartes, et nous considéra, sans mot dire, de ses yeux aux coins bridés.
Après quelques compliments et une vague promesse de signaler les mérites du cirque Wang dans une gazette européenne, qui n’altérèrent pas l’impassibilité de M.Wang, Jérôme Carvès attaqua la grande question.
— Il est permis de supposer, monsieur, que vous avez un bateau pour transporter votre personnel et votre matériel ?
Le Chinois s’inclina.
— Peut-on vous demander quelle est votre prochaine destination ?
Ces mots incroyables tombèrent de la bouche de M.Wang :
— Puerto-Leon, — articula-t-il.
— En ce cas, monsieur, — dit Carvès, sans rien perdre de son sang-froid, — sauvez-nous la vie.Prenez-nous à votre bord !
Le Céleste resta quelques instants silencieux.Puis il émit quelques observations sur la difficulté de prendre des passagers, personnes honorables, il n’en doutait pas, mais qui pouvaient n’avoir pas des relations des plus cordiales avec la police des ports sud-américains, si délicate en ce qui touche le transit.Carvès l’assura qu’il avait les poches bourrées de lettres d’introduction pour les plus hautes personnages de cette localité inhospitalière, et brandit un portefeuille, en témoignage de ses assertions.
— D’ailleurs, — conclut M. Wang, — c’est au capitaine Cupidon, commandant la Mariquita affrétée pour mon entreprise, qu’il faut demander son consentement.
De jaunâtres photophores éclairaient fumeusement le box aux relents de crottin et de sueur où M.Wang nous avait accueillis, la main posée sur l’encolure du cheval pommelé, dont la croupe, pareille à un vaste canapé gris, supportait le séant, les pieds satinés et la voltige de Miss Carolina, une de ces larges bêtes qui semblent nourries de sciure de bois, et dont la morne destinée est de tourner sur une piste poudreuse, dans le claquement des chambrières et l’infernal déchaînement des cuivres.
Pas un souffle n’ébranlait les roides parois de toile derrière lesquelles grondait la rumeur d’une foule. Le fracas de l’orchestre annonça que le spectacle reprenait. M. Peter Boom, la face ruisselante de fards que la chaleur avait fondus, passa près de nous, indifférent et digne, dans ses larges braies jaunes et rouges. M. Wang nous conseilla de nous promener sur le South Quay un de ces matins : nous rencontrerions certainement le capitaine de la Mariquita et nous étions libres de nous entendre avec lui pour un passage. Puis il s’inclina, les mains jointes sur sa poitrine, et s’évanouit comme une ombre. Les Chinois ont cette remarquable propriété d’apparaître et de disparaître, sans que leurs déplacements intermédiaires soient sensibles. M. Wang, un instant matérialisé devant nous, s’était résorbé, nous laissant en tête-à-tête avec la grosse haquenée caparaçonnée de velours cramoisi.
Nous ne revîmes le personnage que sur le pont de la MariquitaLe capitaine Cupidon, rendu fort obséquieux par quelques billets de dix dollars, ne fit pas de difficultés pour nous accepter à son bord.Il n’y mit qu’une condition : nous apporterions nos vivres.Il fallait prévoir, par bonne brise, cinq à six jours de traversée, et peut-être davantage, par temps calme.Nous nous lestâmes en conséquence de biscuits et de conserves.
Nous nous embarquâmes par une de ces belles nuits veloutées dont seuls ceux qui ont passé la Ligne peuvent imaginer la splendeur.Trinidad reposait sous les palmes.La sombre silhouette des volcans s’infléchissait sur un ciel pailleté d’astres.Un remous phosphorescent caressait la pointe extrême du wharf.Les feux des navires à l’ancre agrafaient d’or ou de rubis le bleu noir de la rade.Un fanal vert indiquait la passe.Un feu bleu et un feu rouge se balançaient à quelques centaines de brasses.
— La Mariquita, — indiqua notre hôtelier qui avait tenu à surveiller lui-même l’embarquement de nos bagages, — un joli bateau, ma foi !vous avez de la chance !Son capitaine est un bon marin.L’air bonasse, mais ne vous y fiez pas trop.Tous ces moricauds sont les mêmes.Tout le monde connaît papa Cupidon de la Pointe à Santiago de Cuba, mais personne n’a jamais su de quoi il remplissait sa cale.Enfin, ça n’est pas notre affaire et, personnellement, je n’ai eu qu’à me louer de lui.On dit que les Hollandais de Surinam l’ont à l’œil.Mais il ne faut pas croire tout ce que disent les mauvaises langues.S’il a fait affaire avec le Chinois et tous ses saltimbanques, c’est qu’il a son petit profit, vous pouvez m’en croire.Bon voyage donc, messieurs !Vous êtes en bonne compagnie et vous ne vous ennuierez pas en route.
Le capitaine Cupidon, en bras de chemise, accoudé au bastingage surveillait le chargement.Des nègres à demi nus agitaient des torches crépitantes.Des corps sombres se mouvaient dans la rouge lueur ; des bras se tendaient, des nuques se roidissaient sous les fardeaux.C’était un spectacle farouche.Les hauts bordages goudronnés du navire pesaient sur notre canot comme des falaises.Et tout là-haut, par-dessus la fine ramure des vergues de perroquet, le feu du grand mât oscillait parmi les astres immobiles.
Cupidon nous pressa sur son cœur et nous frappa dans le dos de sa large et courte patte.Nous étions déjà de vieux amis.Nos hamacs furent placés à l’arrière, un coin du pont ayant été réservé pour nous et nos bagages.Les deux seules cabines du bord avaient été cédées aux femmes.D’ailleurs c’étaient des réduits inhabitables, à température d’étuve et saturés d’odeurs nauséabondes.Il fallait cette nuit-là renoncer à dormir.Le premier chalutier s’éloigna ouvrant un chemin de phosphore.Deux autres vinrent le remplacer et nous vîmes tour à tour s’élever, sanglés de cordages, dans le rougeoiement des torches, les silhouettes apocalyptiques du cheval gris de Miss Carolina, et des kangourous calculateurs de M.Van Sleep.
Le pont étant mal éclairé, nous ne pûmes distinguer les visages des autres passagers qui arrivèrent à la nuit avancée.L’impondérable M.Wang avait naturellement surgi, le premier de tous.Une dizaine de personnages, plus semblables à des fantômes qu’à des créatures de chair et d’os, se découpèrent en ombres chinoises sur l’écran étoilé de la nuit.Quelques lits de sangle avaient été dressés, des hamacs ; un campement s’installa à l’arrière du navire auquel le jusant imprimait déjà sur ses amarres, un obscur balancement.
Le chargement s’achevait. Pièce par pièce, le cirque emplissait le bateau : gradins, portants, accessoires de toute sorte, caisses de costumes, instruments de musique, tout disparaissait dans les flancs obscurs du navire. Le feu rouge du dernier chalutier glissait vers Trinidad. Un canot se détacha du bordage. L’un des passagers, mince figure vêtue de sombre, agita le bras en signe d’adieu. Du canot une voix grave s’éleva. Je distinguai des mots espagnols : « Vaya usted con Dios ! » Un bruit de rames. Le silence.
La Mariquita demeurait seule, chassant sur ses amarres, car le flux était plus fort. Vers l’Est, la mer irradiait une vague lueur, et sur cette bande de clarté, les cocotiers du rivage se dessinaient en noir.
Un commandement retentit.Les hommes d’équipages à leur poste !« Han, hisse », les drisses grincèrent.La voile de misaine se gonfla sous la brise matinale.Le navire, craquant dans sa charpente, eut une profonde contraction musculaire.
La Mariquita filait vers les fanaux verts de la passe. Le vent nous favorisait. Le capitaine Cupidon nous engagea hardiment dans la Boca Chita, la plus étroite et la plus dangereuse de ces Bouches du Serpent qui donnent accès à la baie de Port of Spain. Nous gagnions ainsi quelques milles. Nous effleurâmes le récif de « Madame Téterond », dont la masse brise l’assaut clapotant des courants, aussi rapides que les eaux bouillonnantes et noires de la Pointe du Raz. La Mariquita avait mis toute sa toile et, sous la pression de la brise s’inclinait légèrement vers babord, ouvrant de l’étrave la mer rosée par les premières lueurs de l’aube. L’eau se déchirait avec le sifflement d’une soierie où mord le ciseau. C’était mon premier voyage à bord d’un voilier. Mon être s’identifiait avec le souple organisme du navire, grisé par cette course vers le large, sur cette immensité embrasée de vapeurs rouges et orangées qui soudain se déploya devant mes yeux.
Le pont baignait dans une irradiation sanglante, une barre de cuivre luisait comme rougie au feu ; les corps des passagers roulés dans leurs manteaux, quelques-uns étendus sur des matelas, d’autres dans les hamacs, se revêtaient d’une gloire tragique.Je songeais aux corsaires qui, jadis, sillonnaient les mêmes flots et cinglaient aussi de la Boca Chita, en quête de bonnes prises d’épices, de poudre d’or ou d’esclaves.Trébuchant à travers l’encombrement des caisses, des bagages, des filins enroulés, je me dirigeai vers l’avant.L’homme de barre, les deux mains à la roue, m’apparut dans cette grave et fière attitude du gouvernail, tout empourpré d’aube, lui aussi.C’était un beau gaillard, à la peau sombre, le torse nu, une ceinture rouge retenant le pantalon de toile ; un foulard s’enroulait autour de son front, accusant la courbe du nez, la coupe allongée du visage, les méplats osseux.Il avait cette physionomie sévère et d’une cruauté hautaine qu’ont encore les rares descendants des tribus indiennes.A son oreille gauche pendait un anneau d’or.A mon approche, il ne détourna pas la tête.Je le contemplai quelques instants, me demandant si mon rêve ne se vérifiait pas mystérieusement et si je n’avais pas devant moi, en chair et en os, un de ces boucaniers qui écumaient jadis la mer des Caraïbes.Ce n’était, je le sus quelques heures plus tard, qu’un matelot indien, Pablo, le plus débrouillard de l’équipage.
J’offrais mon visage aux embruns qu’éparpillait autour de moi la vive allure du bateau.Une clarté, qui semblait jaillir des profondeurs sous-marines, s’étalait maintenant sur la mer et sur un grand espace d’horizon.C’était un frémissement argenté et pâle comme si l’eau eût reflété un second ciel intérieur.Puis cette clarté convergea au foyer d’une lentille.Un trait de lumière fusa, cri de l’océan ; un geyser de platine incandescent jaillit de cette masse miroitante et lourde.Un golfe, aux rives déchiquetées, élargissait à l’horizon un mirage de palais enflammés, de portiques de rubis, d’alpes opalines, de lacs d’un vert si translucide qu’on pouvait à travers leur diaphanéité découvrir des perspectives étonnamment lointaines et l’autre côté du monde.Et sur cet embrasement, la ligne noire de la mer se tendait comme une corde.Derrière moi, levant la tête, je vis le feu jaune du grand mât vaciller sur un vaste disque pipermint.
Ce déploiement de magnificence aurorale n’était sans doute qu’une des fantasmagories du dieu malin, auteur du rêve étrange que j’étais en train de vivre. Etait-ce bien moi, Jean Loubeyrac, Périgourdin, accoudé au bastingage de ce singulier navire, en compagnie d’un cirque ambulant et d’un équipage de boucaniers, en pleine mer des Caraïbes, à deux mille lieues et plus de ma bonne terre de la Pimousserie, sur laquelle le soleil ne se levait pas aujourd’hui en même temps que sur ma tête ? Il me semblait que j’avais été soudain projeté par un boulet de canon hors de mon espace et de ma durée, et qu’après un étourdissement léthargique, je me retrouvais, tâtant mon crâne et mes membres, doutant de ma propre réalité, ayant perdu le sens du temps et celui des distances, incertain encore que le vrai Loubeyrac ne fût pas resté là-bas, sur les bords de la Dordogne ou dans le paisible appartement de la rue du Cardinal-Lemoine, en des zones tempérées et civilisées, tandis qu’un « double » capricieux et incohérent hantait les planches de la Mariquita et voisinait avec les collaborateurs du subtil M. Wang et du jovial Cupidon.