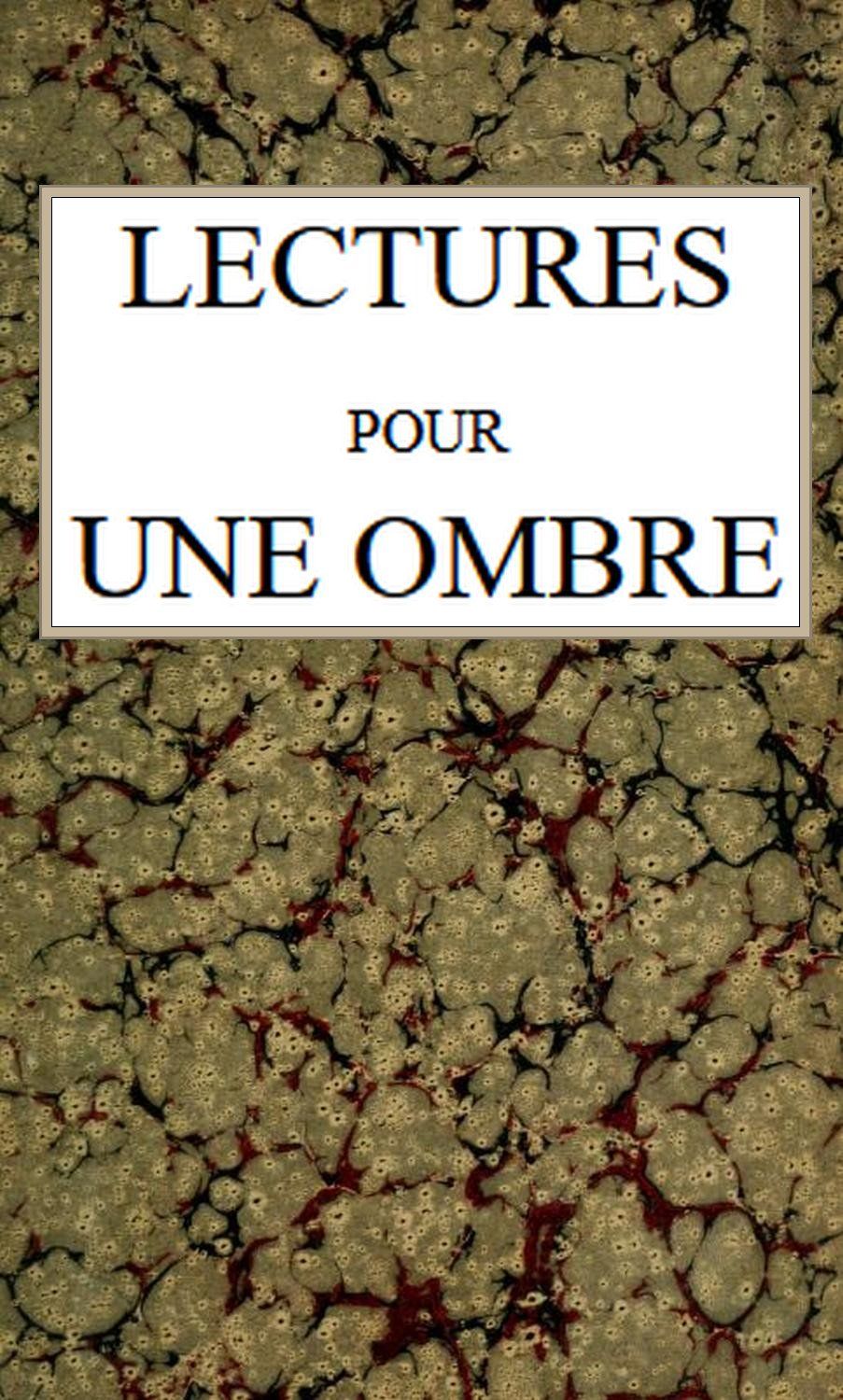Lectures pour une ombre
Play Sample
⁂
Maintenant le ciel est bleu et nous avons chaud.Le soleil a tenu à sécher, avant toute autre, la rosée tombée sur les soldats.Les groupes d’amis se reforment, et le bataillon s’amincit là où les hommes sont le moins bons ou le moins tendres.On organise une corvée d’eau, et nous attendons son retour, car on a distribué du coco, la main pleine de poudre dorée, inoffensifs.Les Allemands, depuis quarante-cinq ans, espéraient cette minute.
Trois obus, si inattendus que personne ne songe à avoir peur.Le premier tombe avec tonnerre au milieu même de la route, découd le régiment en files de deux hommes, et chacune s’enfonce dans son fossé; le second, moins bruyant, éclate en globes de feu; le dernier répand une odeur intolérable, tous trois différents et prétentieux dans leurs effets, comme si nous allions, sur nos carnets de route, consacrer une remarque spéciale à chaque obus allemand.En voici trois autres.La peur que l’on a à la chasse quand les perdrix au lieu de fuir volent sur vous.En me retournant, je vois les deux mille têtes claires se rabattre, à part une là-bas qui de loin me regarde, pour que je n’oublie pas, même une seconde, ce qu’est un visage d’homme: c’est un masque avec deux yeux et leur regard, deux lèvres, une oreille. Trois obus encore; le visage s’est rapproché, il est barbu, le front est bas et borné. A chaque salve, il se transforme ainsi et erre, noble ou stupide, sur ces milliers de corps décapités. Tous les officiers ont mis pied à terre, arrivés qu’ils sont à cette guerre depuis si longtemps attendue, et Michal, radieux, car c’est lui qui nous a guidés là, rejoint pour toujours ses télégraphistes. On rit, on bavarde. Ceux qui demandaient seulement à ne pas être tués par le premier obus affectent une joie définitive. Les plus peureux retrouvent leur tête dans leurs mains, la recollent, le képi sur elle, et allongent un coup de pied à nos chiens qui courent ahuris au milieu de la route libre, roulant par intervalles une énorme casserolle. Dans nos fossés nous nous asseyons, nous prenons nos aises; ceux qui mangeaient un œuf dur, enfin l’achèvent, et nous pourrons aussi, toute la matinée, à cause du coco, lécher la paume de nos mains. C’est, un moment, la guerre de tranchées, de deux tranchées verdoyantes perpendiculaires à l’ennemi; guerre naïve, où il n’y a point encore ceux qu’agacent les obus qui n’éclatent point, ceux qui préfèrent les percutants, et ceux aussi dont les voisins sont toujours tués; guerre supportable, car soudain c’est fini. Les plus braves, les plus rhumatisants se lèvent les premiers, se secouent, et nous sommes bientôt tous debout, bavards, un moment embarrassés de nos armes comme si nous n’en avions plus besoin, et comme nous le serons, ô mon camarade, le jour du retour.
Nous ne sommes pas de l’avis de ceux qui prétendent ne rien voir à la guerre.Nous voyons tout.De la crête où nous attendons les ordres, nous voyons un large pays ovale, et la bataille pour Paris se livre dans un champ vide qui a sa forme et sa taille.A perte de vue, une terre déjà dépouillée de son blé, ondule, jonchée de gerbes dont chacune semble garder d’avance la place d’un blessé et nous nous réjouissons de les voir comme un marin soigneux les fausses épaves distribuées avant le combat dans la mer.Sur notre gauche, un peloton de dragons qui patrouille, comblant l’espace qui sépare l’armée de la Manche, et que nous prenons alternativement, alerte également vive d’ailleurs, pour des uhlans ou pour notre état-major.Sur la droite, des régiments encore mal déployés, compassés et raides dans un uniforme de dimanche, et dont le principal souci semble être d’empêcher un cheval échappé de passer à l’ennemi.Les routes sont abandonnées, soudain trop sonores ou trop fragiles; on les traverse en courant, sur la pointe des pieds.De gros nuages blancs demeurent au ras de l’horizon et le champ de bataille semble matelassé.
Sept heures.De chaque compagnie s’écartent maintenant des hommes qui nous prodiguent les encouragements et nous crient au revoir.Nous n’avions pas eu à distinguer encore, dans notre régiment, entre ceux qui vont et ceux qui ne vont point au combat.Le lieutenant-adjoint s’éloigne, Bardan s’éloigne, l’officier des détails, la guerre devient décidément une chose d’ensemble, s’éloigne.Le petit bois auquel nous nous adossons, laisse passer, tamis fantasque, les secrétaires maigres, leur gros sergent.Nous leur en voulons un peu de nous avoir caché pendant cinq semaines qu’ils nous abandonneraient au premier obus.A chaque homme qui part, c’est, sur notre tête, à cause des moyennes, les chances de mort qui se resserrent, et c’est aussi, en nous, notre mission de combattants qui se révèle.Nous voici seuls.Guerriers que nous sommes, à l’entrée de l’arène, nous sentons une minute notre métier aussi précis que le sentaient les gladiateurs; nous nous sentons braves ou effarés, souples ou malhabiles.Tous paresseux déjà comme des boxeurs, des coureurs, comme des professionnels enfin, affalés dès qu’on ne réclame plus notre énergie et la terre ne nous redonnant notre force que si nous nous étendons. Surprise aussi de trouver là ceux qu’on emmenait en Allemagne, certes, mais pas au combat, le petit Dollero, pâle, distrait, qui tient maladroitement son arme, qui est subitement mal sanglé, et trois ou quatre paraissent ainsi habillés de défroques, munis de fusils trop longs, de baïonnettes trop courtes, au milieu de leurs camarades soudain vêtus et armés sur mesure. Tous sérieux, car ce qui était hier sans raison ou sans conséquence est aujourd’hui question de mort; les premiers d’escouade se sentent les premiers à recevoir les balles, les soldats du milieu sont obligés de faire la guerre entre des barrières de soldats vivants, guerre sans aise. Chacun manœuvre sa pauvre unité isolée avec, dans le cerveau, de pauvres phrases instinctives, des formules toutes faites de grand général: en protégeant sa gauche, en préparant ses vues, et on a le corps gêné comme une armée. Les sections les plus amies observent durement leurs distances. Seul Jeudit, l’agent de liaison, continue à bavarder, enthousiasmé des trois cartes-lettres qu’il a reçues ce matin, et à répéter que la plus belle invention c’est la poste. Personne n’a le cœur de prendre contre lui la défense de l’imprimerie, de la vapeur, du kaolin. Des adjudants lui crient de rentrer dans le rang.
—Je suis le colonel, répond-il.
Ils ricanent:
—Ah!tu es le colonel!
Il est du colonel la plus modeste part, celle qui copie les ordres sur deux feuillets blancs reliés par une épingle.Ce ne sera pas sans danger de les avaler, s’il est pris.Celle qui lui dit l’heure, non sans l’impatienter parfois, car la montre de Jeudit est dans sa cartouchière et cela lui coûte au moins une cartouche de chercher la minute exacte.C’est la meilleure place; d’instinct nous nous rapprochons tous de celui qui, dans la compagnie, passe pour avoir de la chance, la porte sur son visage, n’est pas myope, n’est pas trop gras, et a, autant que peut l’avoir un homme qu’on ne connaît que de vue, l’air immortel.Ignorant que notre soldat immortel est Verdier,—le seul, après trois ans de guerre, qui n’ait été ni blessé ni évacué, nous confondons le destin du régiment, pour une journée encore, avec le destin du colonel.Chacun s’approche de lui dès qu’il le peut, comme d’un abri, et souvent dans la journée un soldat inconnu se joint à son groupe, silencieux, prévenant; c’est un soldat qui depuis un moment, et pour un moment seulement, ne tient pas à mourir.
Mais voilà le cycliste qui apporte de la brigade des feuillets légers qui s’envolent; nous courons après eux; l’état-major du régiment poursuit une minute ses ordres comme les grands poètes leurs pensées, en enjambant des haies, en secouant des branches, en bousculant des capitaines. Nous avons à laisser avec l’artillerie les compagnies, et à avancer avec les cinq autres par Saint-Pathus vers une côte. Les ordres complémentaires nous rejoindront là-haut, et tout le dimanche, d’ailleurs, ils nous arriveront ainsi à chaque point culminant pour ressembler davantage à l’inspiration. Ordres secs, déclinant aujourd’hui tout jeu ou toute sympathie avec les noms de la carte, ne nous recommandant plus, comme pendant les marches ou les exercices, de passer par l’Y de Vincy, de nous loger entre les deux parts d’un nom composé, Croix-Blanche, Grand-Puis... et aussi nous sommes arrivés à un rectangle de la carte où les noms, poussés par un même vent vers la droite, laissent un grand espace vide. Nous le voyons, la côte gravie. C’est le même champ jaune et ondulé, coupé à contre-sens par des routes qui y conservent le plan de quelque bataille de l’Empire et que nous évitons avec soin pour rester dans notre guerre.
Dans Saint-Pathus, un seul habitant, le maire, qui nous guide à la Thérouanne, nous expliquant combien sont illogiques les limites de sa commune puisque là, à vingt mètres de l’église, c’est déjà Oissery et que l’ombre du clocher séjourne dans la commune concurrente. C’est moins grave d’ailleurs que si c’était l’ombre de la mairie. A Oissery, un vieillard, qui veut savoir de nous le poids de la balle allemande, le fonctionnement des canons allemands; si c’est un espion, c’est un espion français. Nous allons lentement, les obus éclatent à longs intervalles, la bataille, comme parfois dans les cinématographes, reste une heure entière au ralenti. Parfois, elle reprend sa vraie vitesse, parfois elle la dépasse, comme à Bregi où nous tombons dans un camp de hussards ennemis, que nous essayons vainement de poursuivre. Ils étaient occupés à distribuer leur courrier et l’on apporte au colonel les lettres du colonel allemand. Nous recueillons cent selles: la pensée que tout un escadron prussien se meurtrit en ce moment ne nous est point désagréable.
Les obus maintenant éclatent juste au-dessus de nous toutes les dix secondes, hauts, peu dangereux, et c’est une suie brûlante qui tombe sur les épaules dès que nous nous levons pour avancer.Nous ramonons un zénith étincelant.Les sections font leurs bonds réguliers; tantôt elles nous dépassent, tantôt nous les dépassons, et voyons, au coup de sifflet, tous ces corps se soulever, presque horizontaux, tirés par leurs visages pâles, et tomber, vingt mètres plus loin, quand la tête devient trop lourde. Ils passent avec leur bruit de bataille, mais, une fois étendus devant nous, nous n’apercevons d’eux, sur le sac, que le moulin à café, la lanterne, une vraie casserole, tout ce qu’ils portent de domestique ou de paisible. De temps en temps, une odeur de menthe, et l’on reconnaît ainsi ceux qui ont brisé leur flacon d’alcool pendant la charge. De temps en temps, des amis; voici Sartaut, voici Jalicot, et, comme s’ils avançaient en rimes, avec Lorand, avec Parent. Parfois un traînard a perdu sa baïonnette, son porte-monnaie aussi, et le colonel l’encourage:
—Comment t’appelles-tu?
—Malassis.
—Allons, avance.Quel est ton sergent?
—Mon sergent est Goupil.Mon lieutenant Bertet.
Quand on leur demande leur nom, ils donnent tous un nom extraordinaire qu’ils vont chercher dans le moyen-âge.A partir du grade de lieutenant seulement, on est sûr d’obtenir un nom un peu moderne.Voici les balles.Nous en avons entendu une en Alsace, elles nous surprennent moins. Nous nous déployons et les hommes se bousculent vers les gerbes éparses, presque toujours vers la même, comme si de loin une seule paraissait sûre, s’éparpillant ensuite, à regret, vers les voisines. Pas de blessés encore. Il nous semble parfois que celui-là est tombé bien durement, que celui-là gémit; nous attendons avec angoisse le départ, mais, au coup de sifflet, les corps suspects se relèvent comme les autres. Rien n’encourage plus qu’une résurrection. Le colonel rit. Les hommes rient. Parfois, un obus n’éclatant pas, on sent possible que personne ne soit tué. Parfois, à force d’espoir, on sent qu’on recule l’heure du premier tué. Puis, subitement on aperçoit là-bas un groupe qui se forme, et l’espoir tombe.
C’est moi que le colonel envoie chaque fois vers ce remous; il n’a plus confiance qu’en ma chance pour dissoudre, sans qu’il ait à perdre son premier homme, ces énormes taches violettes, et jusqu’à midi j’y parviens.C’est une énorme fourmilière.C’est un cheval mourant.C’est un mort, le premier que voit le régiment, mais c’est un des hussards de Gneisenau.C’est un autre mort mais—le dernier et le plus égoïste de mes efforts—c’est un mort de la brigade, couché au-dessus d’un blessé sur lequel l’a projeté l’obus.Personne n’ose les dégager, comme s’il s’agissait d’un crime. Un ou deux soldats se découvrent. D’autres, après avoir plaint le mort, consolent le blessé qui leur sert de transition pour leur retour à la vie, et lui demandent comment le mort s’appelle: il ne peut pas le voir, il croit que c’est ce pauvre Blanchard. Est-il barbu?
⁂
C’est au tour du régiment maintenant et la chance n’a plus à choisir qu’entre nos deux bataillons.
Un dernier recours.Au fond du vallon, un ravin, planté d’arbres dont les têtes émergent à peine, qui sépare le champ de la route.Tout le régiment s’engouffre dans cette tranchée d’ormeaux.Les camarades se rejoignent en riant, essoufflés, et bavardent si haut que les officiers, comme aux manœuvres, les menacent de repartir aussitôt.Long repos.Des hommes essuient les baïonnettes, et les agents de liaison en plus taillent leurs crayons.On distribue des boîtes de thon, on fait circuler le cahier de visite sur lequel les soldats qui ont mal au pied, aux dents, s’inscrivent en plaisantant, car il n’est aujourd’hui qu’un cahier de réclamations contre les maladies et l’on ne verra pas le major.De petites maladies civiles reparaissent un peu et font les importantes dans cet angle mort protégé des balles. Bertet m’apporte un livre qu’il a trouvé à Bregi et veut que je le lui traduise aussitôt: c’est une traduction allemande de Gongora, ce sera pour demain. Un caporal montre à tous une entaille qu’il a reçue au poignet, et le colonel le félicite; si le régiment faisait la guerre au premier sang, nous n’aurions plus qu’à revenir à Roanne. Des yeux épurés, des lèvres plus fines, des paroles moins grosses, car tous sentent que l’on gagne à présenter aux obus l’âme et le corps le moins pondérables. Entre les sourcils, des rides tirées et entremêlées comme des initiales. Des visages dont on aspire toute la force si on les regarde en face et qui se détournent de vous. Des hommes à menton rond, aux yeux bien horizontaux, les grands blessés de ce soir, et qu’on ne peut consoler encore que des maux les plus minimes, de leur coup d’air à l’œil, de leur ampoule au pied. Sur les lèvres des plus distraits, comme sur les lèvres de tant de tués, une cigarette se consume jusqu’à les brûler.
Deux heures, ordre de repartir en avant.Nous quittons le ravin avec peine.Obscurément, nous ressentons ce que cela signifiera, de sortir de sa tranchée.Tout ce qu’éprouveront plus tard les troupes d’assaut, nous l’éprouvons; et un peu plus cruellement même, car nous avions dans cette première tranchée des arbres, de l’ombre, et, bordant le ravin, au lieu du gazon ou de la terre molle, c’est une route empierrée qui nous reçoit si dure! Au-dessus de notre masse, tous les noms propres, subitement éveillés, voltigent de l’un à l’autre. Puis, chaque nom se pose et nous gravissons la pente. Les nuages blancs se sont élevés: l’horizon est libre pour un combat sans limites; et dans les champs derrière nous personne, que les juments du colonel, qui s’échappent, mal retenues, mais se réunissent dans leur galop afin que le colonel, pour toutes deux, n’ait qu’un souci.
Sur la crête, nous attendons, car notre artillerie n’allonge pas son tir.Une dernière fois, je vois mon régiment avec ses manies, son lieutenant Bertet, debout, que les soldats essayent vainement de faire étendre près d’eux, mais dont la pensée, aujourd’hui, est verticale, son capitaine Perret, toujours discutant, forçant ses hommes à apprendre sous les obus les noms des villages en vue et à se répéter, avant les commandements du feu: «le village à droite est Puisieux, le village en face est Vincy, le village du fond est Douy-la-Ramée, supprimez la Ramée, cela complique», avec son lieutenant Viard, qui, incapable de se taire, affecte de ne pas reconnaître les arbres, et questionne son sous-lieutenant, colonial agacé:
—Ce sont des ormes, là-bas, des chênes?
—Des palmiers, mon lieutenant.
—Je vous parle des grands arbres derrière ces arbres bizarres, des peupliers, je crois?
—Des mancenilliers.
Il va se fâcher, mais voici, comme prétend Artaud, qui n’a jamais pu retenir le vrai chiffre des calibres, les 79, les 131, et voici, l’émoi lui fait cette fois trouver le nombre juste, voici les 210.
⁂
C’est Dollero qui me reçoit dans le ravin, pauvre petit poète angoissé, bien vide d’images, de métaphores; cela le maigrit.Un cheval broute les acacias.Des officiers relisent leurs dernières lettres, les gardant à la main comme un rôle.Pauvre coulisse de la guerre.Des soldats s’examinent dans de petites glaces et c’est, cette fois, pour trouver des taches de sang sur leur visage; parfois un homme bondit du dehors, et s’assied, son emploi sur la scène fini.Tout cela dans un parfum fade et doux, car je ne sais quel imbécile brûle du papier d’Arménie.
C’est fait.Voici le premier.Deux soldats l’adossent au talus, et, près de lui, le second, tout petit.Ils le déplacent, ils le secouent, tassent en lui pour la dernière fois ce qui est humain. Ils cherchent sur son visage une ressemblance qui déjà commence à leur échapper, et au moment où ils le reconnaissent le plus, se découvrent. Pour le plus petit, en se courbant un peu plus, en s’attendrissant, ils répètent tout ce qu’ils font pour le plus grand, et raccourcissent peu à peu leurs gestes, comme s’ils avaient pour dernier but d’enterrer avec perfection, troisième tué, un enfant. Le sifflet résonne, ils rompent le faisceau, se retrouvent avec deux armes en plus, car ils l’avaient formé avec les deux fusils des morts, et les posent à la dérobée sur un faisceau voisin. Puis ils s’en vont, et il ne reste, avec Dollero, que le cheval égaré, qui s’approche, flaire, qui s’éloigne, renonçant à comprendre la mort des fantassins...
Un tué...Ma guerre est finie...
DARDANELLES
A notre droite Marmara se vidait; à gauche, le golfe enflait.Sur le bateau qui tient la ligne entre cette mer qui descend et cette mer qui monte, serrés les uns contre les autres, sur notre presqu’île, nous dormions.Mes voisins étaient les deux frères jumeaux; si je m’éveillais j’avais la consolation de croire que tous les Français sont semblables.La guerre, alors, paraissait anodine; il suffisait que l’un d’entre nous fût sauvé, un seul, et, quand je refermais les yeux, l’idée venait aussi, apaisante, d’un enfant unique, d’une femme unique.Pour vous donner un instant le sommeil du premier homme, la France, à cette distance, se simplifiait.Mais, soudain, la même main criminelle allumait à la fois, chacun sur un continent, l’aurore, l’aube et, du côté de l’Arménie, le petit jour.Les étoiles tombaient.Deux oliviers d’argent, vieille habitude des cinémas, agitaient entre les lignes les débris d’un feuillage immortel. Alors le soleil se levait.
Il se levait au-dessous même de nous, sous notre képi, sous notre sac et je savais désormais ce qu’eût fait chacun de mes hommes s’il avait reçu en cadeau le soleil même.Baltesse le pétrissait, le roulait dans ses mains: Riotard le posait sur sa tête, l’équilibrait, le reprenant quand il rebondissait.Soleil carmin, sur lequel tout prenait feu et auquel se piquaient nos regards devenus rayons tout à coup...Nous les y laissions.Séduite par nos armes, par nos gamelles, une alouette planait sur la tranchée, suivait chaque retrait, chaque saillant: il n’y avait, du poste turc, qu’à dessiner son vol pour connaître notre abri et repérer surtout, pires ennemis du prophète, ceux des Français qui usent d’un miroir.Sur la côte d’Asie chaque couleur s’étalait après l’autre et mon caporal, qui était des Beaux-Arts, criait et réclamait quand revenait la même.Chaque rocher noir, chaque cyprès bordé d’or, n’était plus qu’un tampon appuyé contre une des sources du jour.Une lumière plus lourde que l’eau tombait peu à peu au fond du Détroit, et l’on y voyait les mosquées en équilibre sur leur minaret, les platanes retournés pour mesurer le temps ou la saison, on comprenait l’Orient...Mais déjà, sur la gauche, les peuples qui se lèvent tôt attaquaient, et des régiments de Sidney, surprenant les Kurdes, les exterminaient sans merci, car le Turc est l’ennemi national de l’Australien.
C’était la relève.A la jonction de la ligne anglo-française les agents de liaison cessaient d’échanger leurs timbres-poste et le raccord, sans ce papier gommé, devenait à nouveau précaire.Nous redescendions par les collines, nous heurtant, dans les couloirs, aux Bambaras, aux Peuls, à des yeux sans gloire, à toutes les images les plus brouillées et les plus ternes de nous-mêmes, car notre divisionnaire, stratège habile, faisait soutenir la nuit par ses soldats blancs et la journée par ses nègres.Tout l’éclat, tout le vide que les plus grands poètes, dans nos pays, ne soupçonnent qu’en s’étendant sur le dos au centre d’une prairie bombée, nous l’avions dans le boyau même.Tristes soldats que nous étions, voilà trois mois, quand il nous fallait partir en patrouille et risquer la mort pour apercevoir, entre deux mottes, la pointe du clocher de Nouvron!La mer dessinait sur les flancs de la presqu’île ces lignes parallèles qu’elle ne fait que dans les bonnes cartes.Nous descendions, remontant d’un geste le soleil à nos bras.Pour ceux qui n’aiment pas, dès le matin, voir un continent entier, des îles.Dans le golfe pourpre, les navires anglais; dans les Détroits, les français, qui préfèrent les eaux dorées.Nous reconnaissons le Henri-IV, avec sa plage à l’arrière, le Châteaurenaud, immobile, maquillé de fausse écume à l’avant pour que l’artillerie turque le crût lancé à trente nœuds, et les contre-torpilleurs, entrés jusqu’à Yenikeuï se laissaient, au lieu de tourner, dériver lentement.Selon notre marche, Ténédos, à l’horizon, se déplaçait, s’ajoutait à chaque autre île comme l’article à son nom, et parfois, douce inversion, suivait Imbros, suivait Samothrace.Entre sa colline d’oliviers et sa colline de cyprès, le camp s’agitait et chaque oiseau aussi avait des ailes différentes.Des quatre pylônes s’élevaient les ramiers, qui volaient par trois, et les geais qui volaient eux par couples, comme si l’Amour, dans cette heure matinale, confondait encore ses symboles.Celles des cigales qui seraient nées ce matin-là, les arbres de la plaine coupés, s’élevaient d’abord, ambitieuses, à la hauteur d’un pin, ne trouvaient pas...à la hauteur d’un olivier, retombaient alors et mouraient.Mais déjà nous parvenaient les sonneries des chasseurs d’Afrique, en rade depuis quinze jours, dont les trompettes sonnaient sans relâche pour que les chevaux, sur le pont, prissent patience.
Toute l’armée était là, entre ces pentes chauves maintenant de leurs jeunes seigles et de leurs jeunes orges, les cadets, dans ces dix hectares que franchissaient à toute heure, avec leur serviette, comme ils enjambent la France jusqu’à Nice, des Anglais qui allaient au bain. Ces chevaux mordorés, là-bas, étaient les chevaux trop blancs des spahis, maquillés sur ordre au permanganate, et, campés à l’embouchure, ils avaient donc, privilégiés, le droit de boire tout ce qui leur arrivait du ruisseau. Ce zouave avec des caisses sur la tête était l’ordonnance du colonel Niéger, qui portait au château les Tanagras trouvées par les sapeurs, et quand se rapprochait l’obus, qui demeurait debout, immobile, comme le torero déguisé en statue, en Espagne, quand le taureau le renifle. Ce Zélandais qui peignait son canon en tigre, pour qu’il eût l’air plus naturel, était celui qui m’expliquait hier ses manettes en répétant, au lieu du mot vélocité, le mot plus court, d’ailleurs, de volupté... De beaux aéroplanes apportaient à la division les poulets de Ténédos.
Tout ce que la guerre d’Europe s’était refusé était là, tous ceux que les ingénieurs, le siècle prochain, exileront et cloîtreront dans une île: les savants, les fous, les chasseurs.Il y avait le plus fameux entomologiste d’Irlande, que les Indiens, frères des fourmis, arrêtaient parfois comme espion, et la guerre dans le secteur anglais était dure aussi aux insectes.Il y avait les créoles de la Réunion, dont les adjudants, leur donnant à viser sans cesse Achi-Baba, voulaient en vain allonger, sur cette presqu’île, le pauvre regard circulaire.Il y avait le millionnaire accouru avec ses neuf chasseurs d’izards espagnols, armés de jumelles géantes, dont ils se servaient comme les Marocains du fusil, étendus sur le dos, et l’un prétendait toujours voir de la neige. Rien que des volontaires, ceux des Auvergnats et des Bourguignons qui ont toujours désiré voir Byzance, âmes simples, qu’on pouvait juger de vue comme avant le mensonge, les grands plus chevaleresques, les petits plus pratiques, les bruns plus passionnés. Il y avait Duparc et Garrigue, le trapu aux yeux vairons et le géant aux cheveux nattés qui, jadis, dans les sièges, s’offraient à pousser le bélier. Il y avait les deux gendarmes de Béziers qui, tout le jour, nous empêchaient de couper du bois, de dénicher les geais sous peine de procès-verbal et qui, le soir tombé, toujours pour la division, pêchaient eux-mêmes à la grenade. Il y avait Moréas, Toulouse Lautrec, Albalat. En conseil dans une tranchée ronde, les Turcs et les Grecs de la brigade s’occupaient à rédiger le petit dictionnaire pratique de l’entrée à Constantinople, et ne s’entendaient ni sur le mot «renard», ni sur le mot «immortel»... Ils se levaient parfois tous ensemble et réclamaient la croix de guerre.
Nous déjeunions. Nous avions un demi-quart de vin, un gigot frigorifié, un petit beurre. Ivres et repus, nous prêtions sans regret nos stylos aux camarades qui donnaient l’assaut demain et recopiaient, par impuissance à aimer mieux, leurs lettres de la dernière attaque.Hoffmann jouait de son piston de poche en pleurant,—il pleurait toujours en jouant, sinon nous aurions eu de la flûte qu’il avait dû abandonner, pour cette raison, dès le lycée—.Juéry faisait des vers, la tête au fond de la tranchée, les pieds sur le rebord, de sorte que toutes les mêmes lettres roulaient en lui par masses, et il ne lui est venu aux Dardanelles que des allitérations.Pour notre barbet, Garrigue rassemblait les tortues, les couleuvres orangées, les scorpions, mais ne lui présentant les monstres que séparément, pour qu’il ne crût pas à une seule bête trop puissante.Le sacristain de Sainte-Eugénie de Biarritz, qui devait mourir le premier, s’égratignait déjà à son fusil, et l’on cassait pour lui mon premier tube d’iode.J’en profitais pour offrir du laudanum.Désormais, tout avait servi de mes cadeaux du départ; rien que je n’eusse utilisé de la petite pharmacie, du bidon anglais, de la couverture mauve et rouge...tous mes amis m’avaient été utiles...je n’avais trompé la bonté d’aucun...je pouvais mourir.
Midi.Dans chaque vague, le soleil et une méduse entière.Dans chaque motte de terre, un mille-pattes étreignant le centre du jour.Le vent de Russie soufflait et nous couvrait de sable, à part les bras et les jambes que nous pouvions secouer.Au milieu de leur sieste, dans leur trou bordé de mosaïque, les Sénégalais faisaient ce que nous faisons à minuit, se retournaient en gémissant, appelaient leurs griots. La guerre assoupie, pour ménager son poing, ne frappait que sur ce qui est élastique, sur la mer, sur les vaisseaux, s’acharnait sur le bateau-citerne. L’Annam, le courrier, brûlait en rade, et jusqu’à nous flottaient des papiers noirs.Torpillé, le Triumph coulait, on entendait l’équipage, au garde-à-vous sur le pont, scander son nom.Le Détroit se bombait entre ses deux rives comme s’il pénétrait par son centre un énorme sous-marin.Tous les bateaux sifflaient l’alarme, toutes les sirènes résonnaient et, dans des tourbillons de lumière, les navires soudain aveugles manœuvraient avec plus de bruit et de précautions que dans le plus épais brouillard.Sur les mines dérivantes, les légionnaires faisaient des feux de salve.Au fond du golfe, à peine visible, le plus gros cuirassé du monde, agacé, s’enveloppait par intervalle d’une poudre dorée comme de leur pollen ces fleurs que le mauvais insecte approche.Comme des enfants réfugiés dans un orgue, nous dormions.
Mais Affre le juge, ruisselant de sueur, revenait du cap chargé de citrons doux.Il nous les offrait avec de fines allusions, car il a toujours confondu, même de vue, les Dardanelles et les Hespérides, et il nous emmenait au bain.Enjambant les coloniaux et les légionnaires étendus l’un contre l’autre, sans pouvoir faire, jusqu’à la plage, un pas moins étroit ni plus large qu’un homme endormi, nous arrivions à Myrto. Nous nagions, heurtant des nègres qui, alors, bons hippopotames, s’enfonçaient. L’œil au niveau du fleuve, tout ce que nous avions de notre ombre se réfugiait sur nos têtes et il eût suffi de plonger pour s’en délivrer à jamais.
Ainsi nous vivions sans trop vivre, sur des jours éblouissants et plats, et nous nous sentions si minces au-dessus de la joie entière, de la tristesse entière, et nous ne creusions pas non plus nos abris, car l’eau venait.La petite bosse du portefeuille aux lettres sous la capote, qui varie chez les soldats d’Europe comme le cœur chez les civils, était toujours chez nous constante et à peine visible.Aucun acte vil ou futile n’était imaginable, on était vu de toutes parts, et pas un geste permis qui ne pût être accepté par les dix peuples différents.Un monde inoffensif, insouciant, comme les mondes d’un seul sexe, et les historiens pourront, sans que leur récit en paraisse faux raconter nos exploits au féminin et laisser croire que les armées des Dardanelles étaient des armées de femmes.Soirs fabuleux.Les colonelles, alanguies par la fournaise, venaient se rafraîchir les mains au courant du Détroit comme on va, en Bretagne, se les réchauffer au Gulf-Stream.Un enfant de Miramas, seul rejeton de ces cent mille guerriers, passait de compagnie en compagnie,—enfant inventé,—pour qu’on l’admirât. Les Africaines déjà se glissaient hors de leurs trous vers les cimetières pour voler les galets des tombes et achever leur mosaïque. Les Françaises, auxquelles il paraissait tout à coup impossible qu’elles ne revissent pas une fois la gare du P. -L. -M. , qu’il n’y eût pas encore une fois dans leur existence du civet, du vouvray, rassurées sur leur sort, chantaient en chœur; et chacun de leurs fromages aussi, le brie, le levroux, le cantal, était pour elles une promesse de vie, et, logiquement, si elles raisonnaient, d’éternité. Les Australiennes fumaient, les manches de leur chemises relevées, ne pensant pas à l’avenir, mortelles...
O toi, je hais qui t’aime et je hais qui te déteste.Les fumées des cuisines venaient jusqu’à nous, mais, tapis au fond de la mer dorée comme au fond d’un terrier, nous résistions à leur parfum.O guerre, pourquoi ne te passes-tu pas en nous-mêmes, ou pourquoi, tout au plus, n’es-tu pas à quelques amis isolés, à quelques personnes nues, comme tu le fus soudain cet après-midi où tous les obus, au sortir du bain, ne tombaient que sur Jacques et sur moi.Nous ne pouvions avancer jusqu’à nos vêtements, nous étions allés à terre comme les lutteurs qui se savent résistants, Jacques parallèle au tombeau de Patrocle, moi perpendiculaire à Jacques, et tu nous forças à former, pour t’échapper, toutes les figures de l’amitié. Puis, stupides, les trajectoires agacées se tendirent, et, nous délaissant, les obus tombaient sur le camp pour y blesser Colomb, notre lieutenant, et y tuer le pauvre Coulomb, son ordonnance, car les gens du peuple qui portent nos noms, ou à peu près, sont tués pour nous.
⁂
Minuit...Les grenouilles du ruisseau turc répondaient à nos grenouilles dans un langage convenu, et je n’en comprenais que ce qui se rapporte au temps.Un canon d’Asie, plus étroit que le français d’un millimètre, l’attaquait avec furie, et, dilaté, s’apaisait.Chacun, sûr de sa mort, passait et confiait sa lettre d’adieu à son voisin de droite, immortel.
Journée de cire, journée lisse.Quel relief, quel soir de jeune femme en France appliquer contre toi, pour que renaisse un jour notre âme double, notre langage double...et, avec les taxis rapides, Paris.
Mai 1915.
LES CINQ SOIRS
ET
LES CINQ RÉVEILS DE LA MARNE
Dimanche, 6 septembre 1914.
Nous sommes là cinq depuis une heure, dans un champ de betteraves, mais jonché de gerbes portées à l’assaut et abandonnées.Nous les lions solidement, nous les bottelons, les dressons et c’est par les gestes du moissonneur que se termine, pour aujourd’hui, la bataille.Nous les rapportons, par instinct sans doute, dans les chaumes de droite, et attendons, nos ombres surveillées par la mitrailleuse allemande qui est dans l’arbre et qui les crible dès qu’elles sont immenses.Ombres immortelles.Là-bas aussi quelqu’un rampe, c’est un des sapeurs.Plusieurs de ses camarades sont à vingt mètres. Mais ils n’ont pas d’eau; ils n’ont que de la chartreuse.
Nous voici quinze ou vingt, car, à gauche, nous venons de découvrir encore quelques hommes.Désorientés, au lieu de se coucher face à la mitrailleuse, ils lui tournaient le dos; ils font le tour de leur meule en nous remerciant, ils se félicitent d’être dans le bon sens, mais de l’autre côté on voyait mieux, on dominait toute une vallée, on suivait tous les incendies.Autant qu’on peut reconnaître les villages dans la nuit, Puisieux brûle, Saint-Pathus brûle; je pense au pauvre maire qui est seul pour éteindre le feu.Sept incendies...Avons-nous un peu d’eau?Ils n’ont que de la liqueur Raspail.
Les nouvelles se répandent vite sur le champ de bataille, car de temps en temps un nouveau soldat rampe droit sur nous, la main devant le visage, se protégeant contre la mitrailleuse comme on protège une lanterne, et me rendant l’appel, de la gerbe où il se cache depuis la nuit, du chemin qu’il a parcouru: un mort, un Allemand, deux blessés.A chacun nous réclamons de l’eau, et il s’empresse de tendre son bidon, mais, dans sa bonne volonté, miracle aujourd’hui détestable, c’est toujours un fond de cognac qu’il nous donne, ou de menthe, ou de rhum.Tous ont encore, dernier reste de la charge, la baïonnette au canon. Une fois étendus près de nous, du geste innocent dont une femme enlève ses bagues, le soir, ils la détachent, puis reposent leur tête.
Il fait froid, mais quel repos!Les hommes fument, avec précaution, à cause de la paille.Un sapeur, masseur à Vichy, masse avec conscience ceux qui ont des courbatures; il a du succès, on le retient à l’avance, de gerbe à gerbe; il n’en va pas plus vite et s’amuse à dire à chacun le nom de tous ses muscles: le caporal est composé de muscles latins.Une meule brûle; mes voisins, paysans, discutent son prix; j’apprends ce qu’elle vaut au plus juste, et ce que vaut aussi une simple gerbe, celle qui m’abrite, par exemple.Nous goûtons les grains du blé, qui est excellent, et il paraît aussi que nous sommes sur une terre riche; des peupliers superbes, d’énormes betteraves, de belles récoltes, nous n’avions pas un champ de guerre de camelote.Quand on est paysan, cela donne plus de gravité, mais plus de calme aussi à la bataille.Le masseur raconte qu’il a vu le corps de Michal; une balle en plein cœur.Pauvre Michal!Pourquoi faut-il tenir cette nouvelle du masseur lui-même?plus d’espoir...Parfois le vent nous apporte des paroles allemandes.Parfois nous sentons que le champ nous devient favorable et des bottes roulent d’elles-mêmes comme si la campagne se détendait. Un soldat arrive debout, donnant soudain une plus grande hauteur à notre plafond, nous donnant à respirer. Un autre me reconnaît avec joie, crie: voilà le sergent interprète! et m’interroge avidement comme s’il avait attendu, pour le comprendre, que je lui traduise tout ce qu’il a vu dans la journée. Ceux qui savent parler ont déjà pris sur les autres l’avantage qu’ils garderont toute leur vie et racontent leurs aventures de l’après-midi, lentement, comme à la veillée. Appuyé contre mon épaule, Dollero écoute, sans faire un geste, ces phrases qui modifient son cœur même: son ami Bernard est mort; son cousin, quand les Allemands dans la nuit sont venus en se disant Anglais, s’est levé et est tombé. Puis la mitrailleuse, mieux réglée, effleure nos képis pour nous couper, habile, de nos ombres. Nous nous taisons, grisés par ces liqueurs qui circulent, bénédictine, kirsch, cognac. Nous appuyons nos lèvres contre le flacon, et le passons. L’alcool nous donne tous ses baisers. Les balles sifflent. En nous se forme le mot par lequel nous accueillerons la première; nous le sentons, tendu comme une riposte, la balle frappera juste dessus, et derrière ce premier cri, je sens aussi, pour les balles suivantes, disposés soudain par ordre, tant de noms propres!Je peux en recevoir une centaine, sans qu’aucune me trouve muet.Balles pour les amis, balles pour les villes, pour Nîmes, pour Fougères; et même aussi, pour les dernières balles se pressent de pauvres noms communs...Nous vous devons bien cela, maisons, fourchettes, stylos...Mais un cheval sans cavalier galope à notre droite, détourne les coups, et tire derrière lui, tristes sangsues, tout ce qu’il y a de meurtre dans l’ombre.
Maintenant des blessés nous appellent, au delà des peupliers.Le champ de bataille divague.Nous formons des patrouilles, puis nous tenterons de regagner un village.Les plus courageux font honte aux plus timides et ce sont ceux-ci qui partent en avant.Nous les entendons qui s’arrêtent près des blessés, qui parlent:
—Ne crie pas.Nous sommes là.Tu nous vois?
—Oui.
—Tu es rassuré.Tu n’as plus peur?
—Non.
Puis, de loin, nous entendons la voix même du colonel, qui répond, toujours avec ce rythme:
—Mon colonel, vous souffrez?
—Oui.
—Nous vous faisons mal, mon colonel.
—Non.
Et nous retirons tous ceux que nous pouvons, comme d’un incendie, en arrière de cette frange de France qui craque, qui fume.
Nous sommes partis.Tous les cinquante mètres nous donnons au colonel un peu de repos et nous relayons.Jeudit qui était resté étendu près de lui depuis sa blessure, le forçant à faire le mort quand les Allemands passaient, porte son képi, son sabre.Il s’occupe uniquement de sa tête pâle; il la soutient parfois de sa main, il fait un oreiller d’une musette qu’il remplit de foin; essuie son front, car il a chaud; le coiffe d’un bonnet, car il a froid; à son exemple, chaque soldat réserve sa sollicitude pour un bras, une main, une épaule, n’osant, dans sa modestie, s’occuper du colonel entier et lui, pour nous remercier, se divise aussi entre nous.
—Jeudit, mon cou!
—Dollero, mon bras!
Un gros paysan bégaye une phrase qu’il prépare depuis les gerbes.
—Tout va très bien, mon colonel, tout va très, très bien!
Le colonel sourit, et c’est le paysan désormais encouragé, qui s’occupe du cœur, qui dit que la guerre ira bien, qu’il fait froid, mais qu’il fait beau. On enlève la capote de celui qui a le moins de courroies à défaire et on l’étend sur le blessé. Il divague un peu.
—Fermez les fenêtres.
—Nous les fermons, disent les soldats.
Il ouvre les yeux, il voit le village qui brûle.Il murmure, parlant pour s’éviter de penser:
—Ce feu me gêne....me gêne!
—Nous l’éteignons, mon colonel, disent les hommes.
Partout des plaintes; les plaintes des gens de la ville, qui nous appellent par nos grades; les plaintes des paysans, inarticulées, toutes différentes selon les régiments, car les blessés de la Loire font: Holà, holà!ceux du Nord: Lo!lo!et les Bourbonnais: Voilà!voilà!Je reconnais les miens à ce cri qui offre ce dont ils souffrent.Voilà!mon épaule!Le colonel frissonne d’entendre cet homme se plaindre de sa propre blessure.
—Emportez-moi!
—On ne peut pas, mon vieux!
—Mais vous portez un autre.
—C’est le colonel.
Cela leur donne une minute de résignation; et, de préférence, c’est auprès d’un blessé que nous faisons nos pauses. Il nous raconte son malheur, sa blessure, se tait quand nous le quittons, puis, dès que nous sommes à nouveau éloignés, il nous appelle, il se débat:
—Emmenez-moi, mon colonel!
Nous crions que nous allons revenir.Les uns nous maudissent.Les autres naïvement nous croient et nous expliquent comment nous les retrouverons.
—Tu vois, c’est à gauche de la grande gerbe, près de la haie.J’allumerai de temps en temps des allumettes.
—Prenez-le, dit le colonel.
—Nous le prenons, disent les hommes.
Nous le laissons, mais le colonel se croit escorté d’un second brancard silencieux, et se mord les lèvres pour mieux contenir sa souffrance, pour se taire comme l’autre.De temps en temps une alerte, c’est le cheval sans maître qui galope vers nous, et, dès que nous l’avons touché de la main, qui repart vers les peupliers, pour revenir, dès que la main allemande l’a effleuré.Toujours des blessés.Heureux encore quand ils ne nous regardent pas, entêtés, sans vouloir nous répondre.Heureux aussi quand ils ne nous appellent pas, comme celui-là, par notre nom, car notre nom, ce soir, est plus sensible et plus douloureux encore que notre cœur. Parfois nous faisons un détour que le colonel ne s’explique pas et qui le secoue dans son martyre. C’est pour éviter un corps, et le gros paysan, ému, de sa voix bégayante, est pris alors d’un accès d’optimisme:
—Tout va très bien, mon colonel.Tout va le mieux possible.
Les incendies s’éteignent, pour repartir soudain comme si on les rechargeait.Les trois qui se reposent portent les six sacs, les six fusils, les dix-huit cartouchières, se baissant à chaque instant pour ramasser un sabre, une musette et rendant au relai un fardeau toujours plus lourd.De temps à autre, le colonel dit adieu aux hommes et me charge de retenir leurs noms, mais ils auraient dû porter des noms faciles et simples, les noms de la semaine, comme Jeudit.
⁂
—Lève-toi, petit.
Une main me réveille doucement.C’est un aumônier qui me découvre au fond d’une chaise dont le canage est crevé.Il m’en retire avec peine, écartant les barreaux de bois, et me fait évader du triste dimanche.
—Ce sont les petits Boches qui t’ont posé là?
Le mot «petit» est le seul remède que les aumôniers aient trouvé à la guerre. Il disent «le petit obus», «le petit Kronprinz».
—Viens, dans la chambre de ton colonel il y a un petit canapé.
A six heures, nouveau réveil, un trou dans les rideaux me donne un échantillon du jour, du jour pur et clair.Le canon tonne.Jamais, dans l’auberge inconnue où il est arrivé à minuit, en carriole comme nous, un voyageur n’eut plus de curiosité et d’angoisse.Suis-je dans une ville?Dans une forêt?Sommes-nous en fuite?Sommes-nous vainqueurs?Tout cela je vais le savoir en ouvrant la porte, et pourtant je ne me hâte point.Je me harnache dans l’ombre, et tous mes souvenirs sont à peu près revenus quand j’ai repris mon cliquetis de bataille.Voilà, sur la table, tout ce que m’a remis Jeudit en échange de son sac: un képi à cinq galons, une montre en or, un portefeuille.Jamais sac de soldat ne fut payé aussi cher.Le colonel sommeille dans un lit blanc, sa croix épinglée au rideau.J’ouvre doucement la porte et sors furtivement, par modestie, d’un tableau glorieux.
Un long couloir, comme dans un hôtel de province, sur lequel donnent des portes jaunes.Au pied des portes, les bottes, les épées, ce qui appartient aux officiers blessés.Au-dessus, sur une planche, ce qui appartenait jadis aux valets de la ferme, des galoches, des chapeaux melon.
—Où sommes-nous ici?
Ainsi l’on parle, du train qui s’arrête.L’infirmier ne sait pas.
—C’est grand?
Il est arrivé la nuit, il n’a aucune idée; c’est tout petit.
Par un escalier de bois il me fait descendre, il me pousse.A mesure que l’escalier tourne j’aperçois, dans la grande salle, des têtes pâles, des têtes jaunes, des têtes sanglantes, et en vingt secondes il m’enfonce par ce pas de vis au centre de la souffrance humaine.Les brancards débordent, s’appuyent les uns sur les autres et, pour gagner la porte, je suis obligé de faire le tour entier de certains blessés, qui me regardent longuement avec le désir de reconnaître au moins un de mes traits; je me perds dans un labyrinthe qui m’amène devant le brancard d’un soldat évanoui.Il est posé en travers, c’est le fond de l’impasse.Je reviens.Des sergents ambulanciers interpellent avec malveillance, car ils interdisent l’entrée aux officiers eux-mêmes, ce sergent en armes qui descend ainsi du grenier.Ils font taire ceux qui parlent haut, de sorte qu’on n’entend plus que ceux qui gémissent.Inquiets de savoir ce que signifie le rose ou le vert de leur étiquette, les blessés se rassurent ou pâlissent selon que celle du mort qu’on emporte a ou n’a pas leur couleur. Des médecins harrassés, des gestionnaires aux yeux endormis; je les reconnais tous; c’est moi qui les ai réveillés tous hier matin. Au fond, une porte vitrée à travers laquelle on voit, dans une cuisine, marcher une grande jeune femme, paisible. Parfois elle appuie son visage contre la vitre, et tous les blessés qui ont l’étiquette rose, les blessés légers, se relèvent un peu et la regardent. Des guêpes volent vers elle et veulent aussi s’évader par cette tête blonde. Un blessé myope, chaque fois qu’un des blessés éloignés se plaint, met son lorgnon pour le voir.
C’est un gros village.Pas d’église, pas de mairies; un village anonyme.Une distillerie déjà brûlée qui donne au bourg l’haleine du lundi.Sur un éperon qui domine la plaine, deux routes qui se croisent, cachetées par un tonneau de goudron répandu.Au fond de l’horizon, comme des jouets déjà relevés pour le jeu d’aujourd’hui, les peupliers d’hier, dont quelques-uns manquent encore.Dans les champs ensoleillés, les meules de paille derrière lesquelles vit un peuple violet et rouge, ennemi des obus, qui semble, avec je ne sais quels esprits invisibles jouer aux quatre coins.Je retrouve Bardan et Devaux, auxquels on avait dit que j’avais une côte brisée—car on appelait encore les blessures avec des noms d’accident, poignet cassé, genou abîmé—et ils me font étendre et ils me traitent malgré eux comme un blessé.
Le soleil est chaud, des grillons chantent, et l’on a glissé un moment, pour l’amortir un peu, les manœuvres au-dessous de la guerre.Des cyclistes attaquent les noyers de la route, les gaulent, et, un obus arrivant, se collent à leur tronc; l’on dirait une lutte et une réconciliation, passionnée, des soldats avec les arbres.Parfois l’un de nous, le bâton levé, se précipite sur une meule et la bat; c’est un éclat qui enflamme une gerbe, et, ignorants, au lieu de prendre en souvenir ce que les obus laissent de plus léger, leur aluminium, leur fusée, nous reviendrons vers le village chargés des éclats de fonte eux-mêmes.A la lorgnette nous voyons derrière nous les convois arrêtés, observant une limite qui est celle de la bataille; ils sont en cercle, nous livrons une bataille ronde; nous voyons leurs chevaux qui mangent, nous voyons un adjudant en bras de chemise sur un pliant lire un journal, nous voyons la paix.
Mais, inquiets de nous voir regarder à l’opposé de l’ennemi, les artilleurs se demandent si nous sommes tournés et viennent ramener par manie nos jumelles et notre vue vers l’Est.
Lundi.
Je suis sur la route.Je vais chercher le drapeau que la compagnie Flamond a pris aux Allemands.La nuit tombe.Des soldats marchent dans le fossé et semblent hâler, à deux cents mètres, les brancards chargés qui reviennent, suivis par les petits blessés sûrs ainsi, sans avoir à rien demander, d’arriver aux secours.Pas de morts, pas de mourants, c’est la partie du champ de bataille, proche de l’ambulance, que l’on nettoie par propreté.Les premières meules, les premières haies sont vides de blessés, comme de leurs fruits dans un verger les branches basses.Des groupes arrêtés: brancardiers qui ont senti leur fardeau devenir soudain pesant, qui le déposent, qui repartent chercher un plus léger.Des pieds traînent, une toux lointaine, les bruits du soir à la campagne.Tous ceux qui font individuellement leur journée de combat, les convoyeurs de munitions, les télégraphistes, regagnent le village, et l’on reconnaît les paysans à ce qu’ils vous disent bonsoir.Puis les rencontres s’espacent.La chaussée s’élève à travers les champs, et, tout debout, je vois au-dessous de moi la surface ravagée de la guerre, celle qu’un fantassin n’aperçoit maintenant qu’en haussant la tête au-dessus du créneau.Je la vois d’en haut avec ses sillons bousculés, ses crevasses, avec toutes ces dépouilles que rend la terre quand elle garde les morts, képis, souliers, avec une paire de bretelles étendue comme à l’étalage, avec une main raide qui sort d’un silo, je vais, et de cette promenade solitaire, aujourd’hui, après les années de tranchée, les années souterraines, j’ai le même souvenir que si j’avais, un soir, marché sur les flots.
Nous revenons en trois groupes.Le premier porte le capitaine Flamond qu’une balle au cou vient de tuer et ses bras pendent, les doigts rouges.Ceux qui meurent soldats sont comme ceux qui meurent écrivains, les mains pleines de sang ou d’encre.Les porteurs vont à pas rompus, ainsi qu’ils l’ont vu faire aux brancardiers.Puis vient le groupe du drapeau; les hommes ont discuté pour savoir si on l’étendrait sur le corps du capitaine, mais ont eu peur de commettre ils ne savent quelle faute..., sous le capitaine, peut-être.C’est un grand étendard pourpre, étoilé de noir, avec une croix que nous lui retirons, sous les yeux des prisonniers qui suivent. Je marche à la fin du cortège avec un enseigne, qui déjà cherche à parler français et à tirer dès maintenant profit de sa captivité. Artaud m’a désigné du doigt en disant que je connais Berlin et, Berlinois, il ne me quitte plus:
Berlin, seule capitale dont le nom ne puisse escorter le mot mirage.Berlin de plâtre et de bleu amidon où je suis arrivé le matin de la fête de Hegel.Les omnibus pavoisés circulaient en cercle, à la vitesse—avec les encombrements—des pensées vives de Hegel.De la gare débarquaient avec moi ceux des habitants de Magdebourg et de Travemünde qui ont un culte pour Hegel; il y avait les paysannes de la Sprée, en costume, que je retrouvai le soir, éparses dans les brasseries; et à nouveau réunies dans Weimar, le jour de la fête de Schiller, que célébrait avec un plaisir ambigu, dans cette ville de Gœthe, une foule dodue, drapée de linons noir sur crème, et passionnée par l’espoir de célébrer bientôt la fête de Gœthe, ô délices équivoques!dans Iéna.Je sais pourquoi le Berlinois de ce soir s’impatiente quand nos trois groupes se heurtent.Il les regarde avec dédain.Il trouve notre cortège mal formé.Il regrette, puisque nous avons des prisonniers, que nous ne nous en servions pas, Français que nous sommes, pour célébrer ce soir de guerre. Il est tout prêt à se mettre à leur tête, et à porter, incliné jusqu’à terre, le drapeau dépouillé de sa croix. Il est prêt à faire chanter ses hommes, car ils ont un chant de prisonniers dont on peut choisir les deux refrains, selon qu’on est le captif ou le vainqueur. Pauvres Français, qui n’ont pas un hymne prêt pour chaque aventure de la vie, l’hymne de la camaraderie, l’hymne du printemps, du voyage à trois—quelles délices de les clamer au milieu d’ennemis, ou en plein été, ou quand on est deux! —et qui meurent tous, à part les pianistes, sans savoir s’ils sont ténors ou barytons.
Hypocrite, cherchant malgré tout à se glisser sous sa pensée de victoire, mais sans l’impertinence des enfants français, à Berlin, qui ferment soudain les yeux et passent en courant sous la porte de Brandebourg ouverte au seul empereur, il me demande très haut, pour que ses hommes entendent, où est Paris.
—Je ne sais pas.Je n’y suis jamais allé.
C’est tout ce que je peux jeter sur Paris, ce soir, pour le protéger.
—Et eux?dans quelle province les mène-t-on?Les wagons sont-ils ouverts?
Tous les prisonniers poseront cette question.Ce n’est pas qu’ils veulent de l’air, c’est qu’ils veulent voir. Ah! si les wagons de prisonniers étaient ouverts! C’est le désir de voyager qui les a tous excités à la guerre et l’idée de wagons fermés les déçoit. Tout serait si bien, si, du compartiment ils pouvaient apercevoir nos villes et ils promettent, impartiaux, de s’émouvoir quand notre nature sera trop belle pour un cœur allemand. Leur guetteur de paysages réveillera tout le train, pour les églises gothiques, les châteaux, et les ruisseaux avec leurs peupliers, et les contreforts des Cévennes. Déjà n’est-ce pas la douceur même, cette marche sous ce ciel! La nuit fait scintiller un à un tous les Français, qui ont des armes, et les laisse, eux, dans la nuit, masse profonde,—mais pauvres petits Français, au visage mobile, qui portent chacun son fusil et sa vie à soi!
Il est minuit.Je rejoins le capitaine Lambert, qui écrit à ses filles en attendant les convois de pain.Il leur écrivait jadis la même lettre pour toutes trois, mais depuis hier il les voit séparées et il lui faut trois enveloppes.
—Aurons-nous du pain?me demande-t-il.
Toute la nuit il se lèvera pour interroger ainsi les cavaliers, les vaguemestres, les estafettes, qui se croiront obligés, à cause de sa question et de son grade, de lui offrir un reste de saucisson ou de chocolat. Toujours d’ailleurs il accepte. Les balles claquent, nous nous sommes mis du coton dans les oreilles pour ne plus rien entendre, à part le capitaine, que nous voyons parfois s’élancer, pâlir, revenir, et dont l’agitation nous semble aussi ridicule que celle d’Ulysse aux marins dont les oreilles étaient closes. J’ai gardé mes lunettes pour être avec le ciel dès que j’ouvre les yeux et, s’il arrive que je veuille le voir de plus près, voici des jumelles. Parfois, sous la paume de ma main, sur ma joue, une herbe vit une minute et palpite comme une paupière amie. Parfois, éveillé soudain, je vois penché sur moi un visage inconnu, nouveau, dont la vue seule me lasse comme si j’avais à le créer, et à imaginer pour la première fois, selon qu’il est bon, ou anxieux, ou triste, la bonté, l’angoisse, la tristesse. Ce sont des compagnies de renfort qui vont à l’assaut. L’ouate leur donne à croire que nous avons mal aux dents, qu’une fluxion peut-être nous menace, qu’il faudra peut-être arracher la molaire, et, débordant de pitié pour nous, irrités de tant de souffrances, nos visiteurs haussent les épaules vers Dieu.
⁂
Quatre heures.Tout est silencieux.Les incendies, mal surveillés, se sont éteints avant l’aurore. Le froid, la rosée, tout ce qui peut pétrifier, la nuit l’a essayé sur nous. Tout est calme. Je me rappelle mes tampons et les enlève avec la crainte d’avoir joui d’un faux silence, mais rien ici que le bruit d’une montre, là-bas d’une brouette qui grince; jamais journée de guerre ne fut remontée plus silencieusement. Çà et là, des fossés, des sillons, les hommes se dressent, s’étirent sans réserve en largeur et en hauteur, comme si ce n’était pas la guerre, puis, se rappelant soudain, reviennent courbés et rampant faire craquer leurs doigts à l’abri. Pas une parole. Personne ne veut donner à la journée une raison de commencer, trahir les cent mille hommes qui s’entêtent, dans cette aube, à croire à la nuit, et ne se brosse, et ne moud le café, et ne va puiser l’eau. Celui-là déplie une lettre et nous donne même, en tournant les pages froissées, un des bruits du soir, dans les pensions... Le pion, allégé déjà d’un soulier, faisait sous ses rideaux claquer sévèrement sa langue... Turpin déjà, qui affirmait ne pas ronfler, ronflait... Mais voilà que derrière nous le premier coup de canon éclate, que l’obus part, part de nos têtes même,—et c’est fini.
Je vais réveiller mes agents de liaison, éparpillés, triste boussole en morceaux.Ils se soulèvent, se passent un juron qu’ils multiplient: Ah! Vingt Dieux! Ah! Millédieux! Ils redressent des visages gonflés, mouillés, verdis, comme si l’on avait dû, pour les faire dormir, tenir leur tête plongée dans un fleuve ou dans l’oubli même. Pauvres têtes que les mères en cette minute prendraient dans leurs mains en pleurant, comme si elles les retrouvaient détachées du corps de leurs fils, vivant seules! On en voit qui rêvaient, qui tombent à nos pieds de Roanne, de Vichy... —Pourquoi nous réveiller? disent-ils tous. Puis l’idée vient qu’ils ont un bout de pain, qu’il reste deux sardines dans une boîte ouverte et cachée sur un arbre, et ce modeste appât suffit pour les attirer dans la guerre.
Nous n’avons même pas ce matin la consolation de nous laisser aller, de nous détendre: le général en personne vient s’installer dans notre carrefour, étend sur le sol sa peau de léopard gonflée de papiers et, à genoux, y cherche des présages.Nous attaquons.Le commandant Gérard et ses compagnies attaquent Nogeon.C’est eux qui nous ont réveillés dans la nuit, pour savoir ce que nous étions devenus.Ils allumaient leurs briquets pour éclairer nos visages et nous regardaient comme on lit un journal.N’ayant pas encore combattu, ils posaient les questions qu’on pose dans la paix:
—Michal avait-il encore sa connaissance?S’est-il vu mourir?
Ce sont maintenant nos quatre compagnies qui défilent, éclairées de face par l’aube, et, après le bataillon obscur, le général envoie à la bataille le bataillon clair.Chaque homme sous cette aube se précise, chaque visage, chaque main; ce n’est pas pour une mêlée, mais pour un corps à corps qu’avec cette lumière crue on nous prépare.Des soldats que depuis un mois l’on n’avait qu’aperçus, s’approchent, vous parlent de leur famille, de leurs enfants, vous font soupeser le poids de leur vie, vous tendent aussi la main pour que vous les touchiez, et repartent plus confiants, de voir que vous croyiez à eux.Dans le petit chemin le long du verger, chaque section s’amincit pour dépasser le corps du capitaine Flamond étendu sous son capuchon, et celle qui est près de lui, aux haltes, dessine sa forme, reste bosselée, comme la terre même où on l’ensevelit.
Le général prend chaque capitaine à part et lui montre un ordre.Tous lisent vite et s’inclinent, un peu plus souriants et pâles, excepté Viard, qui ne comprend la manœuvre que d’après le terrain, et auquel le général explique le mouvement en lui faisant compter les peupliers, comme par des tables de chiffre.Perret, toujours méthodique et paternel, rassemble en groupe ses soldats et leur répète tous les ordres, selon son habitude.
—Tant pis pour vous, dit-il à deux retardataires.Vous ne saurez rien.
Puis il oblige chaque homme à remettre à Dollero les objets allemands qui les feraient fusiller, si l’ennemi les trouvait sur eux et Dollero est bientôt recouvert de casques, d’éperons et de dragonnes.
—Ce que je prendrais, si j’étais fait prisonnier maintenant!dit-il.
Le capitaine Jean met au courant ceux qu’il préfère.Viard ses sergents, Perrin, les plus intelligents; et nous partons, vers les peupliers, guidés, selon la compagnie, par l’amitié, le grade, ou la ruse.Mais à mi-chemin de Nogeon, un lieutenant de dragons réclame deux gradés pour faire cesser entre les peupliers et Fosse-Martin l’allée et venue de soldats isolés, et il m’emmène avec Mourlin.
Nous suivons les fossés de la route, arrêtant les hommes qui reviennent, les questionnant:
—Où vas-tu?
—Au village.
—Quoi faire?
Ils répondent sans méfiance qu’ils vont se reposer, et, quand nous leur disons de repartir, nous regardent comme si nous avions trahi leur confiance.Un peu honteux, nous leur offrons de l’eau fraîche.Ils boivent, croient nous avoir gagnés en buvant, repartent vers Fosse-Martin.Mais nous les prenons par le bras, nous les retournons face à Nogeon qui brûle.Nous les poussons à peine et ils repartent.Ceux qui ont mauvais caractère d’ailleurs haussent les épaules.Nous avançons en utilisant les meules et en tournant autour d’elles, selon que les obus viennent de Puisieux, de Vincy, ou de Bouillancy.Au pied de chaque meule, déjeuner du matin, nous trouvons à manger.Meule avec un morceau de pain, meule avec un reste de conserve; ne pouvant offrir leur blé, elles offrent ce qu’elles ont.Meule avec une lettre.Meule avec un obus allemand non éclaté, et du côté français, malice, une bouteille qui, elle, est vide.Meule d’où sortent deux souliers inertes.Mourlin tire sur l’un, moi sur l’autre, avec précaution d’abord, mais nous sentons que le soldat résiste et n’est pas blessé.Il se cramponne.Il se demande ce qu’il va prendre si c’est un colonel, deux colonels qui lui tiennent ainsi les jambes.Il apparaît.Il dormait depuis hier:
—Vendus!nous dit-il, sergents de ville!
Nous lui allongeons une calotte, un coup de pied; il se défend comme il peut, mais reçoit une paire de claques, et s’en va vers les peupliers, brouillé avec nous pour toujours.
Sur la route, les blessés d’hier que l’aurore et les shrapnels surprennent dans leur retour.Des isolés qui s’appuient sur leurs fusils, la crosse sous l’épaule, le canon à terre.Des groupes de trois, enlacés, celui qui souffre le plus au centre, se retournant lentement tous trois quand on les appelle, liés et endoloris, souffrance antique, par un serpent invisible.Un caporal enfant, qui ignore ce que l’on fait des blessés, puisqu’il veut donner des lettres pour sa famille à ceux qui vont au combat.Là, une trace de sang qui au lieu de venir de la bataille va vers elle.Deux soldats de mon régiment qui rient, expliquant que la même balle les a blessés, l’un à la tête, l’autre au pied, et que Mourlin achève de mettre en gaieté en leur demandant ce que diable ils faisaient ensemble.Un petit qui souffre, qui se met à genoux, comme un pauvre animal, quand il ne peut plus avancer...qui s’étend.Un grand qui marche posément, lentement, au milieu des boiteux, avec mille précautions, car il a une balle dans les poumons et qui, malgré tout, se jette à terre dès qu’arrive un obus. Puis, le danger passé, il se redresse peu à peu, verticalement, et se lève comme on grandit. Un lieutenant qui, d’une main tâtonnante, cherche son lorgnon vers son cerveau ouvert et se plaint de sa myopie. Derrière des meules déjà repérées par les canons ennemis, des dizaines de blessés graves entassés qui, par peur de devenir encore plus visibles, repoussent les petits blessés comme d’un radeau surchargé. Certains ont enlevé leur capote et marchent en chemise, pour que les Allemands ne tirent pas sur eux; et parfois au milieu des gémissements un appel: c’est un blessé qui vient d’être atteint à nouveau, c’est un jet de sang nouveau, tout frais, et c’est, au milieu de cette plainte monotone, un cri tout vif.
Puis, soudain, déblayant pour une minute la route et les champs comme s’il guérissait et entraînait avec lui tous les blessés, un régiment de renfort qui charge en compagnies déployées sur Nogeon.Rien que des inconnus, et de chaque inconnu, à la guerre, on a l’impression qu’il n’avait rien à voir là-dedans et qu’il s’est battu pour vous.Le soleil rabat toutes leurs ombres sur la gauche et Nogeon ne reçoit que des images, des corps illuminés.Ils vont dans l’axe de la route, chacun d’eux qui tombe, tombe dans la ligne même des sillons. Ils entrent dans Nogeon, et la distillerie, presque aussitôt, s’allume, flambe. En dix minutes, elle est en feu, d’un feu lourd dont ses grandes cheminées essayent par habitude de donner la meilleure fumée. Ils reviennent, se reportent en arrière,—puis sortent encore des soldats isolés, les plus braves, et ceux enfin qui supportent le mieux la chaleur; une arrière-garde roussie, qui cède au feu sans hâte. En voici un dernier qui sort de la flamme même... En voici un autre... Plus personne... Des papiers rougis, des flammèches voltigent, que les soldats se donnent la peine d’attraper et d’éteindre d’une claque, quand ils sont près d’un officier, comme les enfants qui tuent les mites pour plaire à la maîtresse de maison.
Notre lieutenant de dragons est revenu au galop.Il n’a plus le même cheval, et Danglade non plus, qui passe avec des ordres.Chaque cavalier reparaît dans la bataille avec une monture qu’il connaît et qu’il aime de moins en moins, et vers le soir la mort de son cheval ne le touche même plus.A nouveau un flottement à la droite de Nogeon et nous arrêtons ceux qui ont trouvé un prétexte pour chercher un peu de repos.Nous retenons pour nous aider un petit caporal du 60ᵉ, qui a vingt-deux ans; timide, il ne s’attaque qu’aux visages imberbes et il ne sait arrêter, au lieu de crier, qu’en courant se mettre devant l’homme qu’il poursuit, comme ferait un chien. Des fuyards habiles qui se sont organisés en corvée d’eau, et marchent leurs sacs de coutils dépliés. D’autres, plus modestes, qui voudraient seulement de l’ombre. Un zouave qui, pour détourner mon attention, me montre un revolver prussien et veut m’entraîner dans un trou, à cent mètres, où tous les boches morts ont encore leurs lorgnettes. C’est à mon tour de résister. Des vieux à visages durs, qui se sentent plus braves que nous, et sont vexés de reprendre leur élan sur deux sergents parvenus. Un autre qui se venge en ne quittant pas des yeux le nez de Mourlin, qui y a attrapé un coup de soleil. Toutes les cinq minutes désormais, Mourlin demandera ma glace, ou la glace de ceux qu’il arrête. Des camarades, dont la tête apparaît dans ce reflux, et qui me disent: Un tel est tué, car cela coûte un mort au moins, aujourd’hui, de revoir une figure connue. Un soldat tout pâle, auquel je montre un aéroplane en lui glissant un fusil dans la main, comme à un enfant pour qu’il mange sa soupe. Parfois le renfort d’un agent de liaison, qui revient de la brigade et nous dégoûte du village, où il n’a trouvé ni eau, ni pain: rien que des marmites, et surtout le général, qui le prenait pour un fuyard et le menaçait à distance de son revolver. Il a chargé sur lui en agitant son pli et est parti sans attendre de réponse.
—Alors, allons-nous en!disent les autres.
Nous les retenons maintenant.Le lieutenant veut en rassembler une cinquantaine que nous ramènerons en sections.Ceux qui arrivent sont tout étonnés d’être reçus comme s’ils étaient attendus et prennent sans mot dire la place qu’on leur indique.
—En route!
Pour se débarrasser du cheval, on le lâche simplement vers l’arrière, et nous avançons.Les balles sont de plus en plus basses et l’on rampe.Un homme parfois s’encastre entre deux grosses betteraves et se dégage avec peine.
Voici les peupliers.Nous sommes tombés dans une compagnie déployée dont nous troublons une minute les habitudes et qui nous accepte sans enthousiasme dans son fossé.Les Allemands sont là, à trente mètres.Il y a parmi eux un grand diable qui se lève à demi toutes les cinq minutes et qu’on n’arrive jamais à tuer.Cela intéresse les nouveaux venus.Le voilà; un dos gris vert surnage tout à coup au-dessus des betteraves. Deux coups de feu sur lui. Bien des Français n’auront vu de l’ennemi que ce pauvre pantin. Le soir on a fini par l’atteindre.
Tout est calme.C’est encore l’heure où les premières lignes lassées forment la seule zone neutre des deux pays et montent seulement la garde devant la bataille.Que les secondes lignes tiraillent sur les secondes lignes allemandes, que nos canons canonnent leurs obusiers, que nos civils haïssent leurs civils!Nous ne tirons pas, nous réservons notre colère pour une compagnie de renfort, étendue cinquante mètres derrière nous, qui nous prend pour des blessés, et dont le capitaine nous crie sans relâche qu’il va nous délivrer.Capitaine agité qui hurle aussi: «Vorwärts, Vorwärts», pour provoquer les Allemands, et Mourlin aussitôt, pour les calmer, crie plus fort encore un mot allemand qu’il croit, à tort, signifier: Repos.Tous deux luttent de la voix une minute, et devant nous les Saxons se taisent, craignant un piège, se demandant ce que peuvent bien préparer les Français pour hurler ainsi alternativement, dans la langue impériale: En avant!et, Tranquillité!
La journée commence: Mourlin, qui est de l’active et de la classe, a tiré son mètre et coupe le jour d’hier.
Mardi 8.
Le soleil se couche.Mais un moment encore nous tirons, sur lui, par les sillons, comme on tire par un tunnel dans les boutiques de foire, et un avion allemand profite des dernières lueurs pour venir espionner ma compagnie.Cinq minutes entières il reste au-dessus de nous à virer.Il ne perd pas un de nos gestes.Il pourra dire à von Kluck: Mourlin a toujours son coup de soleil, Dollero lit une lettre dénonciatrice qui commence par «Mon Dollero», Bernard mâche ses betteraves: attendant la nuit avec ses propres armes, nous fermons les yeux, rejetant la tête en arrière quand notre somnolence heurte soudain en nous le sommeil même.Pas de tranchées, nous ne laissons sur le sol que la trace de nos corps et à fleur de terre nous trouvons la confiance qu’il faudra puiser bientôt de plus en plus profond.Visite d’un brave soldat qui rampe jusqu’à nous, les bras repliés sous lui, comme les chiens sans malice replient leurs pattes de devant, et qui risque sa vie pour attraper un mille pattes et le jeter sur nous, avec ses trente pattes frétillantes. De temps en temps, Jalicot crie: Rendez-vous! pour faire une farce aux Allemands, qui continuent à tout prendre au sérieux et répondent en français pour qu’il n’y ait pas d’erreur: Non! Non! Puis, à leur tour ils crient de nous rendre et nous leur répondons d’une voix un seul et même mot. Ils sont vexés: eux nous répondaient poliment! Sur la droite, à tout propos, les bugles des alpins, qu’on aperçoit sombres à flanc de pente, comme leurs sapins dans la montagne. Ce sont des alpins réservistes plus fidèles à la musique que les jeunes. Une alerte, qui tend le front français, et nous nous couchons sur le côté pour mettre nos baïonnettes, les uns se faisant face, les autres se tournant le dos. Parfois, sous ces étoiles, sous ces balles qui ne rencontrent plus la terre nivelée par la nuit, une gloire sous laquelle nous rampons minuscules et nous remuons sans hâte, comme ceux, sous des toiles, dans les théâtres, qui font la mer tranquille.
Minuit.Nous nous sommes ensevelis dans un trou, et ceux qui ne veillent pas nous rejoignent.Voici celui que nous désirions le moins, car il ronfle, le capitaine.Entassés, nous avons les jambes prises dans de lourdes jambes; des inconnus, nous aimons mieux ne pas savoir qui, nous étreignent. Parfois on défend durement sa tête contre un genou, un soulier, une tête. Parfois un arrivant ne sait pas qu’on dépose son arme, et s’étend sur nous avec son fusil qu’on expulse peu à peu, comme une arête. Parfois des coups de pieds violents et anonymes contre une jambe importune qui doit être celle du capitaine. Un soldat du fond qui grelotte donne au tas un mouvement fébrile; deux derniers invités, magnanimes, jettent sur le trou comble leurs pèlerines. Un officier en ronde nous commande de nous lever; nous nous taisons; il nous menace; il faut que le capitaine dégage sa tête, et du milieu de nous, nous commande, comme notre conscience, et surtout à ceux du fond, de ne pas bouger. Un soldat qui vient d’être blessé s’arrête près de nous, demande où est le poste de secours, et, pris de générosité, dépose sur le rebord de notre trou des objets qu’il nous nomme.
—Des courroies de sac neuves, du saucisson, un couteau.
Au bout d’une minute il revient.Il n’a pas trouvé le poste et d’ailleurs éprouve un remords au sujet du couteau qu’il reprend.Mais il n’a pas le temps de repartir.Aux quatre coins du plateau les mitrailleuses font leur bruit de squelette.Un de nos canons tire au hasard dans la direction de l’Allemagne. La fanfare des chasseurs sonne, s’arrêtant soudain, comme si tous les musiciens se précipitaient en mesure pour ramasser un même blessé. Le soldat mange son saucisson. Un des dormeurs du fond essaye de se dégager; les autres se font plus lourds pour qu’il reste immobile. Il remue encore par saccades, puis, écrasé, se plaint, se tait.
Une heure.Nous revenons à Fosse-Martin par la route, muets, entêtés.L’amitié nous colle l’un à l’autre et chacun s’appuie sur un camarade, mais nous ne savons plus parler doucement, discuter, et personne ne cède plus à personne.Dollero veut me forcer à prendre le pain qui lui reste.
—Mange ce pain.
—Garde-le.
—Tu n’en veux pas, eh bien, regarde.
Il n’insiste pas.Il le jette, et Dieu sait pourtant ce qu’était pour nous le pain, cette nuit-là.
—Jette.
Ségaux voit que mon rhumatisme à l’épaule ne va pas mieux, et il veut porter mon fusil.Nous nous battons.Je le lui arrache.Il me fait mal.Je lui fais encore plus mal, et il a les larmes aux yeux.
Enfin Fosse-Martin!...Sur la petite place, les blessés qui claquent des dents ne savent si c’est la mort ou le froid, demandent le major aux uns, aux autres une couverture.Un séminariste qui n’ose dire «je meurs» dit «je n’existe plus, je n’existe pas!» Dans l’ambulance comble, un soldat délire, compte des chiffres en chantant, et meurt quand il a prononcé le chiffre de son âge.Sur la route, un officier montre du doigt, derrière l’abreuvoir où elle se reflète, la fenêtre éclairée du général, et, stupide, avec un accès d’enthousiasme, confie à son voisin:—C’est Bruges, vraiment!Regardez donc!c’est tout à fait Bruges!
⁂
Le ciel est muet, les arbres muets.On a retiré le langage aux armées étendues.Jamais un mot n’a tant coûté, et ceux parfois qui se relèvent, étendant les bras, ne parlent à la nuit que par gestes.On se réveille, coupé soudain par le froid à la partie nue du poignet, du mollet, du cou, et on l’entoure d’un mouchoir comme une vraie blessure.Le camarade du capitaine qui ronfle, siffle timidement au-dessus de lui depuis un quart d’heure sans oser le toucher.Un télégraphiste a pris un dormeur dans son fil et, une demi-heure entière, essaye de tout dégager sans que l’autre se réveille. Partout, pour le sommeil, le respect qu’on a, dans la paix, pour la vie. Comme pour la renforcer, dès qu’ils ont soigné leurs chevaux, les dragons viennent s’étendre derrière nous et doubler en ronflant notre ligne de dormeurs. Quatre heures. On voit celui qui perdit hier son meilleur ami ouvrir des yeux à nouveau ignorants, tout apprendre, et les refermer. Des sabots qui tapent sur la route, un air acide, une lumière verdâtre, tout ce qui vous a fait désespérer, jadis, au printemps, à l’aube du jour où vous aviez entassé d’avance les heures les plus douces... , puis l’on se rappelle où l’on est.
On se dresse soudain comme si l’on avait dormi sur le rebord d’un pont, en veillant à ne pas chanceler du côté de la bataille.On voit la frontière même marquée par cette chaîne de soldats anéantis.On a une seconde d’ingratitude pour tous ceux qui là-bas derrière pensent à vous.Pourquoi vivent-ils?La guerre serait si belle s’ils n’existaient pas.Puis, repentant, par amitié pour eux, on pense à soi-même avec leur tendresse.—Pauvre vieux, se dit-on.On s’appelle par son prénom et par les surnoms qu’ils nous donnent.Le courage revient et l’on vole le meilleur fusil et la meilleure baïonnette de ceux qui dorment encore. Un brave adjudant réveille ses hommes en les chatouillant avec des herbes:—Eh l’olibrius! dit-il à chacun, regarde ta montre! et les olibrius ouvrent des yeux jaunes, des bouches lourdes où s’engouffre le matin. Puis, dans l’aurore même, cadran solaire sans soleil, notre petit canon matinal éclate et, parti de l’Allemagne à la même seconde, un gros obus arrive, nous couvre de pierres, de terre, de débris de tôle. C’est trop de bruit! Les olibrius se lèvent en jurant... et aujourd’hui commence.
Belle journée.Une fois admise, il faut la juger sans parti pris.Le soleil s’élance de nuage en nuage et celui qui le contient est doré.Le ciel est bleu clair, avec quelques abîmes.De ces ormeaux dont les obus détachent toutes les minutes la verdure par branches entières, l’automne fait tomber aussi, mais une par une, des feuilles jaunes.Pas d’ordres encore, et nous avons une heure de flânerie.La route est aux blessés légers, qui n’ont pas voulu s’égarer la nuit, et qui marchent gaillardement, chacun portant à fleur de peau, on peut toucher, son éclat de grenade ou sa balle.Voici Trinqualard, atteint au bras gauche, à ce pauvre bras gauche que toute l’armée française a si volontiers sacrifié depuis le jour de la mobilisation et qui n’a pas essayé de se racheter en devenant moins maladroit, moins rétif. En échange de la nouvelle qu’hier nous en avons fait cent, Trinqualard me donne un vrai prisonnier qu’il a ramené de Puisieux, avec lequel nous jouons une minute, qui s’apprivoise et ne veut plus nous quitter. Mais quand un obus arrive, il gémit, déplore son aventure et nous lui crions de se taire:
—Comment se taire, avec une guerre pareille!répond-il.
Jusqu’à nous parviennent maintenant de nouveaux convoyeurs, de nouveaux conducteurs qui se trouvent pour la première fois sous le feu.Ils courent, ils ont les yeux pleins de curiosité et d’angoisse; ils demandent où sont les Allemands, si c’est la garde prussienne, quelles sont les blessures les plus fréquentes, si nous gagnons.Ils ont de petites jambières comme on les porte dans les pays de serpents, et, au milieu de notre vie lente, continuent toute la journée une existence saccadée, leur plaque d’identité en évidence sur l’uniforme, empressés à relever le moindre sac, le moindre fusil, domestiques nouveaux de la bataille, ayant sur les lèvres le nom de tout ce qu’ils ont à perdre, enfants, femmes, parents, distribuant soudain sans raison des boîtes d’ananas ou de homard, abattus par le vent du moindre obus comme s’ils étaient moins lourds que nous.
Le vent vient de l’Est; pas une de nos paroles qui soit entraînée vers l’ennemi, nous parlons, nous rions sans avoir à nous méfier de nos rires et les cavaliers eux aussi, une fois à terre, relâchent leurs chevaux sans plus s’en occuper, assurés qu’ils ne peuvent aller que vers des amis, et qu’à Meaux, à Tours, à Bordeaux, un jour on les rattrapera.L’air est léger.Nous y vivons en liberté, avançant en tirailleurs dans les champs pour préparer l’assaut.Nous visitons les meules, les talus; et de chacun, comme nous appuyons sur la peau pour faire sortir une balle en surface, nous ramenons un Allemand endolori, blessé d’hier ou d’avant-hier.Sur ceux-là, il ne peut y avoir de doute, c’est nous qui les avons touchés.Nous les avons touchés aux poumons, à la tête, à la hanche, nous leur avons simplement, petite leçon chrétienne, traversé les deux mains, et chacun d’eux suit son Français, un peu moins agile, un peu moins fort, à peine moins calme, tous les deux avec des lèvres un peu gourmandes, un peu méfiantes, car ils ont échangé leur tabac et ils l’essayent.
Voici les ordres.La division réclame d’urgence un état de ceux qui savent le turc.Il suffirait de savoir le turc pour n’être pas tué aujourd’hui. Unique remède d’ailleurs, car on cherche en vain au fond de soi un mot, un seul mot, à défaut d’un langage entier, qui soit un talisman et vous assure votre vie. Personne d’ailleurs dans la compagnie ne sait le turc, ou, dans un effort pour vivre, ne le devine subitement. Horn sait le danois, se propose au sergent-major, mais sans espoir. On l’inscrit quand même; toute la journée il se retournera vers les agents de liaison, pauvre Hamlet dédaigné.
—Bergeot sait l’auvergnat, crie Forest.
Et chacun crie ce que sait l’autre: Jalicot la langue des Pions: les habitants de Lapalisse, Charles le tunisien, Pupion le patois de Charlieu; Masseret fait la perdrix, Dollero l’autobus...Mais le capitaine siffle.
Nous repartons dans cinq minutes vers les peupliers.Nous nous calmons, nous équipons, et tous,—pourquoi tiennent-ils à être si vulnérables!—après avoir dit au revoir au capitaine dans leur meilleur français, écrivent une dernière carte postale, sans se hâter, en la relisant même pour l’orthographe.
Mercredi, 9.
La journée a bien marché.Nous étions tous heureux, lucides.Nous avons fait une bonne bataille, car, dans le civil, nous aurions fait aussi, selon notre métier, une bonne affaire, une bonne table.Pour la quatrième fois, nous revenons à Fosse-Martin, déchirés cette fois, en loques et portant tous la trace d’un corps à corps avec les Allemands ou avec la terre.Étendus près des cadavres de ceux qui nous résistaient la veille, des soldats de Nassau, nous avons préparé pour demain un tapis avec des Saxons.Qu’il fait beau!Le silence suffit pour nous redresser.Pour la première fois de la journée, nous allons debout, malhabiles, trop grands, cherchant un nouvel équilibre et nous appuyant tous sur le brancard du capitaine André.Assuré déjà de mourir, il nous questionne sur tout ce qui tourmente sa pensée; mais, n’osant parler de lui, il parle comme s’il s’agissait du capitaine Flamond tué lundi.Où a-t-on mis l’épée de Flamond?son portefeuille? Où l’a-t-on enterré? et nous lui répondons comme si Flamond, qui se moquait bien de tout cela, était devenu à la dernière heure de sa vie un père de famille scrupuleux et doux: l’épée, la croix, les papiers sont déjà partis pour Roanne, scellés, et, nous le jurons, on l’enterrera, Flamond, dans un cercueil.
Voilà de nouveau l’ambulance, et nous sommes arrêtés dès le premier brancard par Courtois, notre fourrier de réserve, auquel Chalton, notre fourrier d’active, parle d’en haut sans se courber car il a une balle dans l’œil.«C’est la mort des fourriers!», disent-ils en essayant de rire, et Courtois, qui a le poumon traversé, s’inquiète, pose sur son mal des questions précises auxquelles nous répondons des phrases vagues, car elles doivent servir aussi aux voisins qui écoutent, aux jambes brisées, au foie troué.Cent hommes étendus, qui ont été retirés plutôt de l’air que de la bataille et auxquels on souffle de l’oxygène.Visages dégonflés dans lesquels on sent desséchés et fades tous les secrets qui faisaient leur vie, cantonniers qui ne pensent plus aux routes, charrons qui se fichent des voitures, yeux francs qui soudain louchent.Nous questionnons ceux de notre compagnie.
—Et Jalicot?
—Il va bien, mais Vergniaud est tué.
—Et Pupion?
—Bien, mais Béreire est tué.
Tristes rançons.Par quel mort équilibrent-ils mon nom, à ceux qui les interrogent sur moi?
Mais Charles nous appelle au seuil d’une petite maison, et nous offre à boire.Impression bizarre d’être dans une chambre.La porte une fois fermée, malgré nous, notre cœur s’élargit jusqu’au plafond.Nous buvons, nous nous disons nos plus grands secrets.Drigeard parle de sa femme, Charles de ses petites filles.Les photographies sortent de nos poches, comme si les noms eux aussi se dilataient.Dans cet espace clos se dissémine tout ce que la bataille depuis quatre jours comprimait.Cela sera le diable de faire rentrer tout en nous, quand nous allons sortir, et une ou deux de ces formes vont nous accompagner tout le soir.Charles croit que la bataille va finir, qu’il y en aura une ou deux encore, sur la Meuse, sur la Somme...la dernière sur le Rhin, car déjà, bien que nous combattions dans un pays sans ruisseau, sans sources, les rivières se glissent dans nos dialogues et entendent donner leur nom au combat.
Nous avons rejoint le capitaine au carrefour.Il est monté sur les marches de la petite croix de fer à laquelle il se cramponne et surveille les champs comme un pilote. Une compagnie creuse des tranchées devant notre fossé, et de temps en temps, en face de moi une tête émerge, toujours la même, celle d’un soldat à grandes moustaches qui me prend en amitié. Quand il me devine engourdi, il m’arrose de terre sèche et rit. Il me passe à la main tout ce qui se trouve dans son trou, un grillon, un reste de cartouche de chasse. Pour me parler il prend le prétexte que l’on prend quand on commence à parler. Il me demande le nom de chaque chose. Quelle est cette plante? Il a toujours ignoré son nom. Dans son pays on appelle cela du santeuil. Il veut jouer. Comme un chien qui rapporte son caillou, il me lance une boîte vide, qu’il reçoit sur la tête en éclatant de rire; l’affection le pousse à creuser de mon côté et à me téléphoner par une racine. Après chaque shrapnell, il disparaît et revient avec les noms des blessés, car tout ce qui porte un nom l’intéresse et il me demande le mien. Comme Drigeard nous donne le café, je lui passe mon quart; pour me le rendre, il sort tout entier de sa tranchée, et nous nous trouvons face à face, intimidés comme les correspondants des Annales qui ne se sont jamais vus et ont pris rendez-vous entre deux trains, dans une gare; il est mal à l’aise, mais heureux. Il examine l’autre bout de sa racine; il prétend que c’est de l’acacia noir et non point du cardénate; et soudain, comme si le train partait, il regagne d’un bond son trou. J’ai revu deux fois sa tête, lui jamais plus.
La nuit tombe; les bouchers du régiment cherchent un bœuf échappé en suivant la ligne des tranchées qu’il n’a pu franchir.Les obusiers allemands se sont tus un par un, et, tout seul, un petit canon français use ce qui restait de munitions à ses confrères plus nonchalants.Des travailleurs et des blessés passent, interpellés par le général qui, malgré lui, manifeste plus de sympathie pour les soldats touchés aux bras qu’aux jambes.Accoudé au-dessus du talus, nous profitons du spectacle, des cavaliers dans leurs manteaux, des volontaires qui s’inscrivent près du feu pour les patrouilles, têtes de pourpre, et chacun souhaite avoir là celui d’entre les siens qui jouirait le plus d’une pareille nuit, le capitaine son père, Drigeard son directeur d’école, et Dollero, Vigny.Les sapeurs ont reçu du bois et construisent un abri au-dessus de nous-mêmes...A mesure que je m’assoupis, ils me cachent peu à peu le ciel avec des planchettes....De temps en temps, une alerte venue de l’Oise nous effleure pour gagner la Meuse et la fusillade crépite.
⁂
Dollero s’agite dès trois heures.Il a faim et m’éveille en retirant la musette avec laquelle il m’a calé.Drigeard réveille le capitaine, étendu sur son sac à café.Chacun a dormi cette nuit sur le bien le plus précieux de l’autre, et nous nous saluons par des excuses au lieu de nous secouer brutalement.J’erre au milieu de mes agents de liaison, hésitant, choisissant enfin, pour l’éveiller le premier, comme si j’avais à ressusciter des morts, le dormeur qui remue encore un peu, et le visage le plus doux aussi, pour qu’il me maudisse moins.Je me penche, j’ouvre avec mes doigts ses paupières mêmes...Je les maintiens une minute.Il voit...Puis je le charge d’éveiller les autres.
Le silence dure.Les chevaux vont boire sans que les obus éclatent près de l’abreuvoir.Nous voyons là-bas les artilleurs graisser leurs pièces, s’étendre au-dessous d’elles, accrocher aux affûts de petits pots d’essence ou de ripolin, et des canons, ce matin, semble couler une résine bienfaisante.Repos tel que le cordonnier de la compagnie accepte un soulier et le répare.Le soldat qui a le pied déchaussé ne vit plus: la bataille pourrait recommencer juste maintenant!Mais un second se délace, un troisième enlève d’avance ses deux souliers.Jamais, depuis un mois, nous ne sommes entrés dans la journée comme dans une mer calme, les pieds nus. Des médecins se promènent jusqu’à notre ligne, le cœur du village n’est plus notre sang, n’est plus l’ambulance. Déjà les soldats entreprennent tout ce qu’ils avaient remis à la conclusion de la paix, sculptent les crosses allemandes, forgent les bagues, accouplent en paniers les douilles d’obus. Toujours pas de canon. L’heure que nous nous étions fixée pour croire à la fin de la guerre est passée d’une minute; nous nous donnons un quart d’heure encore pour être tout à fait tranquilles, puis une demi-heure, puis une heure, regagnant la paix, comme on regagnera plus tard l’arrière des tranchées, par des boyaux de plus en plus larges. Nous n’osons penser à ce que signifie ce repos, à part ceux qui prétendent que tous les Allemands sont tués par des obus à gaz. Nous n’osons pas plus y regarder de près que l’alchimiste, le feu éteint, dans sa cornue. Nous attendons que l’aube se dépose toute sur la plaine et qu’on trouve des noms de cuivre, d’or, au pied des peupliers. Nous n’osons que plaisanter et demander à Bergeot—il le ferait peut-être mais toute sa vie il aurait du remords—s’il épouserait la sœur de sa veuve.
Le capitaine refait son régiment à six compagnies.Nous rassemblons tous les papiers d’appel qu’au cours de la nuit un soldat inconnu a glissés dans nos mains ou posés sur nous-mêmes, nous secouons, pour ne perdre aucun nom, nos fagots, nos gerbes de paille et il nous reste sept cents hommes, trois capitaines, six lieutenants. Nous pouvons désormais compter sur eux, car les civières rentrent vides de leur sortie matinale, à part une seule, de laquelle un soldat nous crie qu’il est le dernier blessé. Il est blessé au bras; le général lui serrera la main. Barbarin qui mettait au courant son carnet d’Alsace, quand la bataille éclata, le reprend et, pour me redonner la mémoire, me fait épeler les mots.
—Le bourg avant Thann?
—Aspach.
—Le bourg de la poule?
—Bellemagny.
Voici le ravitaillement.Voici un pain aigrelet, d’un blé qui n’a pas vu le soleil.Nous comptions qu’on nous porterait les trois mille rations habituelles, mais le lieutenant du convoi, homme sans cœur, n’a pas voulu supposer qu’aucun de nous n’était tué, et a supprimé sans remords deux mille rations.Voici Guillemard, qui arrive en auto des Invalides, où il a porté notre drapeau allemand.Le général Gallieni lui a donné la médaille et cinquante francs.C’était la première fois qu’il allait à Paris: il a pu voir la Tour Eiffel au moins dix kilomètres, pendant le retour, car il était assis dos au chauffeur. Il n’a aucune nouvelle; il a oublié de demander comment cela allait, le général ne lui parlait que de sa famille; la prochaine fois que nous prendrons un drapeau, il faudra convenir de rapporter le journal.
Sept heures.Le vaguemestre et moi n’y tenons plus.Nous partons à bicyclette vers les peupliers par la route de Nogeon.A toute allure.C’est un barrage qui vient de s’ouvrir devant nous.Galopant sur des chevaux sans selle qu’ils ont trouvés, des fantassins au torse nu s’amusent une minute à nous escorter et, malgré nous, au lieu de leur parler, nous faisons la course.Dans les champs, les hommes enterrent les morts dans de larges tranchées, les collant l’un à l’autre ou les espaçant selon ce qu’ils croient de la mort, et si l’un des tués est trop grand, plutôt que de le plier, l’étendant de biais sur les autres.Des patrouilles s’égarent à la recherche de petits arbres ou de poutres, selon ce qu’elles croient de Dieu, pour marquer les tombes, et chacun revient portant sur ses épaules le bois brut d’une croix lourde ou légère.De petits feux, où l’on fait rougir des pointes de baïonnette pour graver les noms; des chevaux enduits de pétrole qui flambent; des adjudants qui distribuent avec parcimonie de la chaux vive et nous suivent d’yeux menaçants, curieux de savoir ce que peut bien aller faire un vaguemestre en avant des lignes. Des ombres de nuages immobiles marquent les champs comme des meurtrissures. Tous les hommes amaigris, hâves, et presque semblables à force de ne plus recevoir qu’une maigre pâture biblique, les deux aliments secs et seuls, viande et pain, pain et viande. Le silence des premiers temps où n’existaient point encore les petits animaux, les coqs, les oiseaux, les chats. Echouée sur un monticule, comme après un déluge, une arche recouverte d’une bâche, les roues brisées et d’où l’on retire un homme dont le bras pend, pauvre être unique. Le bruit métallique des plaques d’identité qu’un soldat du génie enfile dans un lacet, triste monnaie chinoise pour vendre nos tués. Le groupe des morts inconnus, alignés, chacun avec un genou plié, ou un bras levé, ou le sourcil droit qui se fronce, ou la tête obstinément raidie vers la gauche, comme un geste convenu auquel devra le reconnaître son meilleur ami. Un mort tout menu, tout léger, et les fossoyeurs sont plus tristes d’enterrer un esprit. Voici Nogeon, où l’on retrouve le commandant Gérard, étendu face contre terre depuis mardi matin, et qui meurt pendant qu’on le retourne. Nous prenons la route de Vincy, déserte, malgré nous appuyant vers le côté droit, vers les Français encore épars. Sur eux le violet, le rouge boueux sont devenus un violet vif, un rouge vif. Leur barbe a déjà poussé, et tous sont arrivés vétérans à l’enfer le plus proche, mais nous voyons rarement les visages, les couleurs de l’uniforme semblent surnager bien au-dessus d’eux et flotter sur les betteraves. De ci de là surgit une baïonnette; des fusils lâchés pendant l’assaut sont piqués en terre la crosse droite; un mort debout, mais qui déjà s’alourdit, qui tombera si le secours n’arrive; un autre plaqué contre un support de mitrailleuse, et semblent avoir été pris par une tempête. Mais du côté allemand, c’est bien le massacre, cadavres gris, sans armes, aux visages si morts qu’ils paraissent avoir été tués après s’être allongés pour mourir, amas où le mort du dessous semble parfois moins mort que celui du dessus, et être venu avec cette charge au combat. Au pied de chaque peuplier, des hommes brisés comme tombés du faîte. Mais à Fosse-Martin des clairons sonnent. Il faut revenir.
L’ordre est arrivé de nous tenir prêts.Est-ce pour partir en avant, est-ce pour reculer?Est-ce pour regagner le pauvre chapelet des gares de Ceinture, le Bourget, Rosny, ou pour ouvrir enfin notre éventail de villes, Soissons, Laon, Coblentz? Angoisse des plus grands examens, après l’oral. Dernière promenade à l’ambulance où ne reste plus qu’un mourant dont s’approchent à tour de rôle, car il y a eu visite ce matin, tous ceux qui ont un furoncle, un panaris, mais on sonne le départ et de la porte j’aperçois au loin Drigeard qui met son sac, m’invite à courir, me montre le fond du village, d’un geste qui semble indiquer la route et—j’en frémis encore—me laisse croire que nous reculons.
Il me montre le général, à cheval, qui tend le bras vers nous, vers l’avant.
⁂
On ouvre l’arbre qui barrait la route; chaque peuplier décharné se lève aussi sur l’accotement comme le poteau d’un passage à niveau.On siffle les hommes les plus pressés, qui ont franchi le remblai et avancent à petits pas, essayant comme un gué cette campagne libre.Nous partons, mais l’état-major a calculé les heures de départ et les distances comme s’il s’agissait d’un régiment neuf; les deux bataillons flottent dans cette route trop large.Renonçant aux pierres des kilomètres, nous nous reformons et nous resserrons entre des bornes plus modestes.
C’est le départ pour une seconde guerre.Nous ne nous connaissons plus.Les hommes qui restaient des compagnies supprimées sont distribués dans les autres, veulent rester groupés et les coupent en tronçons.Grands et petits sont mélangés, l’immense Berquin qui nous servait de pylône n’est plus qu’à dix mètres de nous et il semble que notre vue soit faussée.Une presbytie cruelle nous montre distinct le guide même du régiment, et chacun des soldats dont on ne pouvait autrefois, de si loin, deviner les traits.Chaque silhouette jadis incertaine a maintenant un petit visage et vous regarde.Les barbes ont poussé, les cheveux.Souliers et jambières, desséchés et privés de graisse, ont l’air d’envelopper des jambes mortes.Dans cette section, tous se taisent, les bavards en ont été tués, et dans celle-là, sans doute, les bonnes âmes, car tous y ont le regard dur.Chacun occupé de son sort, les cuisiniers en surnombre rongés par la pensée qu’on va supprimer leur emploi, les ordonnances dont les officiers sont morts cherchant tenacement à savoir quels officiers survivants ont perdu leurs ordonnances.Des sous-lieutenants veulent monter le cheval de la compagnie, et, peu cavaliers, imitent instinctivement les gestes et les manies du capitaine mort.Aux haltes, poussé par l’habitude vers des camarades ou des officiers absents, on se retrouve seul, abandonné, et l’on se tourne avec reconnaissance vers l’arrière du régiment, qui n’a pas trop changé, vers le docteur Mallet, vers Laurent, vers tous ceux qui ont réussi à garder étroitement unis leur corps et leur nom, vers le cheval de Ramonchamp que nous ne pouvons atteler et qui suivra haut le pied toute la guerre, vers tout ce qu’il y avait de stable dans notre passé!Nous avons laissé les peupliers sur notre droite et nous suivons, jusqu’au delà de Bouillancy, la ligne de bataille du 7ᵉ corps.Retirés et adossés au gazon du talus par des mains pieuses, tous les morts qui étaient tombés si durement sur la route et les cailloux.Pendant les pauses, nous nous confondons avec eux, assis ou étendus, puis le sifflet résonne, et, injuste jugement dernier, nous seuls nous relevons.Des livrets militaires, où l’on cherche par habitude quelles punitions ont eu à la caserne les tués auxquels ils appartenaient, bien peu savaient nager.Aux carrefours, des cavaliers, puisque c’est le destin de la cavalerie de tomber là où les routes forment un soleil.Bouillancy en ruines; des maisons branlantes les soldats ont retiré ce qui restait de meubles pour les installer dans la cour d’arrière ou d’avant, les tables et les chaises, les armoires, quelques glaces et quelques tableaux à ras de terre, nouveau plan de la maison sur lequel il suffira de reconstruire une toiture. Puis les morts s’alignent sur nous, s’orientent soudain selon la route, vers le Nord, et nous sortons de la bataille suivant son méridien lui même.
Tous nos morts nous précèdent, légers, sans sacs, et nous, nous sommes sans désirs, sans souvenirs.Puis chacun, peu à peu, essaye de savoir ce que l’autre a vu de plus triste.Chacun regarde l’autre avec étonnement.Ce qui lui est arrivé lui semble irréel, mais ce que l’autre raconte est si vrai, et nous frémissons du récit des tristesses moitié moins cruelles que celles que nous avons subies sans frémir.Quel langage atroce nous avons maintenant!A toute question désormais une réponse horrible, comme si s’amincissait dans le cerveau, à mesure que se rapprochent les Français et les Allemands, ce qui sépare la logique de la folie.Cette lueur?c’était nos blessés qui brûlaient dans la ferme Nogeon.Ces points noirs?c’était une classe qui fuyait sous les obus; et tout juste si les vieilles lois se rétablissent, si les récits ressemblent aux vieux récits de guerre, à mesure que les grades augmentent et qu’on arrive aux généraux.Au fond de nous, une vie de civil sèche et sans attrait.Dollero n’aime plus et n’épouse plus son amie; Mourlin est las de son école, et que peut bien penser aujourd’hui le secrétaire du commandant, le professeur d’histoire de l’art, de Bourges ou de Sainte-Trophime. Il a un regard vague, sans lumière; malice, candeur ont été secouées de ses yeux comme d’un vitrail. Son lorgnon aussi est cassé. Il va sur la pointe de ses gros souliers qui le blessent, avec toutes les précautions d’un marcheur qui sait depuis quelques jours la terre bien mince. Dans quelle soirée divine, comme les fleurs japonaises dans leur assiette d’eau, l’été, pourront à nouveau pour lui éclore Saint-Rémi de Reims, Vezelay, Issoire, le granit et le marbre? Après quel dîner de paix reprendra-t-il son offensive interrompue contre le gothique, l’arc roman inscrivant son sourcil heureux? Il songe seulement qu’il avait l’habitude de marcher sur le côté gauche de la route, qu’il doit marcher maintenant du côté droit, et qu’au fond tout est bien, et que ses semelles seront également usées.
Voici un trou avec des pierres de taille, un écriteau nous rappelle que cela se nomme la carrière.Voici des arbres qui ne s’écartent pas les uns des autres à notre approche, chaque chêne surveillant son bouleau, chaque bouleau son frêne, les aulnes et les ormes les bordant, cela s’appelle la forêt.Le ciel est tout bleu, les vents s’apaisent la saison effarée se rassure peu à peu; nous sommes inondés de soleil; l’automne, au lieu de s’appuyer à des frondaisons sans âmes, se confie au régiment même, tout doré, et sur les pentes qui nous déversent loin de notre arène, il nous sèche et nous réchauffe dans nos capotes traînantes et blanches de boue comme des mouches échappées à un bol. A chaque tournant, dans chaque bosquet, il nous redonne une des choses que nous avions oubliées, laissé tomber de nous, le château, le ruisseau, la chapelle, et nous les reprenons en nous comme des choses perdues. Ceux qui, modestes, marchaient dans la paix les yeux baissés, souvent récompensés par une pièce de nickel, retrouvent aujourd’hui une voie ferrée, un étang, et nous retrouvons aussi, un par un, tous abandonnés, affamés, passionnés à nous suivre, les animaux, la brebis, la chèvre, le bœuf et tous leurs cris. Entre des maisons désertes, celui qui savait retrouver entre deux pages des fleurs sèches, retrouve de vieux géraniums-lierre, des zinias, des balsamines brûlées, et soudain les roses elles-mêmes, épanouies; et voici enfin les trois armoires à glace d’un village rangées par les Allemands en fuite face à la route, de sorte, ô le plus hâve et le plus amaigri d’entre nous, que tu as trois fois pour te reconnaître!
Jeudi.
Le soleil a maintenant mille rayons visibles, comme quand on va, le soir, de Marly à Versailles.La bataille est finie, car la brigade nous reprend tous les droits qu’on laisse à l’infanterie les jours de combat: on nous défend de tirer sur les avions allemands, de partir en patrouilles quand nous sommes curieux, de monter à cheval sur les chevaux trouvés...On nous reprend une victoria...On n’a plus besoin de nous.
Un peu avant Lévignen, des dragons nous passent cependant une ambulance allemande.Son pharmacien, Magnus, habitait Paris et c’est lui qui nous répond.Dans les sacs des majors quelques trouvailles.
—Pourquoi ce buste de Carnot?
—C’est Carnot?
—Pourquoi ces souliers d’enfant?
—Mais pour nos petits enfants.Ce sont de jolis souliers.
—Bergeot!Viens regarder les majors!
Quand nous ne sommes pas contents d’un prisonnier, nous le faisons regarder par Bergeot, qui a les yeux rouges et fixes.Il s’approche et une minute entière inflige à Magnus le supplice du regard.Dans Lévignen, que les Allemands ont miné, deux explosions.Bergeot revient sur Magnus.Troisième explosion.Bergeot le prend par les épaules.
—Ce n’est pas de la traîtrise, explique Magnus, c’est le sort de la guerre.
—Taisez-vous!
—C’est le destin des armes.
—Taisez-vous!
—Je me tais.J’y suis obligé...
Bergeot satisfait explique aux autres prisonniers que nous avons pris un drapeau et montre la compagnie qui défile.Les hommes sont trapus, ils se taisent, et l’ambulance serait impressionnée sans le lieutenant Tancliat, qui, à cheval pour la première fois de sa vie, est vraiment de côté sur sa selle.D’un mot je le redresse dans la pensée de mes captifs:
—Voici le lieutenant qui a tué le général von Sastrow.
Il n’a point tué de général, et moins que tout autre le général de Sastrow, qui avait quatre-vingt-cinq ans quand je visitai, à Munich, sa collection d’empreintes de pied dans le marbre.Mais Magnus pâlit quand Tancliat, poussant noblement son cheval en le fouettant de ses rênes sur l’oreille et d’une baguette sur la croupe, le pied gauche impuissant à trouver l’étrier, s’approche de notre groupe et me tend—je ne la prends qu’au bout de quelques secondes, pour qu’on la voie blanche et soignée—sa main meurtrière.
La nuit fantasque n’a point ce soir voulu tomber seule et il pleut.Les bouteilles abandonnées debout par les Allemands seront demain matin à moitié pleines.Pluie qui nous rend le passé, car il n’a plu qu’une ou deux fois depuis la guerre, et nos souvenirs de la dernière averse de paix sont précis comme ceux du phénomène le plus rare, comme celui de la dernière éclipse.La dernière fois qu’il pleuvait, je prenais un vin blanc gommé au Café Helvétique, et il y avait dans le journal un triolet contre le maire.L’avant-dernière fois qu’il pleuvait, je mariais mon ami Jusse.Une fois aussi, sous la pluie, j’ai vu Québec, j’ai vu Naples, et je me souviens même de la première fois,—où, surpris, je pleurai.Lévignen est à peu près désert.Nous sommes logés dans une grande et riche ferme, où nous mettons de l’ordre, car les Allemands viennent de la quitter. Au premier étage, ils ont pillé dans les tiroirs toutes les photographies de jeunes filles et les ont mises en cercle dans le cadre de chaque miroir. Leur visage était le centre de ces visages innocents. Nous replions les chemises de femmes, nous rebouchons les flacons, nous pendons les robes. Nous sommes calmes et ordonnés, comme si nous venions, au lieu de battre les Prussiens, remporter sur nous-mêmes je ne sais quelle victoire.
⁂
Les Allemands ont envoyé le brouillard, le froid, la pluie, pour que chaque élément retarde de quelques minutes la poursuite.Poursuivons-nous, oui ou non?C’est l’aube et l’on s’impatiente.Heureusement, nous sommes devant une maison bourgeoise et elle nous distrait une heure; on s’appuie d’abord contre elle, puis on la visite comme nos descendants, au trentième siècle, aimeront la visiter, en se promenant par groupes dans les salles.Voici une pièce avec des dressoirs, c’est là qu’on dîne.Une autre pièce avec deux lits, c’est là qu’on couche.Une autre avec la lampe à colonne et des housses, c’est là qu’aux jours fériés on se réunit entre intimes pour tirer au clair quel est le temps. Nous glissons sur le parquet comme dans un vrai musée; nous allons refaire nos souvenirs d’enfance dans l’office tout noir, dans le cachot de l’escalier, là où les photographes révéleraient leurs plaques. Devant nous, les terres brunes où un territorial, pressé dans son labour par l’ordre de route, a cassé deux charrues qu’il a laissées là, enfoncées. Une aurore née à cent mètres de nous, toute froide. Notre seule distraction est un soldat de Peaupié, qui a perdu la mémoire et auquel les camarades s’amusent à donner de faux souvenirs.
—Tu te rappelles les deux uhlans de Mulhouse, que tu as tués?
—J’ai tué deux uhlans?
Il fait mettre par écrit ce qui lui est arrivé, mais en protestant contre l’assurance qu’on lui a vu manger une demi-livre de Bavarois.
Le 60ᵉ nous dépasse; il se dirige sur Crépy-en-Valois, précédé de sa musique à laquelle l’arrière crie de marcher moins vite, car les musiciens qui ont porté des blessés toute la semaine se trouvent légers sous leurs seuls instruments.Le colonel Mac Mahon est en tête.Nous affectons d’en être surpris.
—Tiens, vous avez encore votre colonel?
Ils s’excusent, il est légèrement blessé.
Départ.Nous traversons les labours pour dépasser sur la route de Gondreville le reste de la brigade.Nouvel arrêt.Le général fait appeler les colonels, les commandants, et l’on voit se diriger vers lui des capitaines, des lieutenants.Ils reviennent, demandent eux-mêmes les commandants de compagnie, les chefs de section, et l’on voit venir vers eux des sergents, des caporaux, un simple soldat.Distribution de cartes aux officiers.Dans la carte nº 32, on ne voit déjà plus la place où nous nous sommes battus.On voit la forêt de Villers-Cotterêts en forme de V, première lettre du mot Victoire, dit le général, qui cherche sur les forêts des cartes suivantes, mais en vain, le reste du mot.On trouve tout juste un Y avec les bois de Saint-Gobain.Nous avançons.Sur l’accotement, de gros champignons arrachés, et d’autres plus petits mais debout, ceux qui ont poussé depuis le passage des Allemands.
Gondreville.A cheval sur le mur, qu’ils excitent d’une badine quand passe un cavalier, deux gamins qui agitent leurs bérets et qu’on sent surveillés, derrière leur perchoir, par une grande personne qui les tire par les pieds et les remet d’aplomb.Au perron de la maison forestière, deux fillettes.On veut nous habituer peu à peu, par la vue de leurs enfants, à revoir des civils. Elles crient, elles nous lancent du lard, du pain. Le canon résonne devant nous:—Ce n’est rien! C’est la bataille qui finit! crient-elles. Elles sautent, elles dansent. Pour toucher nos mains, elles passent la main à travers la rampe du chalet, puis le bras, puis l’épaule. Nous pouvons au passage tirer leurs cheveux, feindre de nous accrocher à eux pour nous arrêter, appuyer sur leur petit nez, pincer leurs joues.
Toujours le canon.Nous buttons contre la cavalerie qui s’arrête.Ce n’est rien, penseraient les fillettes, c’est la bataille qui recommence.Assis dans la mousse, engourdis, nous avons recours au feu pour nous secouer un peu.Nous versons du pétrole sur un nid de guêpes, et les flambons.Nous répandons la poudre de cartouches allemandes et la faisons partir.Nous enflammons un coin de journal vieux de trois mois que lit Jalicot.Le feu est la seule gaieté ou la seule plaisanterie que nous ayons encore prête et, les allumettes étant rares, nous nous le passons comme aux premiers âges, nous devons jouer sans arrêt.Soudain, débouchant de la forêt, à bicyclette, un enfant de quatorze ans nous apporte du vin, du jambon.Il vient de Vaumoise, où les Prussiens ont séjourné dix jours; cette bicyclette était à son frère qui avait seize ans et qu’ils ont tué, car ils tiraient sur tous les enfants à bicyclette. Il repart au galop nous chercher à boire, Vaumoise n’est qu’à six kilomètres, il se retourne sur sa machine pour nous dire au revoir, il tombe. Son pauvre genou est en sang, il repart. Un autre bientôt, puis deux, puis trois, puis d’allées diverses, tous ceux sur lesquels auraient tiré les Prussiens, de plus en plus âgés, de sorte que nous ne sommes pas trop surpris de trouver, à la sortie de la forêt, deux vieux mendiants, auxquels nous demandons des allumettes et qui, rouges de confusion et de joie, font pour la première fois, avec maladresse, le geste de donner.
Vauciennes.Le soleil est éclatant.La route tourne et tourne, nous donnant ce cœur à hélice qu’on a dans les excursions.Voici le bourg, nous rasons les maisons à un centimètre comme les troupeaux qui ne veulent point se tromper.Un uhlan étendu sur une botte de paille, devant une grille, nous oblige cependant à un détour.Il a reçu une balle dans la poitrine et agonise.Il a les yeux ouverts, et depuis dix minutes voit se pencher sur lui nos têtes.Il verra toutes celles de la division, s’il vit encore une heure.Il nous regarde, lucide, étonné qu’il n’y ait pas eu encore une brute sur mille soldats pour l’insulter et il a presque envie, confiant, de refermer les yeux.Un peu plus loin sur la gauche, un cuirassier prussien aussi est étendu, mais il faut avoir bien vif le désir de voir agoniser un ennemi pour prendre la peine de traverser la route, et celui-là meurt tout seul, en criant.
Huit heures.Nous sommes aux portes de Villers-Cotterets.Les premières maisons semblent vides.Nos dragons les contournent pendant que notre patrouille—polie, mais on est en France,—frappe aux portes avec les heurtoirs ou tire les sonnettes.A un premier étage enfin des volets s’entr’ouvrent, lentement, et les fusils se dressent, mais c’est une bonne sœur en cornette qui apparaît, nous voit, lève les bras au ciel, et crie:
—Ils sont partis, les cochons!Ils sont partis.
Nous l’entendons qui descend l’escalier.Elle heurte des bouteilles vides dans le couloir.
—Quels soiffards que ces brutes!Voulez-vous boire, mes petits?
Elle nous embrasse, fait tomber nos képis avec sa cornette, aperçoit l’inscription marquée en allemand sur sa fenêtre:
—Ah!mes petits enfants, effacez-la!Non je l’efface moi-même.Laissez!Laissez!Ne salissez pas vos mouchoirs!
Pauvres mouchoirs, que nous avions tirés, boueux, rouillés.Les larmes lui en viennent aux yeux. Nous, ignorant, depuis si longtemps que nous n’en avons vus, qu’on répond aux gens qui vous parlent, nous nous taisons, compassés et stupides. La compagnie nous rejoint par le fossé, spectacle impressionnant pour une carmélite, car nous avons gardé les lances des hussards, des cuirassiers prisonniers ou tués, et nous portons, à nos ceintures, des collections de dragonnes. Nous avons des capotes lamentables dont les boutons de devant ont sauté et dont les boutons de derrière ont été coupés par nos suivants de file, des cuirs usés par la terre comme à la pierre ponce. La sœur remonte chercher une brosse. Mais nous sommes partis.
La zone des maisons isolées est franchie, la ville est habitée et déjà les habitants accourent.Après tant de villages abandonnés, tant de bourgs creux, la vue de ces gens qui ont vécu à l’intérieur de leur ville, avec des maisons vides autour d’eux, comme un insecte dans l’eau protégé par ses bulles d’air, nous serre le cœur.Ils viennent vers nous en criant, étonnés, après douze jours d’un mortel silence, de l’éclat de leurs voix.Les propriétaires qui regagnaient les maisons abandonnées s’arrêtent la clef sur la porte, et oublient d’entrer pour agiter vers nous leurs mouchoirs, car ils sont nu tête depuis plus d’une semaine et les chapeaux sont à l’intérieur. Voilà des fillettes, des femmes, des vieilles et nous avons l’impression de reconnaître chaque personne alors que nous reconnaissons seulement chaque âge. Les femmes nous retiennent, les hommes nous stimulent:
—Reposez-vous un peu, laissez-les courir!
—Allez-y.Vous les avez!
Les derniers sont partis voilà une heure.Nous nous hâtons; l’artillerie nous a rejoints, donnant à l’armée son véritable bruit, mais nous séparant du trottoir gauche, et nous ne parlerons plus qu’aux gens du côté droit.On pensait à nous acclamer, de vieux domestiques apparaissent aux balcons bourgeois avec des drapeaux cousus en cachette, et l’on sent que pendant huit jours Villers a rassemblé dans ses caves tout ce qui était blanc, et bleu, et rouge, mais on nous voit si hâves et si décharnés que l’on ne pense plus qu’à nous nourrir.Seul, d’une fenêtre, un vieux monsieur continue à nous photographier sans relâche, il usera toutes ses plaques dans cette heure, il en userait une par soldat s’il s’écoutait.Quand l’un de nous se retourne vers lui, il ne peut résister et l’on entend le déclic.
—Ah!si vous pouviez poser, nous crie-t-il!
Des fenêtres on tend avec hâte tout ce qui reste dans la maison, comme si c’était pour le sauver, comme si les Allemands étaient dans la cour. Les enfants courent de nos rangs aux portes, assurant le service, le ralentissant quand ils mettent en travers une des lances que nous leur avons données. Une dame qui ne doit pas être de la rue nous suit en distribuant du chocolat, mais de temps en temps, par tablettes, pour avoir à nous suivre jusqu’au bout.
—Quand sont-ils partis?
Elle croit que nous cherchons un compliment.
—Ah!oui!vous les avez battus!Ah!pauvres enfants!
Nous voyons de loin les habitants effacer ou gratter avant notre passage les inscriptions, enlever les bouteilles vides, relever des chaises de jardin, réparer tout le désordre allemand, comme si nous ne savions pas que les Allemands étaient restés là.Des groupes sont pris de sympathie subite pour l’un de nous.
—Ah!regarde le grand brun!Ah!regarde le gros rouge!
Mais on contient sa passion, et les voisins ne reçoivent pas moins que le favori.De chaque fenêtre, on nous crie:
—Que voulez-vous?
—Des allumettes!
On nous distribue le paquet d’allumettes, chacun en a deux, le dernier même, c’est la chance, en a trois.
—Du savon!
Le savon sort, par carrés de Marseille, puis par savonnettes, puis on nous donne la savonnette entamée.De vieux messieurs nous demandent le numéro des régiments qui nous suivent, car ils auraient préféré peut-être, au fond de leur cœur, être délivrés par leur fils, ou leur petit-fils, ou leur gendre, mais après tout qu’est-ce que cela fait!et ils nous accompagnent une minute, par politesse, nous demandant d’où nous venons.
—D’Alsace.
Ils deviennent un peu plus cérémonieux: que ce devait être beau quand nous sommes entrés à Mulhouse!Quels étaient les numéros des régiments qui étaient avec nous là-bas?
Des vieilles nous suivent, donnant leur sucre morceau par morceau.Sous nos capotes, elles ne reconnaissent personne, et, comme elles marchent à notre pas sans s’en douter, elles donnent toujours au même.Dans leurs tabliers empesés, leur bonnet gauffré, elles regardent avec humilité nos déchirures, nos taches, elles demandent si nous allons loger dans la ville, elles nous blanchiraient, et aussi, pendant une courte halte, elles hasardent enfin la question qui les torture:
—Vous avez eu des blessés?
—Oui.
—Et des tués?
—Oui.
Elles n’osent pas nous demander le nombre exact.Elles sentent en elles augmenter peu à peu le chiffre de ceux qu’elles sacrifient; il y en a peut-être eu dix, quinze, vingt, mon Dieu peut-être trente.
—Cinq cents, dit Bergeot.
Elles sont atterrées.Bergeot dit qu’il exagère peut-être et maintenant leur pensée malhabile, peu à peu, de ces cinq cents morts sauve un par un quelques survivants, dix, quinze, puis vingt.C’est un peu comme si leur revenaient ceux-là justement qu’elles avaient acceptés pour morts.Ah!si seulement il pouvait s’en sauver trente!
Nous repartons.Ici l’on ne donne que des objets pour enfants,—c’était la maternelle,—de petits mouchoirs, de petits pots de confitures, de petits pains.Là des femmes ont sauvé du vin et nous le versent par litres.Au milieu de la route, un ouvrier agite une bouteille et la vide dans nos quarts.
—Buvez, buvez, dit-il, ils ont tué mon fils.
C’est du byrrh.
—Gardez-en pour vous, dit Bergeot ému.
—Buvez, ils ont tué mon fils.
Nous en acceptons une goutte.Il en aura pour dix minutes à tout vider.Nous l’entendons de loin qui répète sa phrase, puis qui appelle sa femme.Nous n’osons nous retourner pour la voir.
Maintenant, des rues bien pavées, sur lesquelles les soldats campagnards marchent avec plus de précaution, comme sur un parquet ciré.A gauche, un haut mur, et sur le faîte, à cheval, un boulanger qui nous passe des pains chauds, essayant d’équilibrer à lui seul toute la bonté de la droite.Le premier civil arrivé dans notre sillage nous devance et embrasse des parents qui pleurent.Des bourgeois, des commerçants, qui se sentirent souillés par l’invasion et en ont gardé pour toujours un regard humble, qui se sont tus deux semaines et parlent avec de grandes phrases comme s’ils ne savaient plus parler, un conseiller municipal:
—Croyez à l’expression de toute, de toute...Ah!croyez-y!
Les gamins, au milieu de nos rangs, nous aidant à tirer l’armée, poussant aux voitures; un pauvre vieux fonctionnaire, dédaigneux pour la première fois de la plaque qui orne sa maison où habitait Alexandre Dumas, confondu d’avoir pris pour une mitrailleuse le drapeau roulé dans son fourreau de cuir; un curé qui nous tend, du geste dont on distribue les médailles, des plaques rondes de chocolat. Chaque jeune fille avec sa spécialité; celle-ci nous versant du vinaigre de Bully sur les mains, ou, à notre gré, sur la tête; celle-là, de la Rose d’Orsay mais goutte à goutte; celle-là nous regardant, pleurant; cette autre criant à tue-tête à une femme que nous ne voyons pas, qui ne verra aucun de nous, et qui lui passe des confitures et des fromages par un soupirail. Là le bruit court parmi des dames affairées que nous acceptons l’eau de Botot. Parfois une maison vide, maculée de mots étrangers et qui semble comble d’Allemands. Parfois un enfant ou une vieille qui replace sur la fenêtre de la rue une cage à serins ou un pot à géraniums. Un homme en redingote au visage sévère, qui se tait, qui doit avoir le remords d’avoir parlé à quelque officier prussien, de ne pas lui avoir assez menti, qui s’agenouille pour aider à remettre ma jambière raidie et moisie, pauvre écorce. D’autres qui n’ont pensé qu’à notre retour, qui ont la joie de nous avoir attendus sans défaillance, qui nous parlent avec délire, et nous crient à distance des secrets, puisque nous n’avons pas trompé leur confiance.
—J’ai deux fils!
—Je suis fiancée!
Des voisins regardent avec étonnement la jeune fille, qui avoue tout haut à des étrangers ce qu’eux-mêmes ne savaient pas,—qui avoue qu’elle aime.Une institutrice prend à la hâte nos adresses pour écrire à nos mères, plaignant Dollero qui donne celle de son père, sa mère étant morte quand il était enfant, le consolant.Les chiens qu’on avait attachés pendant le séjour des Allemands commencent à aboyer, et délivrés, de leur premier instinct, reconnaissent des soldats et les accompagnent.
Mais il ne reste plus, pour traverser la ville, qu’un grand bâtiment, le premier offert à l’invasion, l’asile des vieillards; on aurait pu vraiment le construire de l’autre côté.Les sœurs n’ont laissé sortir aucun pensionnaire, à cause des chevaux, mais la porte cochère de la cour d’honneur est grande ouverte, et les vieux sont alignés en largeur et en profondeur dans la cour, par ordre d’âge sans doute, car les premiers sont assis, et les derniers, les plus agiles, tout tremblotants, debout sur des escabeaux.Ils ont un pauvre uniforme bleu clair, qui les eût rendus invisibles s’ils avaient fait la guerre.Ils agitent leurs casquettes, pas très vite, pauvre signal, mais les centenaires du fond ne peuvent plus voir, réclament, et alors, tous découverts,—à part les plus fragiles que les sœurs obligent à se coiffer—ils se contentent de crier Vive la France, ou, s’ils ont eu dans la jeunesse le cœur sensible, de pleurer. C’était bien une invasion pour vieillards, une semaine de plus seulement et quelques-uns d’entre eux seraient peut-être morts en terre envahie. Une sœur passe leurs décorations à ceux qui font l’honneur de l’asile, ils les accrochent d’une main maladroite, qu’ils passent ensuite dans leurs barbes, un peu fiers, semblant nous dire:
—Vous voyez, j’ai sauvé un enfant, j’ai été en Crimée, je suis resté vingt-cinq ans dans le même magasin.
L’un d’eux s’est approché jusqu’à la porte: on le laisse circuler parce qu’il a la cataracte et est habitué à se promener avec un bâton le jour même de la foire.
—Si seulement je pouvais voir, nous dit-il!Où allez-vous?
Nous allons à Laon, puis de là à Charleville, de là à Bonn.Adieu!Voilà le parc, voilà la dernière maison de la ville, la première de la forêt, devant laquelle un enfant méfiant nous regarde, se réfugiant avec passion vers son grand-père qui arrive, l’étreignant:
—N’est-ce pas que c’est toi qui as tué les Prussiens?lui crie-t-il.
Le vieux le prend dans ses bras, le console, lui répète que oui, puis, profitant de ce que le gamin cache son visage,—à la hâte, pour n’être point surpris pendant l’aveu,—du doigt il nous fait signe que ce n’est pas vrai, que c’est nous.
TABLE
| Pages. | |
| LE RETOUR D’ALSACE | 1 |
| LA JOURNÉE PORTUGAISE | 97 |
| PÉRIPLE | 113 |
| DARDANELLES | 187 |
| LES CINQ SOIRS ET LES CINQ RÉVEILS DE LA MARNE | 201 |
IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20, PARIS. —2640-3-47. —Œncre Lorilleux.