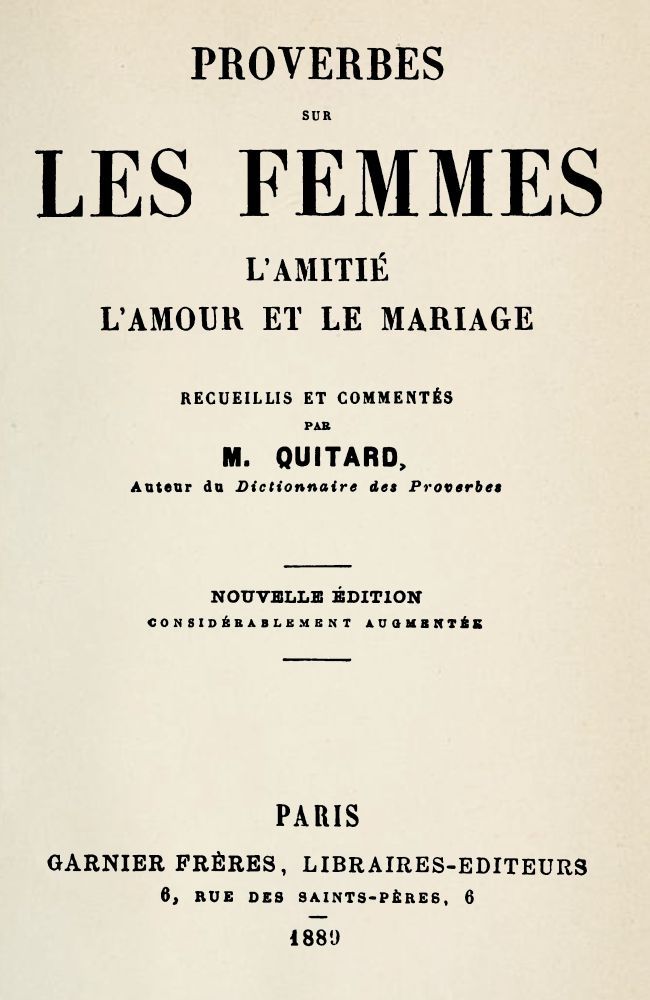Proverbes sur les femmes, l'amitié, l'amour et le mariage
Play Sample
Cette allégorie, assez diaphane, où l'on voit tout ce qui émane de la femme participer de l'esprit de méchanceté qu'on lui attribue, n'appartient pas en propre à notre trouvère.Il en a tiré l'idée de quelques traditions populaires, qui reprochent à la mère du genre humain d'avoir été aussi, en quelque sorte, celle de beaucoup de bêtes malfaisantes, qu'on suppose n'être devenues telles que par suite de la faute qu'elle commit.Cette idée, répandue presque partout, se retrouve dans une légende orientale qui nous apprend que, lorsque Adam et Ève furent créés, chacun d'eux éternua à l'instant où le souffle divin introduisit l'âme dans le corps.De l'éternuement de l'homme naquit le lion, symbole de la force et du courage, et de l'éternuement d'Ève naquit le chat, symbole de la ruse et de la lâcheté.
Cette comparaison est traduite du proverbe latin: fugax, sequax; sequax, fugax. «Suivez la femme, elle vous fuit; fuyez-la, elle vous suit. » Elle a été attribuée à Chamfort, parce qu'elle se trouve dans le recueil des pensées de cet ingénieux écrivain. Mais elle existait longtemps avant lui, comme on vient de le voir, chez les Latins qui nous l'avaient transmise ainsi qu'à plusieurs autres peuples. Le poëte arabe Zehir, qui, sans nul doute, ne l'a pas plus inventée que l'auteur français, en a fait l'application à la femme coquette, à qui elle convient mieux qu'à toute autre femme; car c'est un vrai manége de coquetterie dont l'image y frappe, en quelque sorte, la vue non moins que l'esprit. «La coquette, dit-il, ressemble à l'ombre qui marche avec vous: si vous courez après, elle vous fuit; si vous la fuyez, elle vous suit. »
La même idée a été plusieurs fois exprimée en assimilant la femme à tel ou tel objet qu'on a jugé propre à la représenter.Voici une de ces similitudes qu'il me souvient d'avoir trouvée dans une pièce du théâtre italien de Gherardi:
C'est ce qu'a dit Ovide dans le premier livre des Amours, élégie VIII: Casta est quam nemo rogavit, et que Mathurin Régnier a redit dans ce vers de la satire intitulée Macette, ou l'Hypocrisie déconcertée:
L'auteur des Lettres Persanes a reproduit la même idée en ces termes: «Il est des femmes vertueuses; mais elles sont si laides, si laides, qu'il faudrait être un saint pour ne pas haïr la vertu. »
Jehan de Meung, dans le Roman de la Rose, a exprimé la chose d'une manière plus énergique, mais moins spirituelle, en quatre vers que je ne citerai pas.
Quelques poëtes licencieux l'ont répétée avec un cynisme révoltant.Enfin il s'est rencontré des écrivains privés de tout sens moral, qui, prenant au sérieux ce que les autres n'avaient avancé que par jeu ou débauche d'esprit, ont osé développer, dans des pages sans raison comme sans pudeur, cette abominable opinion des Esséniens[5]: qu'il est impossible à toute femme d'être chaste et fidèle.
[5] Les Esséniens ou Esséens étaient des sectaires juifs qui commencèrent à faire parler d'eux vers le temps des Machabées. La mauvaise opinion qu'ils avaient des femmes les avait portés à proscrire le mariage et à vivre dans le célibat.
Que deviendrait la famille, que deviendrait la société, que deviendrait tout ce qu'il y a de sacré dans le genre humain, si cette infâme doctrine pouvait être accréditée? Les libertins qui la professent mériteraient d'être punis. Le beau sexe ne devrait avoir aucune relation avec ces effrontés renieurs de sa vertu, et les hommes les devraient bannir des assemblées publiques. C'est ainsi que nos aïeux les traitaient dans les siècles chevaleresques. Ils chassaient des tournois ceux qui étaient convaincus d'avoir mal parlé des femmes, contrairement aux statuts de la chevalerie, qui commandaient de les honorer et de ne pas souffrir qu'on osât blasonner et mesdire d'ellesIls savaient très-bien que plus les femmes sont respectées, plus elles se rendent respectables.
Où trouver aujourd'hui ce respect dont nos aïeux voulaient qu'on leur offrît des témoignages effectifs?Faut-il l'aller chercher dans le pays où La Fontaine a placé la demeure de la véritable amitié?—Eh bien, oui; c'est là qu'il existe réellement.Dans le royaume de Monomotapa, les femmes sont si sévères, que le fils du roi, quand il en rencontre une, est obligé de s'arrêter, de s'incliner devant elle et de lui céder le pas.Les Cafres à demi barbares pourraient, sur ce point, donner des leçons aux Européens, qui se prétendent civilisés.
Parce que le diable sait que, pour se rendre maître de l'esprit des femmes, il n'y a pas de meilleur moyen que de chatouiller leur vanité.Comme elle est en quelque sorte le premier de leurs sentiments, comme elle se mêle à tous ceux qu'elles éprouvent, elle ne manque guère, aussitôt qu'elle est mise en jeu par la louange habilement maniée, de les entraîner dans les piéges où le grand séducteur les attend.Les filles d'Ève ne résistent pas mieux que leur mère aux illusions décevantes de la flatterie, et, si l'on consultait la liste infinie des victimes de la séduction, on verrait que presque toutes ont été perdues par la flatterie plus encore que par l'amour.
Ce proverbe a été mal compris et mal expliqué par tous les parémiographes, qui n'ont pas vu que le verbe cuider y est employé à la troisième personne du présent du subjonctif et non de l'indicatif. Il ne signifie donc pas chacun pense, mais que chacun pense, etc. Ce n'est pas un fait qu'il énonce, c'est un conseil qu'il donne, en usant d'un tour de phrase elliptique autrefois fort usité et conforme à l'expression latine quisque putet (que chacun pense…) . Le fait ne peut être vrai qu'exceptionnellement, à l'égard d'un fort petit nombre de maris que leurs femmes savent tenir, par un art merveilleux, dans les illusions de l'optimisme conjugal. —Quant au conseil, il est plein de raison, et ceux à qui il serait possible de le mettre en pratique s'en trouveraient parfaitement bien. Sancho Pança disait: «La sagesse en ménage est de croire qu'il n'y a qu'une bonne femme au monde, et qu'on l'a rencontrée. »
On sait que le vif-argent, ou le mercure, est impossible à fixer, et que la cire est susceptible de prendre toutes sortes de modifications.Par conséquent, si l'esprit et le cœur féminins sont justement assimilés à ces deux objets, il faut reconnaître que cet esprit est des plus mobiles et ce cœur des plus changeants.On pourrait dire pourtant que la comparaison, établie par le proverbe, entre la cire et le cœur, pèche en un point: c'est que la cire, lorsqu'elle a vieilli avec l'empreinte qu'elle a reçue, en refuse une autre, au lieu qu'une vieille impression faite sur le cœur n'en exclut pas une nouvelle.Mais on objecterait qu'il ne s'agit pas ici d'un vieux cœur de femme, sur lequel d'ailleurs on ne cherche jamais à faire quelque impression.
C'est un fait réel et renouvelé chaque jour dans un salon de réception, que, lorsqu'une dame s'est levée pour en sortir, elle y reste encore, et, sans reprendre son siége, continue la causerie durant un temps qui double au moins celui de sa visite. Mais pourquoi agit-elle ainsi? Est-ce parce qu'elle espère que ses compagnes, en la voyant debout et prête à partir, seront moins impatientes de lui ravir le dé de la conversation? ou bien parce qu'elle compte que cette attitude, plus favorable au développement de ses avantages physiques dans le débit oratoire, attirera mieux sur elle les regards? On peut admettre les deux motifs à la fois, surtout chez une jolie femme; car celle-ci tient à briller par le charme de son maintien, la grâce de ses mouvements, l'élégance de ses gestes, le feu de ses yeux et l'expression animée de sa physionomie. Elle ne désire pas seulement qu'on l'écoute parler, elle désire aussi qu'on la regarde parler
La femme nettoie l'homme de bien des défauts: elle le corrige de ses instincts grossiers, et le décore d'une foule de qualités aimables, dans cet âge surtout où il est porté, par le plus doux des penchants, à lui offrir les prémices de son cœur. C'est elle dont l'heureuse influence l'initie aux manières polies, aux mœurs courtoises, et fait prendre quelquefois à son caractère sa forme la plus épurée. Tel qui se distingue par l'élévation de ses sentiments n'aurait peut-être jamais eu qu'une âme commune si le désir de plaire aux femmes n'avait éveillé son amour-propre et ne lui avait donné ce relief de noblesse et d'urbanité qui manifeste, en traits charmants comme elles, le merveilleux changement qu'elles ont opéré dans sa nature. (Voyez ci-contre le proverbe: Sans les femmes, les hommes seraient des ours mal léchés)
On dit quelquefois dans le même sens: La femme est une savonnette à vilain; ce qui est une extension donnée à l'expression savonnette à vilain, par laquelle on désignait, avant la révolution de 1789, une charge qui anoblissait et qui lavait, pour ainsi dire, de la roture celui à qui elle était concédée à prix d'argent.Il y avait alors en France une quantité considérable de ces vilains décrassés.
Il y a une maxime de Saint-Évremont qui a de l'analogie avec le proverbe que je viens de commenter; la voici: «L'étude commence un honnête homme, le commerce des femmes l'achève. » Honnête homme, dans cette maxime, doit se prendre dans la signification qu'il avait autrefois, c'est-à-dire homme aimable, élégant, qui a des manières distinguées, qui sait vivre.
Si les hommes ne vivaient qu'avec d'autres hommes, ils ne seraient pas seulement malheureux, mais grossiers, rudes, intraitables, et nous voyons que ceux qui, dans le monde, restent isolés du commerce des femmes ont généralement un caractère disgracieux et même brutal.Ce sont donc elles, on n'en saurait douter, qui préviennent ou corrigent de tels défauts et y substituent des qualités aimables, délicates, dont le principe est dans leur douce nature.Le plus rustre se polit et s'humanise auprès de ces enchanteresses; transformé par leur merveilleuse influence, il devient un être charmant.C'est la métamorphose de l'âne de Lucien ou d'Apulée.Cet animal est changé en homme après avoir brouté des roses.
L'expression proverbiale ours mal léché, par laquelle on désigne un individu mal fait et grossier, est venue d'une opinion erronée des naturalistes du moyen âge qui croyaient, sur la foi d'Aristote et de Pline, que les oursons venaient informes et que leur mère corrigeait ce défaut à force de les lécher; ce qu'elle ne fait que pour les dégager des membranes dont ils sont enveloppés en naissant.
Un ambassadeur de Perse demandait à l'épouse de Léonidas pourquoi les femmes étaient si honorées à Lacédémone.«C'est qu'elles seules, répondit-elle, savent faire des hommes.» De là ce proverbe dont le passage suivant du comte J.de Maistre explique très-bien le sens moral: «Faire des enfants, ce n'est que de la peine.Mais le grand honneur est de faire des hommes, et c'est là ce que les femmes font mieux que nous.Croyez-vous, messieurs de l'Académie, que j'aurais beaucoup d'obligations à ma femme si elle avait composé un roman, au lieu de faire un fils?Mais faire un fils, ce n'est pas le mettre au monde et le poser dans un berceau, c'est faire un brave jeune homme qui croit en Dieu et qui n'a pas peur du canon.Le mérite de la femme est de régler sa maison, de rendre son mari heureux, de le consoler, de l'encourager et d'élever ses enfants, c'est-à-dire de faire des hommes.Voilà le grand accouchement qui n'a pas été maudit comme l'autre.Les femmes n'ont d'ailleurs fait aucun chef-d'œuvre dans aucun genre.Elles n'ont fait ni l'Iliade, ni l'Énéide, ni la Jérusalem délivrée, ni Phèdre, ni Athalie, ni Rodogune, ni le Misanthrope, ni le Panthéon, ni la Vénus de Médicis, ni l'Apollon, ni le PerseElles n'ont inventé ni l'algèbre, ni les télescopes, ni le métier à bas: mais elles font quelque chose de plus grand que tout cela.C'est sur leurs genoux que se forme ce qu'il y a de plus excellent dans le monde: un honnête homme et une honnête femme.»
Il y a un mot de Napoléon Ier, non moins remarquable dans sa brièveté que l'est dans son étendue le morceau précédent: «L'avenir des enfants est l'ouvrage des mères.»
Buffon avait exprimé la même idée en ces termes dans une de ses lettres dont le recueil a été publié, il y a quelques années: «C'est la mère qui transmettra aux fils les qualités de l'esprit et du cœur.»
Je citerai encore quelques phrases de l'abbé F.de Lamennais, qui reviennent à notre proverbe: «Plus sûr que le raisonnement, un infaillible instinct préserve la femme des erreurs fatales auxquelles l'homme se laisse entraîner par l'orgueil de l'esprit et de la science.Tandis que la vaine et débile raison de l'homme ébranle aveuglément les bases de l'ordre et de l'intelligence même, la femme, éclairée d'une lumière et plus intime et plus immédiate, les défend contre lui, conserve dans l'humanité les croyances par lesquelles elle subsiste; elle en est, au milieu de la confusion des idées et des révolutions, la gardienne pieuse et incorruptible.»—«Les vérités, les lois morales, non-seulement perdraient leur autorité sur la terre, mais, altérée par mille conceptions fausses, la nature même s'en éteindrait, si, doublement mère, la femme, dès le berceau, n'initiait l'enfant à ces sacrés mystères, si elle ne déposait en lui l'impérissable germe de la foi qui le sauvera, si elle ne le nourrissait de ce lait divin.»—«Les semences primordiales du vrai et du beau, les sentiments profonds qui décident de l'existence entière, les hommes les doivent à la femme; c'est elle qui les fait ce qu'ils sont.»
Il faut laisser à chacun le soin de développer dans son propre cœur cette vérité proverbiale qui résume si bien les obligations dont l'homme, à chaque phase de son existence, est redevable à la femme considérée comme mère, comme épouse, comme amante, comme amie; car l'esprit ne saurait analyser tant de témoignages ineffables de tendresse, de dévouement et d'abnégation, qu'elle ne cesse de nous prodiguer depuis le berceau jusqu'à la tombe; et le cœur, qui les a reçus, qui en a gardé l'impression dans toutes ses fibres, peut seul les reproduire en ses suaves réminiscences. Je me contenterai de citer les vers suivants que le cœur de Ducis lui inspirait dans son Épître à ma femme:
Avoir l'œil américain, c'est regarder de côté tout en paraissant ne regarder que devant soi, comme font les sauvages d'Amérique, lesquels, ayant le sens de la vue très-développé, peuvent apercevoir distinctement ce qui se passe à droite et à gauche, sans tourner la tête.Les femmes européennes, en général, sont douées de cette faculté visuelle dont l'exercice ne dérange en rien l'immobilité qu'elles savent donner à leur visage en certaines occasions où elles voient tant de choses en regardant ailleurs.«Il est juste, dit Mme de Genlis, que la nature ait accordé un tel privilége à celles qui ne doivent jamais avoir un regard assuré, ou du moins fixe, et qui sont si souvent obligées de baisser les yeux et de les détourner. (Nouveaux Contes moraux: le Malencontreux.)
On sait que le comte de Guibert a placé ce vers heureux dans sa tragédie du Connétable de Bourbon où le premier hémistiche est dit par Adélaïde et le second par Bayard. Mais le comte de Guibert ne l'a point inventé; il l'a trouvé tout fait dans le recueil des proverbes usités en Provence. Voici le texte patois qui correspond mot pour mot et métriquement au français:
On a établi, entre les lois et les mœurs, cette différence essentielle que les lois règlent plus les actions du citoyen et les mœurs règlent plus les actions de l'homme.D'après cela, on peut conclure avec raison que l'influence des femmes est d'une importance qui la rend supérieure à celle des législateurs: car avec des mœurs on pourrait se passer de lois, et avec des lois on ne pourrait se passer de mœurs.
«A quoi servent des lois, inutiles sans les mœurs?» s'écriait Horace:
(Lib.III, od.24.)
Tant que les femmes ont fait les mœurs, les femmes ont été respectées.Ce n'est qu'en les défaisant, ce qui leur est arrivé quelquefois, qu'elles ont cessé de l'être.L'histoire nous apprend que c'est à des époques sans mœurs qu'ont été imaginées et mises en circulation ces formules injurieuses qui leur reprochent leurs torts avec une certaine vérité, il faut bien l'avouer, quoiqu'elles soient presque toujours fausses parce qu'elles sont trop généralisées.
C'est-à-dire qu'elles restent dans le rôle qui leur est assigné par la nature; car, en voulant en prendre un autre pour lequel elles ne sont point faites, elles ne peuvent s'attirer que des désagréments et des malheurs.—Proverbe qui paraît avoir été formulé, au moyen âge, d'après ce passage de Plutarque: «Alexandre, ayant défait Darius, envoya plusieurs beaux présents à sa mère; mais il demanda qu'elle ne se mêlât pas autant de ses affaires, et qu'elle n'entreprît point l'état de capitaine.»
Ce n'est point un ridicule imaginaire que signale ce proverbe. Les dames françaises, à diverses époques, affichèrent réellement des prétentions militaires, non-seulement dans leurs discours, mais dans leurs actions, comme si elles n'avaient pas eu de passe-temps plus agréable que d'imiter les Marphise et les Bradamante. —Plusieurs histoires, notamment les Antiquités de Paris, par Sauval, an 1457, parlent de capitainesses investies du commandement de certaines places fortes.Cette manie, à laquelle contribua beaucoup sans doute la lecture des romans chevaleresques, prit un nouveau développement dans le seizième siècle, lorsque l'imprimerie eut multiplié les exemplaires de plusieurs de ces livres par les soins de François Ier, qui les jugeait propres à favoriser le projet qu'il avait conçu de faire revivre l'ancienne chevalerie dans une seconde chevalerie de sa façon.
Sous le règne de Charles IX les salons étaient devenus des espèces d'écoles d'amour et de guerre, où les dames se montraient jalouses de donner des leçons dans les deux arts.Elles se faisaient un point d'honneur d'exercer en public une sorte d'empire sur leurs amants guerriers; elles les enrôlaient dans telle ou telle faction de l'époque, et les envoyaient, parés d'écharpes et de faveurs, remplir le rôle qu'elles leur avaient assigné.Quelquefois même elles leur faisaient la conduite et traversaient la ville à cheval, caracolant à côté d'eux ou montées en croupe avec eux.
Elles se signalèrent, du temps de la Fronde, par de semblables excentricités. On sait quelle fut leur influence sur les événements de cette époque. La duchesse de Longueville engagea Turenne, qui venait d'être nommé maréchal, à faire révolter contre l'autorité royale l'armée qu'il commandait. La duchesse de Montbazon gagna le maréchal d'Hocquincourt, qui lui écrivit ce billet laconique, mais significatif: «Péronne est à la belle des belles. » Les Mémoires de Mademoiselle contiennent une lettre de Gaston d'Orléans, son père, avec cette curieuse suscription: «A mesdames les comtesses maréchales de camp dans l'armée de ma fille contre le Mazarin. »
Il n'y en a point sans défaut.
La perfection n'appartient à aucun être sur la terre, et sans doute il n'en faut point chercher le modèle chez les femmes; mais les hommes sont-ils moins imparfaits qu'elles?La vérité est qu'en général les femmes ont plus de petits défauts, et les hommes plus de vices achevés.Quant aux qualités qui brillent en elles, il est impossible de ne pas reconnaître qu'elles se distinguent par des avantages que celles des hommes n'offrent pas au même degré.«Vertus pour vertus, dit une maxime chinoise, les vertus des femmes sont toujours plus naïves, plus près du cœur et plus aimables.»
Le rapprochement des femmes et des chevaux, que présente notre proverbe, n'a pas été suggéré peut-être par une pensée aussi impertinente qu'on pourrait le penser; il tient aux habitudes chevaleresques: tout paladin consacrait sa vie à l'amour et à la guerre.Pour aimer, il devait avoir une belle dame; pour combattre, il avait besoin d'un bon cheval, et il confondait ces deux êtres dans une affection presque égale, quoiqu'il fût souvent obligé de reconnaître que ni l'un ni l'autre n'étaient jamais sans défauts.
Ce dicton, qui s'entend sans commentaire, me paraît avoir suggéré l'idée d'une ancienne farce dramatique dont voici le titre: «Discours facétieux des hommes qui font saler leurs femmes à cause qu'elles sont trop douces, lequel se joue à cinq personnages.» L'Histoire du Théâtre-Français a parlé de cette pièce curieuse, imprimée à Rouen, chez Abr. Cousturier en 1558, et le docte A. -A. Monteil en a donné la piquante analyse que voici: «Des maris sont venus se plaindre que leur ménage, sans cesse paisible, était sans cesse monotone; que leurs femmes étaient trop douces. L'un d'eux a proposé de les faire saler. Aussitôt voilà un compère qui se présente, qui se charge de les bien saler. On lui livre les femmes, et le parterre et les loges de rire. Les femmes, quelques instants après, reviennent toutes salées, et, leur sel mordant et piquant se portant au bout de la langue, elles accablent d'injures leurs maris, et le parterre et les loges de rire. Les maris veulent alors faire dessaler leurs femmes: le compère déclare qu'il ne le peut, et le parterre et les loges de rire davantage. Enfin la pièce, si plaisamment nouée, est encore plus plaisamment dénouée, car les maris, qui sont des maris parisiens, c'est-à-dire des maris de la meilleure espèce, qu'on devrait semer partout, particulièrement dans le nouveau monde, au lieu de dessaler, comme en province, les femmes avec un bâton[6], se résignent à prendre patience, et le parterre et les loges de rire encore davantage, de ne pouvoir plus applaudir, de ne cesser de se tenir les côtes de rire.»
[6] Allusion à la coutume de frapper avec un bâton les quartiers de lard salé pour en faire tomber les grains de sel.
Les chevaux ont beaucoup à souffrir à Paris, les maris y éprouvent bien des contrariétés, et les femmes y jouissent de toute sorte de plaisirs.Cette triade proverbiale était autrefois d'une vérité plus incontestable qu'aujourd'hui, surtout à l'égard des femmes, parce que la coutume de Paris, plus favorable pour elles que toutes les autres coutumes du royaume, n'admettait point qu'elles fussent battues comme ailleurs, et ne prononçait point de peines sévères contre la violation de la foi conjugale.
Corneille a rappelé la dernière partie de cette triade dans la Suite du Menteur, où Lise dit à Mélisse, sa maîtresse, en parlant de Dorante qu'elle l'engage à épouser:
On connaît ce mot de Montesquieu: «Quand on a été femme à Paris, on ne peut plus être femme ailleurs.»
Il n'est pas nécessaire d'expliquer le sens de ce calembour proverbial, mais il est bon de rappeler pourquoi l'expression avoir des rats signifie, au figuré, être capricieux, fantasque. Le Duchat prétend que cette expression fait allusion à la rate d'où la plupart des bizarreries procèdentL'auteur de l'Histoire des rats la croit fondée sur la supposition qu'une personne sujette à des inégalités d'humeur a la tête remplie de rats qui s'y promènent, et qui, par leurs différents mouvements, y déterminent ses pensées et ses volontés. L'abbé Desfontaines croit avec plus de raison que rat est ici un vieux mot français tiré du latin ratum (pensée, résolution, dessein), et qu'on dit d'un individu qu'il a des rats, de même que l'on dit qu'il a des idées, pour faire entendre qu'il a des hallucinations, des lubies, des folies.
Cette étymologie rentre dans celle qu'a proposée dom Louis le Pelletier, qui assure dans son dictionnaire que ce mot a été pris du celto-breton, où il est employé dans une signification identique.
C'est-à-dire qu'il faut prendre ces messieurs avec leurs défauts et ces dames avec leurs prétentions, si l'on veut vivre en paix avec eux et avec elles.
Il est vrai que cette paix est extrêmement difficile et qu'elle doit être payée fort cher par les ménagements continuels qu'on est obligé d'avoir pour ces défauts et surtout pour ces prétentions, plus intolérables que ces défauts: elles sont si exigeantes qu'il faut tout leur sacrifier, et de plus si tenaces qu'il n'est pas possible d'en rien rabattre; ce qui a fait dire qu'il vaut mieux s'y soumettre que s'y opposer, afin de s'épargner les efforts pénibles qu'on tenterait en vain pour y résister.C'est ainsi qu'on explique cet adage, sérieux dans sa première partie et ironique dans sa dernière.Quant à moi, je ne puis voir dans cette explication qu'une glose pire que le texte, et dont la malice se donne carrière aux dépens de la vérité.Il n'est pas prouvé que les femmes aient les prétentions déraisonnables que les préventions des hommes leur reprochent: il n'y a que des folles incapables de se modérer chez lesquelles on les rencontre.Objectera-t-on que les autres ont l'adresse de les cacher; mais en supposant que cela soit, on doit leur en savoir gré, et j'aime à croire que cette conduite non moins habile que réservée leur donne le droit de répondre à leurs accusateurs que si elles tiennent à être prises telles qu'elles veulent être, c'est qu'elles veulent être réellement telles qu'elles doivent être.
C'est un fait en preuve duquel on peut citer la fable et l'histoire.Voyez Hercule abandonnant sa massue et filant une quenouille aux pieds de la reine Omphale; voyez Antoine asservi lâchement aux charmes de Cléopatre; et jugez, par ces exemples qu'il serait facile de multiplier, combien l'amour des femmes est dangereux et funeste.Il étouffe toute énergie chez l'insensé qui s'y abandonne; il le rend incapable de tout noble élan, il le tient plongé dans une mollesse abrutissante; en un mot, il lui fait oublier tous ses intérêts et tous ses devoirs.
Voilà pourquoi on dit encore l'amour des femmes tue la sagesse: ce qui a son explication suffisante dans les réflexions que je viens de présenter.Ce proverbe et le précédent ne diffèrent l'un de l'autre que par l'application particulière que chacun d'eux fait de cette vérité générale: que la passion pour les femmes a des effets pernicieux sur le moral de l'homme, et qu'elle fait souvent de lui, par l'usage immodéré des coupables plaisirs qu'elle lui présente, un animal dégradé.
Êtes-vous pauvre, détournez-vous de ces plaisirs: ils coûtent plus cher que les vrais besoins.Aspirez-vous à la gloire, détournez-vous-en de même: ils vous la feraient prendre en pitié.Voulez-vous rester bon, fuyez-les jusqu'au bout du monde: ils ne vous laisseraient pas de cœur.
Les femmes veulent plaire à tout le monde, et, pour y parvenir, elles sont obligées de jouer tant de personnages divers qu'il est bien difficile qu'en s'essayant à un pareil manége elles ne deviennent pas plus ou moins fausses.C'est sans doute sur cette observation d'expérience qu'a été fondé le proverbe, qui est parfaitement vrai des femmes coquettes, et qui ne l'est pas également des autres femmes.J'en connais plusieurs qui méritent une honorable exception, et j'aime à croire qu'elles ne sont pas les seules.Je n'oserais pourtant les compter par douzaines, et je suis forcé de convenir, pour me conformer à l'opinion la plus circonspecte, que les femmes, en général, ont, à des degrés différents, une certaine dose de dissimulation et de mauvaise foi qu'elles cachent sous de belles apparences de franchise et de sincérité, de même que les jetons ne laissent pas voir le mauvais alliage dont ils sont ordinairement composés sous la brillante dorure qui en décore les surfaces.
Pourquoi cela?N'est-ce point parce que les femmes, en général, sont peu sincères et ne font guère usage de la vérité que pour mieux tromper, quand elles savent qu'on n'ajoutera pas foi à leur parole?On ne peut, ce me semble, expliquer autrement ce malin proverbe qui fait si bien ressortir leur fausseté jusque dans son contraire.Mais l'opinion qu'il exprime est-elle parfaitement fondée?J'ai consulté là-dessus les experts les plus compétents, dans l'espérance qu'ils me fourniraient de bonnes raisons pour la combattre.Aucun d'eux jusqu'ici ne m'a répondu selon mon désir, et je suis forcé d'attendre encore entre le pour et le contre, n'ayant pas les preuves de l'un, et ne voulant pas admettre celles de l'autre.
Je remarquerai seulement que, si le proverbe était aussi vrai qu'il est ingénieux, les hommes ne sauraient éviter, soit en accordant, soit en refusant leur confiance aux femmes, d'être réduits à une alternative fâcheuse, signalée par cet autre proverbe: Qui croit sa femme se trompe, et qui ne la croit pas est trompé.
C'est ce que répétait la belle et spirituelle Ninon de Lenclos, qui vécut, pour ainsi dire, sans vieillir, inspira une passion à l'âge de quatre-vingts ans, et mourut à quatre-vingt-onze…Si elle sentait cette cruelle vérité, combien plus doivent la sentir les autres femmes qui n'ont pas, comme elle, des avantages propres à la leur rendre moins sensible.
On lit parmi les maximes de Saint-Évremont: «L'enfer pour les femmes qui ne sont que belles, c'est la vieillesse.» Est-ce de Ninon qu'il tenait le mot, ou Ninon le tenait-elle de lui?
La vieillesse est pour les femmes pire que la boîte de Pandore: elle renferme tous les maux, moins l'espérance.
La vieillesse a quelque chose de digne, d'imposant chez les hommes; mais hélas!chez les femmes, elle est terrible, désespérante, et dénuée de poésie.Elle ne fait d'elles que des ruines sans grandeur et sans majesté.
Cette comparaison proverbiale existe dans beaucoup de langues comme dans la nôtre, et elle a été employée par beaucoup d'écrivains qui s'accordent à la regarder comme vraie.Cependant, malgré cette imposante unanimité d'opinion, je ne puis me résoudre à penser avec eux que ces aimables enchanteresses perdent à se faire connaître ce qu'elles gagnent à se faire voir.Mais j'aurais besoin, je l'avoue, qu'elles voulussent bien m'expliquer le soin extrême qu'elles prennent de ne pas se laisser deviner, et l'antipathie décidée qu'elles ont contre ceux qui les devinent.Sans cela, je crains de finir par dire comme les autres:
Le plumage des paons acquiert plus de lustre avec les années, et la toilette des femmes devient plus brillante à mesure que leur jeunesse diminue, car elles cherchent à suppléer, par les prestiges de l'art, aux charmes naturels que chaque jour qui s'envole leur enlève. Comme elles ne voient pas dans l'avenir de malheur plus grand que de cesser de plaire, elles n'ont pas de désir plus vif ni d'intérêt plus pressant que de paraître toujours jeunes et belles; et, dans le nombre infini de celles qui peuvent conserver l'espoir d'en imposer sur leur âge, vous n'en trouverez aucune qui dise de bonne foi, comme la belle-mère de Ruth: «Ne m'appelez plus Noémi; nom qui signifie belle. Ne vocetis me Noemi, id est pulchram.» (Ruth, I, 20.)
Notre comparaison proverbiale s'applique particulièrement à ces vieilles coquettes récrépies qui aiment à se pavaner sous les magnifiques livrées de la mode, et prétendent éclipser les jeunes et jolies femmes par le luxe de leur parure hors de saison.
On attribue à Fontenelle cette formule proverbiale qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer; mais en admettant qu'elle soit due à son esprit, ce qui est douteux, il faut reconnaître que les parties dont elle se compose existaient séparément avant lui dans une foule de locutions analogues.Les femmes ont été assimilées à toutes sortes d'oiseaux sous le rapport des mœurs et du caractère, et elles ont avec eux des ressemblances assez frappantes pour faire penser qu'elles pourraient être étudiées dans les volières aussi bien que dans les salons.Cette étude morale formerait une nouvelle branche d'ornithologie comparée qui ne serait pas moins intéressante que curieuse.
Parce que, à la maison, elles trouvent toujours à redire à la conduite de leurs maris, et les poursuivent de reproches continuels.Un d'eux, pour s'affranchir des remontrances criardes de la sienne, qui remplissait très-bien les deux rôles, souhaitait qu'elle eût l'église pour unique domicile.Elle serait sainte, ajoutait-il, et moi bienheureux.
On dit aussi de ces furies dévotes qu'elles mangent les saints et vomissent les diables
Vieux proverbe qui signifia primitivement que la misère fait oublier la pudeur aux femmes, les entraîne à une conduite déréglée et les pousse même à la plus honteuse prostitution, car le mot folle y était mis comme équivalent de folles de leurs corps, dénomination qu'on appliquait autrefois aux femmes de mauvaise vie.
Ce proverbe s'emploie aujourd'hui pour dire que, lorsque les femmes n'ont pas dans leur ménage les choses nécessaires, elles ne cessent de quereller leurs maris dont l'avarice ou l'inconduite leur en impose la privation.
On appelait ainsi les dames de la cour de François Ier, parce qu'elles portaient des robes échancrées autour du sein qui, soutenu et relevé par une riche bande d'étoffe nommée gorgias, s'étalait dans une complète nudité.
Le clergé les réprimanda d'oser se montrer sous les livrées de l'impudicité. Jean Polman, chanoine théologal de Cambrai, dans son ouvrage intitulé le Chancre ou Couvre-sein féminin, leur reproche «de piaffer les bras nus, à sein ouvert, et à tetins découverts».
Le père Gardeau, Génovefain, fit contre elles plusieurs prédications où il prit pour texte les versets 16 et 17 du chapitre III d'Isaïe annonçant aux filles d'Israël que Dieu les rendra chauves parce qu'elles vont la tête levée, la gorge nue et l'œil tourné à la galanterie.
Un autre prédicateur, dit-on, leur recommandait d'avoir toujours sur leur gorge un fichu de toile de Hollande, et de repousser les mains téméraires des amants qui tenteraient de l'enlever, car, ajoutait-il, «quand la Hollande est prise, adieu les Pays-Bas!» Malgré tout ce que le clergé put faire et dire contre cette mode indécente, elle se maintint sous plusieurs règnes.
C'est probablement pour ridiculiser la polémique dont elle avait été l'objet que Rabelais, dans son facétieux catalogue de la librairie ou bibliothèque de Saint-Victor, s'est amusé à imaginer et à classer une ordonnance universitaire sous ce titre fort drôlatique: Decretum universitatis Parisiensis super gorgiasitatem muliercularum ad placitum. (Liv. II, ch. VII.) «Décret de l'Université de Paris sur la gorgiagiste (étalage de la gorge) des jeunes femmes selon leur bon plaisir. »
C'est-à-dire qu'elles échangent entre elles autant de paroles qu'il s'en échange dans un marché. Le proverbe italien associe une oie aux trois femmes: Tre donne e una oca fan un mercato.
On trouve dans le recueil de Gabriel Meurier: Deux femmes font un plaid, trois un grand caquet, quatre un plein marché.
Les Auvergnats disent d'une manière pittoresquement hyperbolique: Les femmes sont faites de langue comme les renards de queue; et l'on peut les en croire, car ils doivent être impartiaux, attendu qu'ils ne sont ni hommes ni femmes, mais bons Auvergnats, d'après un dicton qui circule depuis quelques années.
Il y a dans tous les pays du monde des proverbes qui s'accordent à reprocher au beau sexe une intarissable loquacité.Je m'abstiens de les rapporter, regardant comme inutile la peine que je prendrais à transcrire ces témoignages trop nombreux d'un défaut sur lequel lui-même semble avoir passé condamnation.Il vaut mieux rechercher quelles sont les principales causes de ce défaut.
Fénelon les a signalées dans les deux phrases suivantes:
«Les femmes sont passionnées dans tout ce qu'elles disent, et la passion fait parler beaucoup.
»Une autre chose contribue beaucoup aux longs discours des femmes, c'est qu'elles sont artificieuses et qu'elles usent de longs détours pour arriver à leur but.»
Montesquieu considérait leur bavardage comme une suite nécessaire de leur inoccupation.«Les gens qui ont peu d'affaires, disait-il, sont de très-grands parleurs: moins on pense, plus on parle.Ainsi les femmes parlent plus que les hommes; à force d'être oisives, elles n'ont point à penser.»
C'est, je crois, la même idée que les Chinois ont voulu exprimer dans ce proverbe: La langue des femmes croît de tout ce qu'elles ôtent à leurs pieds.
C'est-à-dire des langues de feu.L'allusion n'a pas besoin d'être expliquée; car personne ne peut ignorer que le Saint-Esprit descendit en langues de feu sur les disciples de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, et leur communiqua ainsi le don des langues pour les mettre en état d'aller prêcher la vérité évangélique chez tous les peuples de la terre.
La glose nous avertit qu'il ne faut pas conclure de ce proverbe que tout ce que disaient les femmes soit paroles d'évangile, car les langues envoyées par l'Esprit-Saint ne descendirent pas sur elles, et celles qu'elles ont n'en sont que des contrefaçons faites par l'esprit malin.
L'abbé Guillon disait, en usant d'une expression tirée d'un proverbe fort connu: «L'enfer est pavé de langues de femmes.»
Proverbe que nous avons reçu des Chinois qui, du reste, ne se bornent pas à une telle plaisanterie sur l'intempérance de la langue féminine, car un de leurs livres classiques met le babil fatigant au nombre des sept causes de divorce que les maris peuvent alléguer pour se débarrasser de leurs femmes.
Les Allemands ont fait une addition grossière à ce proverbe, ils disent: «Die Weiber führen das Schwerd im Maule, darum muss man sie auf die Scheide schlagen. Les femmes portent l'épée dans la bouche; c'est pourquoi il faut frapper sur la gaîne.»
Les Anglais conseillent et emploient un moyen qu'ils jugent plus efficace pour faire taire les femmes; c'est de leur mettre la bride du silence. Si vous ignorez ce que c'est, le Morning-Herald va vous le dire. On lit, dans un de ses numéros de la fin de mai 1838, que le magistrat de police de Straffort, jugeant une femme dont la loquacité résistait à tous ses avertissements, lui fit appliquer cette bride que le journaliste appelle une machine ingénieuse et décrit ainsi: «Elle consiste en un cercle de fer ceignant la tête d'une oreille à l'autre, et en une plaque transversale du même métal, laquelle descend du front jusqu'à la bouche qu'elle tient close, de manière à empêcher la langue de fonctionner. Cette ingénieuse machine se ferme sur le derrière de la tête. » Le journaliste ajoute qu'il serait bon que chaque tribunal eût sa bride de silence pour la montrer comme épouvantail et pour en faire usage au besoin.
On peut juger par un pareil fait de l'esprit de galanterie qui doit régner chez nos voisins d'outre-Manche, et se former une idée des licences que les magistrats se permettent quelquefois sans scrupule en ce pays de liberté.
Ce proverbe, hyperbolique à l'excès, est traduit de ce texte latin: Lingua mulierum nequidem excisa silet, qu'ont employé quelques écrivains du moyen âge.Je crois qu'il est d'origine grecque, car il se trouve pour la première fois dans la première épître de saint Grégoire de Nazianze, qui l'a peut-être inventé.L'idée qu'il exprime a beaucoup d'analogie avec une plaisanterie d'Ovide qui raconte que la langue d'une bavarde, arrachée de son palais, s'agitait par terre en parlant toujours.Étrange effet de l'habitude!
Les Allemands disent d'une manière fort originale: «Einer todten Frau der muss man die Zunge besonders todt schlagen. A femme trépassée il faut tuer la langue en particulier.»
Un auteur facétieux a prétendu que la langue, chez les femmes, n'est pas l'unique instrument des paroles, et que les bonnes commères ne resteraient pas muettes quand même elles seraient privées de cet organe. Il cite à l'appui de cette assertion l'exemple d'une jeune fille portugaise qui, étant née sans langue, n'en jasait pas moins du matin au soir. Ce qui donna lieu au distique suivant de je ne sais quel savant en us:
Voici une imitation française de ce distique:
Cet impertinent proverbe est traduit littéralement du provençal: Frémos noun soun gens. Je le crois dérivé de cette ancienne maxime de jurisprudence: Mulier non habet personam, par laquelle on déclarait que la femme n'était pas une personne devant la loi, c'est-à-dire qu'elle devait rester toujours mineure et dépendante.
J'avais d'abord conjecturé qu'il était provenu d'un autre fait auquel il s'ajuste assez bien; je le regardais comme une allusion probable à la thèse soutenue au second concile de Mâcon, le 23 octobre 585, par un évêque qui prétendait que le mot homme, dans la généralité de son acception, ne comprenait pas la femme, ce qu'un autre réfuta par divers passages de l'Écriture sainte où ce mot est employé pour désigner les deux sexes, notamment par le verset de la Genèse qui dit que Dieu créa l'homme, mâle et femelle, et par les versets de l'Évangile dans lesquels le fils de Dieu est appelé le Fils de l'homme, quoiqu'il ne soit que le fils de la femme quant à son humanité. Le concile, après une assez longue discussion, décida: Mulieres esse homines, que les femmes étaient hommes, c'est-à-dire qu'elles faisaient partie du genre humain[7]
[7] C'est ainsi qu'un ami de Cicéron l'engage, dans une lettre, à se consoler de la mort de sa fille Tullie, «parce qu'elle est née homme,» quia homo nata est
On a trouvé fort ridicule que les pères de ce concile se soient arrêtés à l'examen d'une thèse si étrange; mais c'est faute de comprendre les motifs assez graves qu'ils ont eus pour cela.Ils se proposaient, en agissant ainsi, d'empêcher, par l'autorité suprême d'une décision ecclésiastique, la propagation d'une fausse idée, renouvelée d'Aristote.Ce philosophe, sur la parole duquel on jurait alors, avait prononcé, comme un oracle, que c'était d'une erreur de la nature que provenait la femme, créature incomplète, ouvrage manqué, résultat de l'imperfection de la matière impuissante à parvenir au sexe parfait, c'est-à-dire à produire l'homme, qu'on verrait naître seul dans un ordre de choses meilleur.Et son opinion était entrée en partie dans l'esprit de quelques théologiens du quatrième siècle, qui se figuraient que Dieu, au grand jour de la résurrection générale, ne ferait revivre la femme qu'en la changeant en homme.
Ce fut, tout porte à le penser, un partisan de cette déraisonnable opinion aristotélique et théologique à la fois qui en saisit l'assemblée: elle obtint l'appui de plusieurs autres qui cherchèrent à la faire prévaloir dans des vues plus politiques encore que religieuses.Ils espéraient que, si elle était canoniquement proclamée, elle deviendrait un moyen puissant de détruire l'influence de deux reines contemporaines généralement détestées, Frédégonde et Brunehaut, qui dirigeaient les affaires publiques au gré de leurs passions et de leurs caprices.
Proverbe dont on ne fait l'application qu'en parlant des aventures qu'on leur attribue.«De ces choses-là, suivant l'historien Mézerai, on en compte toujours plus qu'il n'y en a, et il y en a toujours beaucoup plus qu'on n'en sait.» Phrase non moins spirituelle que malveillante, à laquelle ressemble beaucoup cette autre de Sénac de Meilhan: «On débite un grand nombre d'histoires fausses sur les femmes, mais elles ne sont qu'une faible compensation des véritables, qu'on ignore.»
Les Italiens ont un proverbe analogue d'après lequel, en matière de galanterie, tout peut se croire et rien ne peut se dire: In materia di lussuria, si può creder tutto, ma dirne nulla.
Parce qu'on suppose qu'elles garderaient sous cette nouvelle forme le caractère indélébile de fausseté que les mauvais plaisants leur attribuent, et que par conséquent elles ne produiraient qu'une monnaie de mauvais aloi ou une fausse monnaie.C'est ainsi que j'ai entendu expliquer ce proverbe par une femme de beaucoup d'esprit, qui se plaisait à le citer en riant.
Je n'oserais contester positivement cette explication, dont je laisse la responsabilité à son auteur.Cependant je doute que ce soit la fausseté des femmes qu'on ait eu particulièrement en vue en formulant le proverbe.Il y a chez elles d'autres défauts qui, non moins que celui-là, ont pu en suggérer l'idée; et c'est peut-être par allusion à l'inconsistance et au mauvais alliage que ces défauts réunis produisent dans leur nature, qu'on a dit qu'elles ne vaudraient rien à faire monnaie, en sous-entendant ces mots: parce qu'elles ne seraient pas malléables.
Cette raison toute naturelle est indiquée par un proverbe italien qui correspond au nôtre: «Se le donne fossero d'argento, non varrebber' un quattrino, perchè non starebber' al martello. Si les femmes étaient d'argent, elles ne vaudraient pas quatre deniers, parce qu'elles ne tiendraient pas sous le marteau», ce qui signifie au figuré, si je ne me trompe, qu'elles ne seraient pas malléables.
Proverbe dont on fait l'application à certaines femmes galantes qui, après avoir prodigué gratuitement les prémices de leurs appas, ou leur farine, prétendent en faire payer au-dessus de leur valeur les restes, ou le son.Ces meunières intéressées, à qui le vice a fait oublier tout sentiment généreux, n'ont d'autres pensées que de s'enrichir aux dépens de quelques jeunes gens sans expérience qu'elles ont attirés à leur moulin, et qu'elles en chasseront impitoyablement aussitôt qu'elles auront achevé de les ruiner.
Les mots «farine» et «son» ont été employés allégoriquement par les auteurs du moyen âge dans le même sens qu'ils ont ici.On lit dans un recueil de ce temps cette curieuse définition de la beauté féminine: «C'est la farine du diable qui se réduit tout en son.» On y trouve aussi cette comparaison non moins curieuse de la femme prodigue de sa beauté pour son plaisir, avec un bluteau qui jette la farine et retient le son.
La Rochefoucauld l'a dit textuellement dans sa 376e Pensée, et Molière l'a redit, à sa manière, dans ces vers d'Amphitryon, que Cléantis adresse à Sosie:
(Acte II, sc. VII.)
Je crois que c'est une phrase proverbiale antérieure à ces deux auteurs.Elle est du moins employée comme telle dans quelques patois méridionaux, et elle a des équivalents dans plusieurs langues étrangères.
Sans doute le métier d'honnête femme peut paraître fatigant, puisqu'il oblige à une lutte vigoureuse pour triompher de ce désordre d'idées et de tentations que peuvent exciter, par moment, dans l'esprit d'une femme, même la mieux morigénée, les froides négligences d'un mari et les ardentes poursuites d'un séducteur. Mais faut-il en conclure que les efforts qu'exige d'elle le maintien de sa vertu doivent lui en donner une sorte de lassitude? Non, non: la femme qui se respecte a l'âme trop forte et trop courageuse pour se lasser de ce qui fait son honneur et sa dignité. Loin de faiblir dans la lutte, elle s'y affermit; plus son devoir lui impose de sacrifices, plus elle s'y attache, non-seulement par la considération des malheurs qu'ont à subir les femmes déshonorées, mais par le sentiment de sa conscience, qui adoucit et compense ses amertumes par d'ineffables consolations.
Je voudrais qu'à la place de la maxime que je combats il y en eût une autre qui glorifiât la persévérance vertueuse de la femme délaissée.Cette femme de bien, cette femme chrétienne, malheureusement trop rare, est un modèle de perfection, et la chasteté inaltérable qu'elle conserve dans un cœur brûlant me paraît, dans l'ordre moral, un phénomène plus admirable encore que ne l'est, dans l'ordre physique, la glace entretenue dans un fourneau chauffé à blanc.
La discrétion des hommes tente les femmes autant que la beauté des femmes tente les hommes, et les deux sexes suivent plus volontiers l'attrait naturel qui les invite à se rapprocher, quand ils sont assurés de rencontrer, l'un chez l'autre, la qualité qu'ils désirent.Ainsi les deux questions, bien que chacune d'elles porte sur un point différent, partent du même principe, qui est le besoin d'aimer, et tendent au même but, qui est la satisfaction de ce besoin.Mais celle des femmes est plus significative que celle des hommes, où l'on ne voit souvent qu'un simple effet de curiosité: elle a quelque chose de raisonné, de prémédité, indice manifeste que les femmes, qui osent la faire, sont déjà décidées à se laisser aller à la tentation, lorsqu'elles savent qu'elles pourront, sans crainte d'être compromises, accorder leur penchant avec la sécurité, leur plaisir avec le mystère.Vous pouvez en conclure, si vous le voulez, qu'elles tiennent beaucoup moins à la vertu qu'au respect humain.En effet, mettre de côté cette vertu incommode et en garder les apparences honorables, c'est, en résumé, ce qu'elles cherchent en s'engageant dans les affaires de cœur.Il n'est pas besoin de dire avec quelles précautions, avec quelle habileté elles poursuivent ce double objet, après en avoir calculé les inconvénients et les avantages.On sait que ces femmes-là ont un art prodigieux, qui leur vient sans doute de ce qu'elles ont mordu plus profondément que les autres au fruit de l'arbre de la science du bien et du mal.
Il ne faut pas juger de l'âge des femmes par le nombre de leurs années, mais par la conservation de leurs appas; tant que ces appas ne sont point flétris, elles peuvent se dire encore dans la jeunesse malgré le démenti que leur opposent les registres de l'état civil toujours trop incivil pour elles.
C'est sur la foi de ce proverbe que nos dames se donnent tant de soins et font tant de frais de toilette pour paraître plus jeunes qu'elles ne sont.
N'examinons point si un tel proverbe n'est pas formulé d'une manière plus galante que vraie, de peur de troubler leurs illusions à ce sujet; laissons-les se complaire dans ces douces illusions; et qu'elles soient persuadées, s'il est possible, que leur extrait baptistaire vieillit tout seul.
Est-ce parce qu'il y aurait trop à dire d'elles, ou bien parce qu'il paraît impossible de les définir? Je laisserai à de plus habiles que moi le soin de décider entre ces deux questions qui se compliquent l'une par l'autre, et je me contenterai de citer un joli portrait burlesque de la femme par un auteur comique qui ne la jugeait pas indéfinissable et qui voyait en elle un composé de natures diverses. Je le tire de la pièce intitulée: Arlequin défenseur du beau sexe. —«Voulez-vous bien connaître une femme? figurez-vous un joli petit monstre qui charme les yeux et qui choque la raison; qui plaît et qui rebute, qui est ange au dehors et harpie au dedans. Mettez ensemble la tête d'une linotte, la langue d'un serpent, les yeux d'un basilic, l'humeur d'un chat, l'adresse d'un singe, les inclinations nocturnes d'un hibou, le brillant du soleil et l'inégalité de la lune; enveloppez le tout d'une peau bien blanche, ajoutez-y des bras, des jambes, et cætera: vous aurez une femme toute complète.» (Théâtre italien de Gherardi, t.V, p.262.)
On attribue à J.-J.Rousseau les vers suivants sur les femmes: