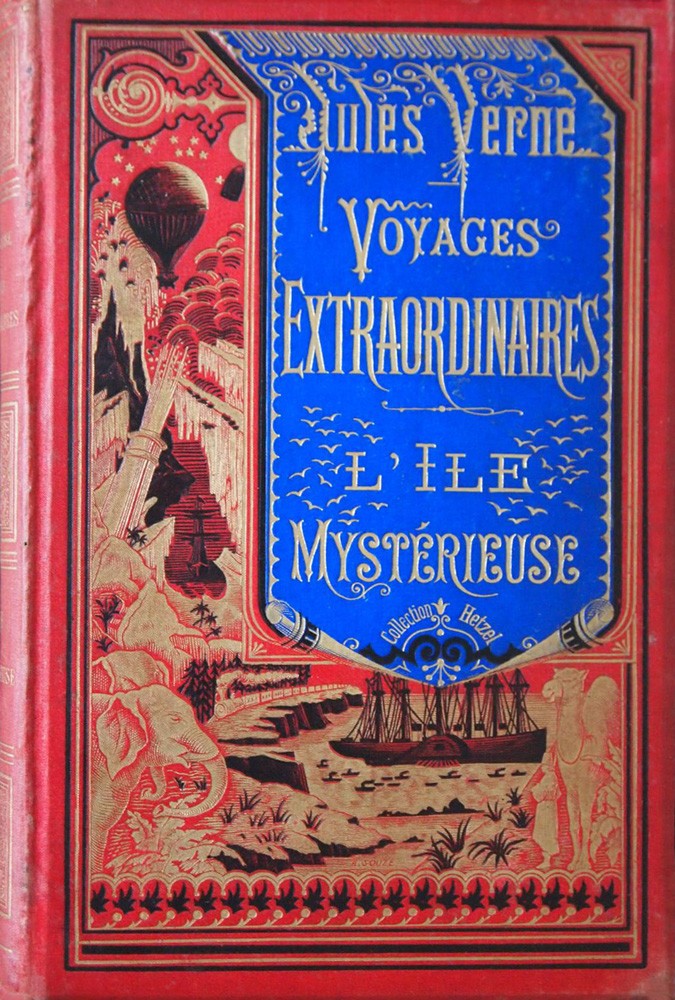L'île mystérieuse
Play Sample
PARTIE 1
LES NAUFRAGÉS DE L'AIR
CHAPITRE I
«Remontons-nous?
— Non!Au contraire!Nous descendons!
— Pis que cela, monsieur Cyrus!Nous tombons!
— Pour Dieu!Jetez du lest!
— Voilà le dernier sac vidé!
— Le ballon se relève-t-il?
— Non!
— J'entends comme un clapotement de vagues!
— La mer est sous la nacelle!
— Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous!»
Alors une voix puissante déchira l'air, et ces mots retentirent:
«Dehors tout ce qui pèse!...tout!et à la grâce de Dieu!»
Telles sont les paroles qui éclataient en l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers quatre heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865.
Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année, et pendant lequel le baromètre tomba à sept cent dix millimètres.Ce fut un ouragan, sans intermittence, qui dura du 18 au 26 mars.Les ravages qu'il produisit furent immenses en Amérique, en Europe, en Asie, sur une zone large de dix-huit cents milles, qui se dessinait obliquement à l'équateur, depuis le trente-cinquième parallèle nord jusqu'au quarantième parallèle sud!
Villes renversées, forêts déracinées, rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarets, navires jetés à la côte, que les relevés du Bureau-Veritas chiffrèrent par centaines, territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage, plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer: tels furent les témoignages de sa fureur, qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan.Il dépassait en désastres ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le 25 octobre 1810, l'autre le 26 juillet 1825.
Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer, un drame, non moins saisissant, se jouait dans les airs bouleversés.En effet, un ballon, porté comme une boule au sommet d'une trombe, et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air, parcourait l'espace avec une vitesse de quatre-vingt-dix milles à l'heure, en tournant sur lui-même, comme s'il eût été saisi par quelque maelström aérien.Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle, qui contenait cinq passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs, mêlées d'eau pulvérisée, qui traînaient jusqu'à la surface de l'Océan.
D'où venait cet aérostat, véritable jouet de l'effroyable tempête?De quel point du monde s'était-il élancé?Il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan.Or, l'ouragan durait depuis cinq jours déjà, et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le 18.On eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin, car il n'avait pas dû franchir moins de deux mille milles par vingt-quatre heures?en tout cas, les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ, car tout point de repère leur manquait.Il devait même se produire ce fait curieux, qu'emportés au milieu des violences de la tempête, ils ne les subissaient pas.Ils se déplaçaient, ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation, ni de leur déplacement dans le sens horizontal.Leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard qui s'amoncelait sous la nacelle.Autour d'eux, tout était brume.Telle était même l'opacité des nuages, qu'ils n'auraient pu dire s'il faisait jour ou nuit.Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'Océan n'avaient dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones.Leur rapide descente avait seule pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient au-dessus des flots.
Cependant, le ballon, délesté de lourds objets, tels que munitions, armes, provisions, s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère, à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds.Les passagers, après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle, trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas, n'avaient pas hésité à jeter par-dessus le bord les objets même les plus utiles, et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide, de cette âme de leur appareil, qui les soutenait au-dessus de l'abîme.
La nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques.Puis le jour reparut, et, avec le jour, l'ouragan marqua une tendance à se modérer.Dès le début de cette journée du 24 mars, il y eut quelques symptômes d'apaisement.À l'aube, les nuages, plus vésiculaires, étaient remontés dans les hauteurs du ciel.En quelques heures, la trombe s'évasa et se rompit.Le vent, de l'état d'ouragan, passa au «grand frais», c'est-à-dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié.C'était encore ce que les marins appellent «une brise à trois ris», mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable.
Vers onze heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée.L'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit, qui se sent même, après le passage des grands météores.Il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest.Il paraissait s'être tué lui-même.Peut-être s'était-il écoulé en nappes électriques, après la rupture de la trombe, ainsi qu'il arrive quelquefois aux typhons de l'océan Indien.
Mais, vers cette heure-là aussi, on eût pu constater, de nouveau, que le ballon s'abaissait lentement, par un mouvement continu, dans les couches inférieures de l'air.Il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu, et que son enveloppe s'allongeait en se distendant, passant de la forme sphérique à la forme ovoïde.
Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de deux mille pieds au-dessus de la mer.Il jaugeait cinquante mille pieds cubes, et, grâce à sa capacité, il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air, soit qu'il eût atteint de grandes altitudes, soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale.En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore, la nacelle, les quelques vivres qu'ils avaient conservés, tout, jusqu'aux menus ustensiles qui garnissaient leurs poches, et l'un d'eux, s'étant hissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat.
Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées, et que le gaz leur manquait!
Ils étaient donc perdus!en effet, ce n'était ni un continent, ni même une île, qui s'étendait au-dessous d'eux.L'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût mordre.
C'était l'immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence!C'était l'Océan sans limites visibles, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de quarante milles!C'était cette plaine liquide, battue sans merci, fouettée par l'ouragan, qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées, sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches!Pas une terre en vue, pas un navire!
Il fallait donc, à tout prix, arrêter le mouvement descensionnel, pour empêcher que l'aérostat ne vînt s'engloutir au milieu des flots.Et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle.Mais, malgré leurs efforts, le ballon s'abaissait toujours, en même temps qu'il se déplaçait avec une extrême vitesse, suivant la direction du vent, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest.
Situation terrible, que celle de ces infortunés!Ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat.Leurs tentatives ne pouvaient aboutir.L'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus.Le fluide s'échappait sans qu'il fût aucunement possible de le retenir.La descente s'accélérait visiblement, et, à une heure après midi, la nacelle n'était pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l'Océan.
C'est que, en effet, il était impossible d'empêcher la fuite du gaz, qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil.En allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait, les passagers avaient pu prolonger, pendant quelques heures, leur suspension dans l'air.
Mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée, et, si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelle et ballon auraient définitivement disparu dans les flots.
La seule manœuvre qu'il y eût à faire encore fut faite à ce moment.Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques, et qui savaient regarder la mort en face.On n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres.
Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute.La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer, si elle y tombait.
À deux heures, l'aérostat était à peine à quatre cents pieds au-dessus des flots.En ce moment, une voix mâle — la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte — se fit entendre.À cette voix répondirent des voix non moins énergiques.
«Tout est-il jeté?
— Non!Il y a encore dix mille francs d'or!»
Un sac pesant tomba aussitôt à la mer.
«Le ballon se relève-t-il?
— Un peu, mais il ne tardera pas à retomber!
— Que reste-t-il à jeter au dehors?
— Rien!
— Si!...La nacelle!
— Accrochons-nous au filet!et à la mer la nacelle!»
C'était, en effet, le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat.Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de deux mille pieds.
Les cinq passagers s'étaient hissés dans le filet, au-dessus du cercle, et se tenaient dans le réseau des mailles, regardant l'abîme.
On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats.Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical.L'appareil, flottant dans l'air, se comporte comme une balance d'une justesse mathématique.On comprend donc que, lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque.C'est ce qui arriva dans cette occasion.
Mais, après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre.
Le gaz fuyait par la déchirure, qu'il était impossible de réparer.
Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire.Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais.Ils n'avaient plus à compter que sur l'aide de Dieu.
À quatre heures, le ballon n'était plus qu'à cinq cents pieds de la surface des eaux.Un aboiement sonore se fit entendre.Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de son maître dans les mailles du filet.
«Top a vu quelque chose!» s'écria l'un des passagers.
Puis, aussitôt, une voix forte se fit entendre:
«Terre!terre!»
Le ballon, que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest, avait, depuis l'aube, franchi une distance considérable, qui se chiffrait par centaines de milles, et une terre assez élevée venait, en effet, d'apparaître dans cette direction.
Mais cette terre se trouvait encore à trente milles sous le vent.Il ne fallait pas moins d'une grande heure pour l'atteindre, et encore à la condition de ne pas dériver.Une heure!Le ballon ne se serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide?
Telle était la terrible question!Les passagers voyaient distinctement ce point solide, qu'il fallait atteindre à tout prix.Ils ignoraient ce qu'il était, île ou continent, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés!Mais cette terre, qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas, qu'elle dût être hospitalière ou non, il fallait y arriver!
Or, à quatre heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir.
CHAPITRE II
Il rasait la surface de la mer.Déjà la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet, l'alourdissant encore, et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi, comme un oiseau qui a du plomb dans l'aile.Une demi-heure plus tard, la terre n'était plus qu'à un mille, mais le ballon, épuisé, flasque, distendu, chiffonné en gros plis, ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure.Les passagers, accrochés au filet, pesaient encore trop pour lui, et bientôt, à demi plongés dans la mer, ils furent battus par les lames furieuses.L'enveloppe de l'aérostat fit poche alors, et le vent s'y engouffrant, le poussa comme un navire vent arrière.
Peut-être accosterait-il ainsi la côte!
Or, il n'en était qu'à deux encablures, quand des cris terribles, sortis de quatre poitrines à la fois, retentirent.Le ballon, qui semblait ne plus devoir se relever, venait de refaire encore un bond inattendu, après avoir été frappé d'un formidable coup de mer.Comme s'il eût été délesté subitement d'une nouvelle partie de son poids, il remonta à une hauteur de quinze cents pieds, et là il rencontra une sorte de remous du vent, qui, au lieu de le porter directement à la côte, lui fit suivre une direction presque parallèle.Enfin, deux minutes plus tard, il s'en rapprochait obliquement, et il retombait définitivement sur le sable du rivage, hors de la portée des lames.
Les passagers, s'aidant les uns les autres, parvinrent à se dégager des mailles du filet.Le ballon, délesté de leur poids, fut repris par le vent, et comme un oiseau blessé qui retrouve un instant de vie, il disparut dans l'espace.
La nacelle avait contenu cinq passagers, plus un chien, et le ballon n'en jetait que quatre sur le rivage.
Le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le filet, et c'est ce qui avait permis à l'aérostat allégé, de remonter une dernière fois, puis, quelques instants après, d'atteindre la terre.
À peine les quatre naufragés — on peut leur donner ce nom — avaient-ils pris pied sur le sol, que tous, songeant à l'absent, s'écriaient: «Il essaye peut-être d'aborder à la nage!Sauvons-le!sauvons-le!»
Ce n'étaient ni des aéronautes de profession, ni des amateurs d'expéditions aériennes, que l'ouragan venait de jeter sur cette côte.C'étaient des prisonniers de guerre, que leur audace avait poussés à s'enfuir dans des circonstances extraordinaires.
Cent fois, ils auraient dû périr!Cent fois, leur ballon déchiré aurait dû les précipiter dans l'abîme!Mais le ciel les réservait à une étrange destinée, et le 20 mars, après avoir fui Richmond, assiégée par les troupes du général Ulysse Grant, ils se trouvaient à sept mille milles de cette capitale de la Virginie, la principale place forte des séparatistes, pendant la terrible guerre de Sécession.Leur navigation aérienne avait duré cinq jours.
Voici, d'ailleurs, dans quelles circonstances curieuses s'était produite l'évasion des prisonniers, — évasion qui devait aboutir à la catastrophe que l'on connaît.
Cette année même, au mois de février 1865, dans un de ces coups de main que tenta, mais inutilement, le général Grant pour s'emparer de Richmond, plusieurs de ses officiers tombèrent au pouvoir de l'ennemi et furent internés dans la ville.L'un des plus distingués de ceux qui furent pris appartenait à l'état-major fédéral, et se nommait Cyrus Smith.
Cyrus Smith, originaire du Massachussets, était un ingénieur, un savant de premier ordre, auquel le gouvernement de l'Union avait confié, pendant la guerre, la direction des chemins de fer, dont le rôle stratégique fut si considérable.Véritable Américain du nord, maigre, osseux, efflanqué, âgé de quarante-cinq ans environ, il grisonnait déjà par ses cheveux ras et par sa barbe, dont il ne conservait qu'une épaisse moustache.Il avait une de ces belles têtes «numismatiques», qui semblent faites pour être frappées en médailles, les yeux ardents, la bouche sérieuse, la physionomie d'un savant de l'école militante.C'était un de ces ingénieurs qui ont voulu commencer par manier le marteau et le pic, comme ces généraux qui ont voulu débuter simples soldats.Aussi, en même temps que l'ingéniosité de l'esprit, possédait-il la suprême habileté de main.Ses muscles présentaient de remarquables symptômes de tonicité.Véritablement homme d'action en même temps qu'homme de pensée, il agissait sans effort, sous l'influence d'une large expansion vitale, ayant cette persistance vivace qui défie toute mauvaise chance.
Très instruit, très pratique, très débrouillard», pour employer un mot de la langue militaire française, c'était un tempérament superbe, car, tout en restant maître de lui, quelles que fussent les circonstances, il remplissait au plus haut degré ces trois conditions dont l'ensemble détermine l'énergie humaine: activité d'esprit et de corps, impétuosité des désirs, puissance de la volonté.Et sa devise aurait pu être celle de Guillaume d'Orange au XVIIe siècle: «Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.» En même temps, Cyrus Smith était le courage personnifié.Il avait été de toutes les batailles pendant cette guerre de Sécession.Après avoir commencé sous Ulysse Grant dans les volontaires de l'Illinois, il s'était battu à Paducah, à Belmont, à Pittsburg-Landing, au siège de Corinth, à Port-Gibson, à la Rivière-Noire, à Chattanoga, à Wilderness, sur le Potomak, partout et vaillamment, en soldat digne du général qui répondait: «Je ne compte jamais mes morts!» Et, cent fois, Cyrus Smith aurait dû être au nombre de ceux-là que ne comptait pas le terrible Grant, mais dans ces combats, où il ne s'épargnait guère, la chance le favorisa toujours, jusqu'au moment où il fut blessé et pris sur le champ de bataille de Richmond.En même temps que Cyrus Smith, et le même jour, un autre personnage important tombait au pouvoir des sudistes.Ce n'était rien moins que l'honorable Gédéon Spilett, reporter» du New-York Herald, qui avait été chargé de suivre les péripéties de la guerre au milieu des armées du Nord.
Gédéon Spilett était de la race de ces étonnants chroniqueurs anglais ou américains, des Stanley et autres, qui ne reculent devant rien pour obtenir une information exacte et pour la transmettre à leur journal dans les plus brefs délais.Les journaux de l'Union, tels que le New-York Herald, forment de véritables puissances, et leurs délégués sont des représentants avec lesquels on compte.Gédéon Spilett marquait au premier rang de ces délégués.
Homme de grand mérite, énergique, prompt et prêt à tout, plein d'idées, ayant couru le monde entier, soldat et artiste, bouillant dans le conseil, résolu dans l'action, ne comptant ni peines, ni fatigues, ni dangers, quand il s'agissait de tout savoir, pour lui d'abord, et pour son journal ensuite, véritable héros de la curiosité, de l'information, de l'inédit, de l'inconnu, de l'impossible, c'était un de ces intrépides observateurs qui écrivent sous les balles, chroniquent» sous les boulets, et pour lesquels tous les périls sont des bonnes fortunes.
Lui aussi avait été de toutes les batailles, au premier rang, revolver d'une main, carnet de l'autre, et la mitraille ne faisait pas trembler son crayon.
Il ne fatiguait pas les fils de télégrammes incessants, comme ceux qui parlent alors qu'ils n'ont rien à dire, mais chacune de ses notes, courtes, nettes, claires, portait la lumière sur un point important.D'ailleurs», l'humour» ne lui manquait pas.Ce fut lui qui, après l'affaire de la Rivière-Noire, voulant à tout prix conserver sa place au guichet du bureau télégraphique, afin d'annoncer à son journal le résultat de la bataille, télégraphia pendant deux heures les premiers chapitres de la Bible.Il en coûta deux mille dollars au New-York Herald, mais le New-York Herald fut le premier informé.
Gédéon Spilett était de haute taille.Il avait quarante ans au plus.Des favoris blonds tirant sur le rouge encadraient sa figure.Son œil était calme, vif, rapide dans ses déplacements.C'était l'œil d'un homme qui a l'habitude de percevoir vite tous les détails d'un horizon.Solidement bâti, il s'était trempé dans tous les climats comme une barre d'acier dans l'eau froide.Depuis dix ans, Gédéon Spilett était le reporter attitré du New-York Herald, qu'il enrichissait de ses chroniques et de ses dessins, car il maniait aussi bien le crayon que la plume.
Lorsqu'il fut pris, il était en train de faire la description et le croquis de la bataille.Les derniers mots relevés sur son carnet furent ceux-ci: «Un sudiste me couche en joue et...» Et Gédéon Spilett fut manqué, car, suivant son invariable habitude, il se tira de cette affaire sans une égratignure.
Cyrus Smith et Gédéon Spilett, qui ne se connaissaient pas, si ce n'est de réputation, avaient été tous les deux transportés à Richmond.
L'ingénieur guérit rapidement de sa blessure, et ce fut pendant sa convalescence qu'il fit connaissance du reporter.Ces deux hommes se plurent et apprirent à s'apprécier.Bientôt, leur vie commune n'eut plus qu'un but, s'enfuir, rejoindre l'armée de Grant et combattre encore dans ses rangs pour l'unité fédérale.
Les deux Américains étaient donc décidés à profiter de toute occasion; mais bien qu'ils eussent été laissés libres dans la ville, Richmond était si sévèrement gardée, qu'une évasion devait être regardée comme impossible.Sur ces entre faits, Cyrus Smith fut rejoint par un serviteur, qui lui était dévoué à la vie, à la mort.
Cet intrépide était un nègre, né sur le domaine de l'ingénieur, d'un père et d'une mère esclaves, mais que, depuis longtemps, Cyrus Smith, abolitionniste de raison et de cœur, avait affranchi.L'esclave, devenu libre, n'avait pas voulu quitter son maître.
Il l'aimait à mourir pour lui.C'était un garçon de trente ans, vigoureux, agile, adroit, intelligent, doux et calme, parfois naïf, toujours souriant, serviable et bon.Il se nommait Nabuchodonosor, mais il ne répondait qu'à l'appellation abréviative et familière de Nab.
Quand Nab apprit que son maître avait été fait prisonnier, il quitta le Massachussets sans hésiter, arriva devant Richmond, et, à force de ruse et d'adresse, après avoir risqué vingt fois sa vie, il parvint à pénétrer dans la ville assiégée.Ce que furent le plaisir de Cyrus Smith, en revoyant son serviteur, et la joie de Nab à retrouver son maître, cela ne peut s'exprimer.
Mais si Nab avait pu pénétrer dans Richmond, il était bien autrement difficile d'en sortir, car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux.
Il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion avec quelques chances de succès, et cette occasion non seulement ne se présentait pas, mais il était malaisé de la faire naître.
Cependant, Grant continuait ses énergiques opérations.La victoire de Petersburg lui avait été très chèrement disputée.Ses forces, réunies à celles de Butler, n'obtenaient encore aucun résultat devant Richmond, et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dût être prochaine.Le reporter, auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter, ne pouvait plus y tenir.Il n'avait qu'une idée: sortir de Richmond et à tout prix.Plusieurs fois, même, il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables.
Cependant, le siège continuait, et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de Grant, certains assiégés avaient non moins hâte de s'enfuir, afin de rejoindre l'armée séparatiste, et, parmi eux, un certain Jonathan Forster, sudiste enragé.C'est qu'en effet, si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville, les fédérés ne le pouvaient pas non plus, car l'armée du Nord les investissait.Le gouverneur de Richmond, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus communiquer avec le général Lee, et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville, afin de hâter la marche de l'armée de secours.Ce Jonathan Forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon, afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes.
Le gouverneur autorisa la tentative.Un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de Jonathan Forster, que cinq de ses compagnons devaient suivre dans les airs.Ils étaient munis d'armes, pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant, et de vivres, pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait.
Le départ du ballon avait été fixé au 18 mars.Il devait s'effectuer pendant la nuit, et, avec un vent de nord-ouest de moyenne force, les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de Lee.
Mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise.Dès le 18, on put voir qu'il tournait à l'ouragan.Bientôt, la tempête devint telle, que le départ de Forster dut être différé, car il était impossible de risquer l'aérostat et ceux qu'il emporterait au milieu des éléments déchaînés.
Le ballon, gonflé sur la grande place de Richmond, était donc là, prêt à partir à la première accalmie du vent, et, dans la ville, l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas.
Le 18, le 19 mars se passèrent sans qu'aucun changement se produisît dans la tourmente.On éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon, attaché au sol, que les rafales couchaient jusqu'à terre.
La nuit du 19 au 20 s'écoula, mais, au matin, l'ouragan se développait encore avec plus d'impétuosité.Le départ était impossible.
Ce jour-là, l'ingénieur Cyrus Smith fut accosté dans une des rues de Richmond par un homme qu'il ne connaissait point.C'était un marin nommé Pencroff, âgé de trente-cinq à quarante ans, vigoureusement bâti, très hâlé, les yeux vifs et clignotants, mais avec une bonne figure.Ce Pencroff était un Américain du nord, qui avait couru toutes les mers du globe, et auquel, en fait d'aventures, tout ce qui peut survenir d'extraordinaire à un être à deux pieds sans plumes était arrivé.Inutile de dire que c'était une nature entreprenante, prête à tout oser, et qui ne pouvait s'étonner de rien.Pencroff, au commencement de cette année, s'était rendu pour affaires à Richmond avec un jeune garçon de quinze ans, Harbert Brown, du New-Jersey, fils de son capitaine, un orphelin qu'il aimait comme si c'eût été son propre enfant.N'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège, il s'y trouva donc bloqué, à son grand déplaisir, et il n'eut plus aussi, lui, qu'une idée: s'enfuir par tous les moyens possibles.Il connaissait de réputation l'ingénieur Cyrus Smith.Il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein.Ce jour-là, il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant sans plus de préparation:
«Monsieur Smith, en avez-vous assez de Richmond?»
L'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi, et qui ajouta à voix basse:
«Monsieur Smith, voulez-vous fuir?
— Quand cela?...» répondit vivement l'ingénieur, et on peut affirmer que cette réponse lui échappa, car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole.
Mais après avoir, d'un œil pénétrant, observé la loyale figure du marin, il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme.
«Qui êtes-vous?» demanda-t-il d'une voix brève.
Pencroff se fit connaître.
«Bien, répondit Cyrus Smith.Et par quel moyen me proposez-vous de fuir?
— Par ce fainéant de ballon qu'on laisse là à rien faire, et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès!...»
Le marin n'avait pas eu besoin d'achever sa phrase.
L'ingénieur avait compris d'un mot.Il saisit Pencroff par le bras et l'entraîna chez lui.
Là, le marin développa son projet, très simple en vérité.On ne risquait que sa vie à l'exécuter.
L'ouragan était dans toute sa violence, il est vrai, mais un ingénieur adroit et audacieux, tel que Cyrus Smith, saurait bien conduire un aérostat.
S'il eût connu la manœuvre, lui, Pencroff, il n'aurait pas hésité à partir, — avec Harbert, s'entend.Il en avait vu bien d'autres, et n'en était plus à compter avec une tempête!
Cyrus Smith avait écouté le marin sans mot dire, mais son regard brillait.L'occasion était là.Il n'était pas homme à la laisser échapper.Le projet n'était que très dangereux, donc il était exécutable.
La nuit, malgré la surveillance, on pouvait aborder le ballon, se glisser dans la nacelle, puis couper les liens qui le retenaient!Certes, on risquait d'être tué, mais, par contre, on pouvait réussir, et sans cette tempête...Mais sans cette tempête, le ballon fût déjà parti, et l'occasion, tant cherchée, ne se présenterait pas en ce moment!
«Je ne suis pas seul!...dit en terminant Cyrus Smith.
— Combien de personnes voulez-vous donc emmener?demanda le marin.
— Deux: mon ami Spilett et mon serviteur Nab.
— Cela fait donc trois, répondit Pencroff, et, avec Harbert et moi, cinq.Or, le ballon devait enlever six...
— Cela suffit.Nous partirons!» dit Cyrus Smith.
Ce «nous» engageait le reporter, mais le reporter n'était pas homme à reculer, et quand le projet lui fut communiqué, il l'approuva sans réserve.Ce dont il s'étonnait, c'était qu'une idée aussi simple ne lui fût pas déjà venue.Quant à Nab, il suivait son maître partout où son maître voulait aller.
«À ce soir alors, dit Pencroff.Nous flânerons tous les cinq, par là, en curieux!
— À ce soir, dix heures, répondit Cyrus Smith, et fasse le ciel que cette tempête ne s'apaise pas avant notre départ!»
Pencroff prit congé de l'ingénieur, et retourna à son logis, où était resté jeune Harbert Brown.Ce courageux enfant connaissait le plan du marin, et ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'il attendait le résultat de la démarche faite auprès de l'ingénieur.On le voit, c'étaient cinq hommes déterminés qui allaient ainsi se lancer dans la tourmente, en plein ouragan!
Non!L'ouragan ne se calma pas, et ni Jonathan Forster, ni ses compagnons ne pouvaient songer à l'affronter dans cette frêle nacelle!La journée fut terrible.L'ingénieur ne craignait qu'une chose: c'était que l'aérostat, retenu au sol et couché sous le vent, ne se déchirât en mille pièces.Pendant plusieurs heures, il rôda sur la place presque déserte, surveillant l'appareil.Pencroff en faisait autant de son côté, les mains dans les poches, et bâillant au besoin, comme un homme qui ne sait à quoi tuer le temps, mais redoutant aussi que le ballon ne vînt à se déchirer ou même à rompre ses liens et à s'enfuir dans les airs.
Le soir arriva.La nuit se fit très sombre.D'épaisses brumes passaient comme des nuages au ras du sol.Une pluie mêlée de neige tombait.Le temps était froid.Une sorte de brouillard pesait sur Richmond.Il semblait que la violente tempête eût fait comme une trêve entre les assiégeants et les assiégés, et que le canon eût voulu se taire devant les formidables détonations de l'ouragan.Les rues de la ville étaient désertes.Il n'avait pas même paru nécessaire, par cet horrible temps, de garder la place au milieu de laquelle se débattait l'aérostat.
Tout favorisait le départ des prisonniers, évidemment; mais ce voyage, au milieu des rafales déchaînées!...
«Vilaine marée!se disait Pencroff, en fixant d'un coup de poing son chapeau que le vent disputait à sa tête.Mais bah!on en viendra à bout tout de même!»
À neuf heures et demie, Cyrus Smith et ses compagnons se glissaient par divers côtés sur la place, que les lanternes de gaz, éteintes par le vent, laissaient dans une obscurité profonde.On ne voyait même pas l'énorme aérostat, presque entièrement rabattu sur le sol.
Indépendamment des sacs de lest qui maintenaient les cordes du filet, la nacelle était retenue par un fort câble passé dans un anneau scellé dans le pavé, et dont le double remontait à bord.
Les cinq prisonniers se rencontrèrent près de la nacelle.Ils n'avaient point été aperçus, et telle était l'obscurité, qu'ils ne pouvaient se voir eux-mêmes.
Sans prononcer une parole, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Nab et Harbert prirent place dans la nacelle, pendant que Pencroff, sur l'ordre de l'ingénieur, détachait successivement les paquets de lest.Ce fut l'affaire de quelques instants, et le marin rejoignit ses compagnons.
L'aérostat n'était alors retenu que par le double du câble, et Cyrus Smith n'avait plus qu'à donner l'ordre du départ.En ce moment, un chien escalada d'un bond la nacelle.
C'était Top, le chien de l'ingénieur, qui, ayant brisé sa chaîne, avait suivi son maître.Cyrus Smith craignant un excès de poids, voulait renvoyer le pauvre animal.
«Bah!un de plus!» dit Pencroff, en délestant la nacelle de deux sacs de sable.
Puis, il largua le double du câble, et le ballon, partant par une direction oblique, disparut, après avoir heurté sa nacelle contre deux cheminées qu'il abattit dans la furie de son départ.
L'ouragan se déchaînait alors avec une épouvantable violence.L'ingénieur, pendant la nuit, ne put songer à descendre, et quand le jour vint, toute vue de la terre lui était interceptée par les brumes.Ce fut cinq jours après seulement, qu'une éclaircie laissa voir l'immense mer au-dessous de cet aérostat, que le vent entraînait avec une vitesse effroyable!
On sait comment, de ces cinq hommes, partis le 20 mars, quatre étaient jetés, le 24 mars, sur une côte déserte, à plus de six mille milles de leur pays!
Et celui qui manquait, celui au secours duquel les quatre survivants du ballon couraient tout d'abord, c'était leur chef naturel, c'était l'ingénieur Cyrus Smith!
CHAPITRE III
L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avaient cédé, avait été enlevé par un coup de mer.
Son chien avait également disparu.Le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître.
«En avant!» s'écria le reporter.
Et tous quatre, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigues, commencèrent leurs recherches.
Le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde.
Il ne s'était pas écoulé deux minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre.Ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver.
«Cherchons!cherchons!cria Nab.
— Oui, Nab, répondit Gédéon Spilett, et nous le retrouverons!
— Vivant?
— Vivant!
— Sait-il nager?demanda Pencroff.
— Oui!répondit Nab!Et, d'ailleurs, Top est là!...»
Le marin, entendant la mer mugir, secoua la tête!
C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mille de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu.S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mille au plus que devait être situé ce point.
Il était près de six heures alors.La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure.Les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte est de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetés, — terre inconnue, dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique.Ils foulaient du pied un sol sablonneux, mêlé de pierres, qui paraissait dépourvu de toute espèce de végétation.
Ce sol, fort inégal, très raboteux, semblait en de certains endroits criblé de petites fondrières, qui rendaient la marche très pénible.De ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd, fuyant en toutes directions, que l'obscurité empêchait de voir.D'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées.
Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer.De temps en temps, les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris, et écoutaient si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'Océan.
Ils devaient penser, en effet, que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien Top, au cas où Cyrus Smith eût été hors d'état de donner signe d'existence, seraient arrivés jusqu'à eux.Mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac.Alors, la petite troupe reprenait sa marche en avant, et fouillait les moindres anfractuosités du littoral.
Après une course de vingt minutes, les quatre naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames.Le terrain solide manquait.Ils se trouvaient à l'extrémité d'une pointe aiguë, sur laquelle la mer brisait avec fureur.
«C'est un promontoire, dit le marin.Il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite, et nous gagnerons ainsi la franche terre.
— Mais s'il est là!répondit Nab, en montrant l'Océan, dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre.
— Eh bien, appelons-le!»
Et tous, unissant leurs voix, lancèrent un appel vigoureux, mais rien ne répondit.Ils attendirent une accalmie.Ils recommencèrent.Rien encore.
Les naufragés revinrent alors, en suivant le revers opposé du promontoire, sur un sol également sablonneux et rocailleux.Toutefois, Pencroff observa que le littoral était plus accore, que le terrain montait, et il supposa qu'il devait rejoindre, par une rampe assez allongée, une haute côte dont le massif se profilait confusément dans l'ombre.Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage.La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante, et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement.On entendait à peine le bruit du ressac.Sans doute, ce côté du promontoire formait une anse semi-circulaire, que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large.
Mais, à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et c'était aller à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied.Après un parcours d'un mille et demi, le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permît de revenir vers le nord.Il fallait pourtant bien que ce promontoire, dont on avait tourné la pointe, se rattachât à la franche terre.
Les naufragés, bien que leurs forces fussent épuisées, marchaient toujours avec courage, espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remît dans la direction première.Quel fut donc leur désappointement, quand, après avoir parcouru deux milles environ, ils se virent encore une fois arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée, faite de roches glissantes.
«Nous sommes sur un îlot!dit Pencroff, et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre!»
L'observation du marin était juste.Les naufragés avaient été jetés, non sur un continent, pas même sur une île, mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de deux mille en longueur, et dont la largeur était évidemment peu considérable.
Cet îlot aride, semé de pierres, sans végétation, refuge désolé de quelques oiseaux de mer, se rattachait-il à un archipel plus important?On ne pouvait l'affirmer.Les passagers du ballon, lorsque, de leur nacelle, ils entrevirent la terre à travers les brumes, n'avaient pu suffisamment reconnaître son importance.Cependant, Pencroff, avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre, croyait bien, en ce moment, distinguer dans l'ouest des masses confuses, qui annonçaient une côte élevée.
Mais, alors, on ne pouvait, par cette obscurité, déterminer à quel système, simple ou complexe, appartenait l'îlot.On ne pouvait non plus en sortir, puisque la mer l'entourait.Il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur, qui n'avait, hélas!signalé sa présence par aucun cri.
«Le silence de Cyrus ne prouve rien, dit le reporter.Il peut être évanoui, blessé, hors d'état de répondre momentanément, mais ne désespérons pas.»
Le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelque feu qui pourrait servir de signal à l'ingénieur.Mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches.Sable et pierres, il n'y avait pas autre chose.
On comprend ce que durent être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith.Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir.Il fallait attendre le jour.Ou l'ingénieur avait pu se sauver seul, et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte, ou il était perdu à jamais!
Ce furent de longues et pénibles heures à passer.Le froid était vif.Les naufragés souffrirent cruellement, mais ils s'en apercevaient à peine.Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos.
S'oubliant pour leur chef, espérant, voulant espérer toujours, ils allaient et venaient sur cet îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord, là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe.Ils écoutaient, ils criaient, ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême, et leurs voix devaient se transmettre au loin, car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère, et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle.Un des cris de Nab sembla même, à un certain moment, se reproduire en écho.Harbert le fit observer à Pencroff, en ajoutant:
«Cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée.»
Le marin fit un signe affirmatif.D'ailleurs ses yeux ne pouvaient le tromper.S'il avait, si peu que ce fût, distingué une terre, c'est qu'une terre était là.
Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab, et l'immensité, sur toute la partie est de l'îlot, demeura silencieuse.
Cependant le ciel se dégageait peu à peu.Vers minuit, quelques étoiles brillèrent, et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal.En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon, les constellations zénithales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent, et la Croix du Sud resplendissait alors au pôle austral du monde.
La nuit s'écoula.Vers cinq heures du matin, le 25 mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement.L'horizon restait sombre encore, mais, avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas.Le brouillard se déroulait en grosses volutes qui se déplaçaient lourdement.
C'était un contre-temps.Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux.Tandis que les regards de Nab et du reporter se projetaient sur l'Océan, le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest.Mais pas un bout de terre n'était visible.
«N'importe, dit Pencroff, si je ne vois pas la côte, je la sens...elle est là...là...aussi sûr que nous ne sommes plus à Richmond!»
Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever.
Ce n'était qu'une brumaille de beau temps.Un bon soleil en chauffait les couches supérieures, et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot.En effet, vers six heures et demie, trois quarts d'heure après le lever du soleil, la brume devenait plus transparente.Elle s'épaississait en haut, mais se dissipait en bas.Bientôt tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage; puis, la mer se montra suivant un plan circulaire, infinie dans l'est, mais bornée dans l'ouest par une côte élevée et abrupte.
Oui!la terre était là.Là, le salut, provisoirement assuré, du moins.Entre l'îlot et la côte, séparés par un canal large d'un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit.
Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot.C'était Nab.Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord.Personne n'eût pu le retenir.Pencroff le rappela, mais en vain.
Le reporter se disposait à suivre Nab.
Pencroff, allant alors à lui:
«Vous voulez traverser ce canal?demanda-t-il.
— Oui, répondit Gédéon Spilett.
— Eh bien, attendez, croyez-moi, dit le marin.Nab suffira à porter secours à son maître.Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême.Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant.Voyez, la marée baisse sur le sable.Prenons donc patience, et, à mer basse, il est possible que nous trouvions un passage guéable...
— Vous avez raison, répondit le reporter.Séparons-nous le moins que nous pourrons...»
Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant.Il le traversait suivant une direction oblique.On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe.Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte.Ce demi-mille qui séparait l'îlot de la terre, il employa plus d'une demi-heure à le franchir, et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti.
Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement; puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roches, qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot.
Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et, quand il fut hors de vue, ils reportèrent leurs regards sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé.C'était un maigre repas, mais, enfin, c'en était un.
La côte opposée formait une vaste baie, terminée, au sud, par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage.Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'arc-boutait à de hautes roches granitiques.Vers le nord, au contraire, la baie, s'évasant, formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé.Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de huit milles.À un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer, et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie.Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille.Devant l'îlot, le littoral se composait, en premier plan, d'une grève de sable, semée de roches noirâtres, qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante.Au deuxième plan, se détachait une sorte de courtine granitique, taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins.Elle se profilait ainsi sur une longueur de trois milles, et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme.Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrenant en éclats prismatiques, et faite de roches agglomérées et d'éboulis, s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale.Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre.
C'était une table nette, comme celle qui domine Cape-Town, au cap de Bonne-Espérance, mais avec des proportions plus réduites.Du moins, elle apparaissait telle, vue de l'îlot.Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé.On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres, dont l'agglomération se prolongeait au delà des limites du regard.Cette verdure réjouissait l'œil, vivement attristé par les âpres lignes du parement de granit.Enfin, tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins, resplendissait un sommet blanc, que frappaient les rayons solaires.C'était un chapeau de neiges, coiffant quelque mont éloigné.
On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent.Mais, à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eût pas hésité à leur donner une origine volcanique, car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien.
Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils allaient peut-être vivre de longues années, sur laquelle ils mourraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires!
«Eh bien!demanda Harbert, que dis-tu, Pencroff?
— Eh bien, répondit le marin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout.Nous verrons.Mais voici le jusant qui se fait sentir.Dans trois heures, nous tenterons le passage, et, une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver M Smith!»
Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions.
Trois heures plus tard, à mer basse, la plus grande partie des sables, formant le lit du canal, avait découvert.Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir.En effet, vers dix heures, Gédéon Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements, ils les mirent en paquet sur leur tête, et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds.Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nageait comme un poisson, et il s'en tira à merveille.Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé.Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits, qu'ils avaient préservés du contact de l'eau, et ils tinrent conseil.
CHAPITRE IV
Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre en cet endroit même, où il le rejoindrait, et, sans perdre un instant, il remonta le littoral, dans la direction qu'avait suivie, quelques heures auparavant, le nègre Nab.Puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur.
Harbert avait voulu l'accompagner.
«Restez, mon garçon, lui avait dit le marin.Nous avons à préparer un campement et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages.Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour.À chacun sa tâche.
— Je suis prêt, Pencroff, répondit Harbert.
— Bon!reprit le marin, cela ira.Procédons avec méthode.Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim.Il s'agit donc de trouver abri, feu et nourriture.La forêt a du bois, les nids ont des œufs: il reste à chercher la maison.
— Eh bien, répondit Harbert, je chercherai une grotte dans ces roches, et je finirai bien par découvrir quelque trou dans lequel nous pourrons nous fourrer!
— C'est cela, répondit Pencroff.En route, mon garçon.»
Et les voilà marchant tous deux au pied de l'énorme muraille, sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte.Mais, au lieu de remonter vers le nord, ils descendirent au sud.Pencroff avait remarqué, à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués, que la côte offrait une étroite coupée qui, suivant lui, devait servir de débouché à une rivière ou à un ruisseau.
Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et, de l'autre, il n'était pas impossible que le courant eût poussé Cyrus Smith de ce côté.
La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de trois cents pieds, mais le bloc était plein partout, et, même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire.C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, que le flot n'avait jamais rongé.Vers le sommet voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes, à bec allongé, comprimé et pointu, — volatiles très criards, peu effrayés de la présence de l'homme, qui, pour la première fois, sans doute, troublait ainsi leur solitude.Parmi ces palmipèdes, Pencroff reconnut plusieurs labbes, sortes de goélands auxquels on donne quelquefois le nom de stercoraires, et aussi de petites mouettes voraces qui nichaient dans les anfractuosités du granit.Un coup de fusil, tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux, en eût abattu un grand nombre; mais, pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil, et ni Pencroff, ni Harbert n'en avaient.
D'ailleurs, ces mouettes et ces labbes sont à peine mangeables, et leurs œufs même ont un détestable goût.
Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues, que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard.Sur ces roches, au milieu des varechs glissants, pullulaient des coquillages à double valve, que ne pouvaient dédaigner des gens affamés.Harbert appela donc Pencroff, qui se hâta d'accourir.
«Eh!ce sont des moules!s'écria le marin.Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent!
— Ce ne sont point des moules, répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches, ce sont des lithodomes.
— Et cela se mange?demanda Pencroff.
— Parfaitement.
— Alors, mangeons des lithodomes.»
Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert.Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle et avait toujours eu une véritable passion pour cette science.Son père l'avait poussé dans cette voie, en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant, intelligent et travailleur.Aussi ses instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite, et, pour son début, il ne se trompa pas.
Ces lithodomes étaient des coquillages oblongs, attachés par grappes et très adhérents aux roches.
Ils appartenaient à cette espèce de mollusques perforateurs qui creusent des trous dans les pierres les plus dures, et leur coquille s'arrondissait à ses deux bouts, disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire.
Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodomes, qui s'entre-bâillaient alors au soleil.Ils les mangèrent comme des huîtres, et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre, ni condiments d'aucune sorte.
Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés.Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce, et il n'était pas vraisemblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée.Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodomes, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre.Deux cents pas plus loin, ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à pleins bords.En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelque violent effort plutonien.À sa base s'échancrait une petite anse, dont le fond formait un angle assez aigu.Le cours d'eau mesurait là cent pieds de largeur, et ses deux berges, de chaque côté, n'en comptaient que vingt pieds à peine.
La rivière s'enfonçait presque directement entre les deux murs de granit qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure; puis, elle tournait brusquement et disparaissait sous un taillis à un demi-mille.
«Ici, l'eau!Là-bas, le bois!dit Pencroff.Eh bien, Harbert, il ne manque plus que la maison!»
L'eau de la rivière était limpide.Le marin reconnut qu'à ce moment de la marée, c'est-à-dire à basse mer, quand le flot montant n'y portait pas, elle était douce.Ce point important établi, Harbert chercha quelque cavité qui pût servir de retraite, mais ce fut inutilement.Partout la muraille était lisse, plane et d'aplomb.
Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau, et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé, non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers, tels qu'il s'en rencontre souvent dans les pays granitiques, et qui portent le nom de «Cheminées.»
Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides que laissaient entre eux ces granits, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre.Mais avec la lumière entrait aussi le vent, — une vraie bise de corridors, — et, avec le vent, le froid aigu de l'extérieur.Cependant, le marin pensa qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierres et de sable, on pourrait rendre les «Cheminées» habitables.Leur plan géométrique représentait ce signe typographique (...), qui signifie et cætera en abrégé.Or, en isolant la boucle supérieure du signe, par laquelle s'engouffrait le vent du sud et de l'ouest, on parviendrait sans doute à utiliser sa disposition inférieure.
«Voilà notre affaire, dit Pencroff, et, si jamais nous revoyions M Smith, il saurait tirer parti de ce labyrinthe.
— Nous le reverrons, Pencroff, s'écria Harbert, et quand il reviendra, il faut qu'il trouve ici une demeure à peu près supportable.Elle le sera si nous pouvons établir un foyer dans le couloir de gauche et y conserver une ouverture pour la fumée.
— Nous le pourrons, mon garçon, répondit le marin, et ces Cheminées — ce fut le nom que Pencroff conserva à cette demeure provisoire — feront notre affaire.Mais d'abord, allons faire provision de combustible.J'imagine que le bois ne nous sera pas inutile pour boucher ces ouvertures à travers lesquelles le diable joue de sa trompette!»
Harbert et Pencroff quittèrent les Cheminées, et, doublant l'angle, ils commencèrent à remonter la rive gauche de la rivière.Le courant en était assez rapide et charriait quelques bois morts.Le flot montant — et il se faisait déjà sentir en ce moment — devait le refouler avec force jusqu'à une distance assez considérable.Le marin pensa donc que l'on pourrait utiliser ce flux et ce reflux pour le transport des objets pesants.
Après avoir marché pendant un quart d'heure, le marin et le jeune garçon arrivèrent au brusque coude que faisait la rivière en s'enfonçant vers la gauche.À partir de ce point, son cours se poursuivait à travers une forêt d'arbres magnifiques.Ces arbres avaient conservé leur verdure, malgré la saison avancée, car ils appartenaient à cette famille des conifères qui se propage sur toutes les régions du globe, depuis les climats septentrionaux jusqu'aux contrées tropicales.
Le jeune naturaliste reconnut plus particulièrement des «déodars», essences très nombreuses dans la zone himalayenne, et qui répandaient un agréable arôme.Entre ces beaux arbres poussaient des bouquets de pins, dont l'opaque parasol s'ouvrait largement.Au milieu des hautes herbes, Pencroff sentit que son pied écrasait des branches sèches, qui crépitaient comme des pièces d'artifice.
«Bon, mon garçon, dit-il à Harbert, si moi j'ignore le nom de ces arbres, je sais du moins les ranger dans la catégorie du «bois à brûler», et, pour le moment, c'est la seule qui nous convienne!
— Faisons notre provision!» répondit Harbert, qui se mit aussitôt à l'ouvrage.
La récolte fut facile.Il n'était pas même nécessaire d'ébrancher les arbres, car d'énormes quantités de bois mort gisaient à leurs pieds.Mais si le combustible ne manquait pas, les moyens de transport laissaient à désirer.Ce bois étant très sec, devait rapidement brûler.De là, nécessité d'en rapporter aux Cheminées une quantité considérable, et la charge de deux hommes n'aurait pas suffi.C'est ce que fit observer Harbert.
«Eh!mon garçon, répondit le marin, il doit y avoir un moyen de transporter ce bois.Il y a toujours moyen de tout faire!Si nous avions une charrette ou un bateau, ce serait trop facile.
— Mais nous avons la rivière!dit Harbert.
— Juste, répondit Pencroff.La rivière sera pour nous un chemin qui marche tout seul, et les trains de bois n'ont pas été inventés pour rien.
— Seulement, fit observer Harbert, notre chemin marche en ce moment dans une direction contraire à la nôtre, puisque la mer monte!
— Nous en serons quittes pour attendre qu'elle baisse, répondit le marin, et c'est elle qui se chargera de transporter notre combustible aux Cheminées.Préparons toujours notre train.»
Le marin, suivi d'Harbert, se dirigea vers l'angle que la lisière de la forêt faisait avec la rivière.
Tous deux portaient, chacun en proportion de ses forces, une charge de bois, liée en fagots.Sur la berge se trouvait aussi une grande quantité de branches mortes, au milieu de ces herbes entre lesquelles le pied d'un homme ne s'était, probablement, jamais hasardé.Pencroff commença aussitôt à confectionner son train.
Dans une sorte de remous produit par une pointe de la rive et qui brisait le courant, le marin et le jeune garçon placèrent des morceaux de bois assez gros qu'ils avaient attachés ensemble avec des lianes sèches.Il se forma ainsi une sorte de radeau sur lequel fut empilée successivement toute la récolte, soit la charge de vingt hommes au moins.En une heure, le travail fut fini, et le train, amarré à la berge, dut attendre le renversement de la marée.
Il y avait alors quelques heures à occuper, et, d'un commun accord, Pencroff et Harbert résolurent de gagner le plateau supérieur, afin d'examiner la contrée sur un rayon plus étendu.
Précisément, à deux cents pas en arrière de l'angle formé par la rivière, la muraille, terminée par un éboulement de roches, venait mourir en pente douce sur la lisière de la forêt.C'était comme un escalier naturel.Harbert et le marin commencèrent donc leur ascension.Grâce à la vigueur de leurs jarrets, ils atteignirent la crête en peu d'instants, et vinrent se poster à l'angle qu'elle faisait sur l'embouchure de la rivière.En arrivant, leur premier regard fut pour cet Océan qu'ils venaient de traverser dans de si terribles conditions!Ils observèrent avec émotion toute cette partie du nord de la côte, sur laquelle la catastrophe s'était produite.C'était là que Cyrus Smith avait disparu.Ils cherchèrent des yeux si quelque épave de leur ballon, à laquelle un homme aurait pu s'accrocher, ne surnagerait pas encore.Rien!La mer n'était qu'un vaste désert d'eau.Quant à la côte, déserte aussi.Ni le reporter, ni Nab ne s'y montraient.Mais il était possible qu'en ce moment, tous deux fussent à une telle distance, qu'on ne pût les apercevoir.
«Quelque chose me dit, s'écria Harbert, qu'un homme aussi énergique que M Cyrus n'a pas pu se laisser noyer comme le premier venu.Il doit avoir atteint quelque point du rivage.N'est-ce pas, Pencroff?»
Le marin secoua tristement la tête.Lui n'espérait guère plus revoir Cyrus Smith; mais, voulant laisser quelque espoir à Harbert:
«Sans doute, sans doute, dit-il, notre ingénieur est homme à se tirer d'affaire là où tout autre succomberait!...»
Cependant, il observait la côte avec une extrême attention.Sous ses yeux se développait la grève de sable, bornée, sur la droite de l'embouchure, par des lignes de brisants.Ces roches, encore émergées, ressemblaient à des groupes d'amphibies couchés dans le ressac.Au delà de la bande d'écueils, la mer étincelait sous les rayons du soleil.Dans le sud, une pointe aiguë fermait l'horizon, et l'on ne pouvait reconnaître si la terre se prolongeait dans cette direction, ou si elle s'orientait sud-est et sud-ouest, ce qui eût fait de cette côte une sorte de presqu'île très allongée.À l'extrémité septentrionale de la baie, le dessin du littoral se poursuivait à une grande distance, suivant une ligne plus arrondie.Là, le rivage était bas, plat, sans falaise, avec de larges bancs de sable, que le reflux laissait à découvert.
Pencroff et Harbert se retournèrent alors vers l'ouest.Leur regard fut tout d'abord arrêté par la montagne à cime neigeuse, qui se dressait à une distance de six ou sept milles.Depuis ses premières rampes jusqu'à deux milles de la côte, s'étendaient de vastes masses boisées, relevées de grandes plaques vertes dues à la présence d'arbres à feuillage persistant.Puis, de la lisière de cette forêt jusqu'à la côte même, verdoyait un large plateau semé de bouquets d'arbres capricieusement distribués.Sur la gauche, on voyait par instants étinceler les eaux de la petite rivière, à travers quelques éclaircies, et il semblait que son cours assez sinueux la ramenait vers les contre-forts de la montagne, entre lesquels elle devait prendre sa source.Au point où le marin avait laissé son train de bois, elle commençait à couler entre les deux hautes murailles de granit; mais si, sur sa rive gauche, les parois demeuraient nettes et abruptes, sur la rive droite, au contraire, elles s'abaissaient peu à peu, les massifs se changeant en rocs isolés, les rocs en cailloux, les cailloux en galets jusqu'à l'extrémité de la pointe.
«Sommes-nous sur une île?murmura le marin.
— En tout cas, elle semblerait être assez vaste!répondit le jeune garçon.
— Une île, si vaste qu'elle fût, ne serait toujours qu'une île!» dit Pencroff.
Mais cette importante question ne pouvait encore être résolue.Il fallait en remettre la solution à un autre moment.Quant à la terre elle-même, île ou continent, elle paraissait fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions.
«Cela est heureux, fit observer Pencroff, et, dans notre malheur, il faut en remercier la Providence.
— Dieu soit donc loué!» répondit Harbert, dont le cœur pieux était plein de reconnaissance pour l'Auteur de toutes choses.
Pendant longtemps, Pencroff et Harbert examinèrent cette contrée sur laquelle les avait jetés leur destinée, mais il était difficile d'imaginer, après une si sommaire inspection, ce que leur réservait l'avenir.
Puis ils revinrent, en suivant la crête méridionale du plateau de granit, dessinée par un long feston de roches capricieuses, qui affectaient les formes les plus bizarres.Là vivaient quelques centaines d'oiseaux nichés dans les trous de la pierre.Harbert, en sautant sur les roches, fit partir toute une troupe de ces volatiles.
«Ah!s'écria-t-il, ceux-là ne sont ni des goélands, ni des mouettes!
— Quels sont donc ces oiseaux?demanda Pencroff.
On dirait, ma foi, des pigeons!
— En effet, mais ce sont des pigeons sauvages, ou pigeons de roche, répondit Harbert.Je les reconnais à la double bande noire de leur aile, à leur croupion blanc, à leur plumage bleu-cendré.Or, si le pigeon de roche est bon à manger, ses œufs doivent être excellents, et, pour peu que ceux-ci en aient laissé dans leurs nids!...
— Nous ne leur donnerons pas le temps d'éclore, si ce n'est sous forme d'omelette!répondit gaîment Pencroff.
— Mais dans quoi feras-tu ton omelette?demanda Harbert.Dans ton chapeau?
— Bon!répondit le marin, je ne suis pas assez sorcier pour cela.Nous nous rabattrons donc sur les œufs à la coque, mon garçon, et je me charge d'expédier les plus durs!»
Pencroff et le jeune garçon examinèrent avec attention les anfractuosités du granit, et ils trouvèrent, en effet, des œufs dans certaines cavités!Quelques douzaines furent recueillies, puis placées dans le mouchoir du marin, et, le moment approchant où la mer devait être pleine, Harbert et Pencroff commencèrent à redescendre vers le cours d'eau.
Quand ils arrivèrent au coude de la rivière, il était une heure après midi.
Le courant se renversait déjà.Il fallait donc profiter du reflux pour amener le train de bois à l'embouchure.Pencroff n'avait pas l'intention de laisser ce train s'en aller, au courant, sans direction, et il n'entendait pas, non plus, s'y embarquer pour le diriger.Mais un marin n'est jamais embarrassé, quand il s'agit de câbles ou de cordages, et Pencroff tressa rapidement une corde longue de plusieurs brasses au moyen de lianes sèches.Ce câble végétal fut attaché à l'arrière du radeau, et le marin le tint à la main, tandis que Harbert, repoussant le train avec une longue perche, le maintenait dans le courant.
Le procédé réussit à souhait.L'énorme charge de bois, que le marin retenait en marchant sur la rive, suivit le fil de l'eau.La berge était très accore, il n'y avait pas à craindre que le train ne s'échouât, et, avant deux heures, il arrivait à l'embouchure, à quelques pas des Cheminées.
CHAPITRE V
Le premier soin de Pencroff, dès que le train de bois eut été déchargé, fut de rendre les Cheminées habitables, en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissait le courant d'air.Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries de l'(...), ouvertes aux vents du sud, et en isolèrent la boucle supérieure.Un seul boyau, étroit et sinueux, qui s'ouvrait sur la partie latérale, fut ménagé, afin de conduire la fumée au dehors et de provoquer le tirage du foyer.Les Cheminées se trouvaient ainsi divisées en trois ou quatre chambres, si toutefois on peut donner ce nom à autant de tanières sombres, dont un fauve se fût à peine contenté.Mais on y était au sec, et l'on pouvait s'y tenir debout, du moins dans la principale de ces chambres, qui occupait le centre.Un sable fin en couvrait le sol, et, tout compte fait, on pouvait s'en arranger, en attendant mieux.
Tout en travaillant, Harbert et Pencroff causaient.
«Peut-être, disait Harbert, nos compagnons auront-ils trouvé une meilleure installation que la nôtre?
— C'est possible, répondait le marin, mais, dans le doute, ne t'abstiens pas!Mieux vaut une corde de trop à son arc que pas du tout de corde!
— Ah!répétait Harbert, qu'ils ramènent M Smith, qu'ils le retrouvent, et nous n'aurons plus qu'à remercier le ciel!
— Oui!murmurait Pencroff.C'était un homme celui-là, et un vrai!
— C'était...dit Harbert.Est-ce que tu désespères de le revoir jamais?
— Dieu m'en garde!» répondit le marin.
Le travail d'appropriation fut rapidement exécuté, et Pencroff s'en déclara très satisfait.
«Maintenant, dit-il, nos amis peuvent revenir.Ils trouveront un abri suffisant.»
Restait à établir le foyer et à préparer le repas.
Besogne simple et facile, en vérité.De larges pierres plates furent disposées au fond du premier couloir de gauche, à l'orifice de l'étroit boyau qui avait été réservé.Ce que la fumée n'entraînerait pas de chaleur au dehors suffirait évidemment à maintenir une température convenable au dedans.La provision de bois fut emmagasinée dans l'une des chambres, et le marin plaça sur les pierres du foyer quelques bûches, entremêlées de menu bois.
Le marin s'occupait de ce travail, quand Harbert lui demanda s'il avait des allumettes.
«Certainement, répondit Pencroff, et j'ajouterai: Heureusement, car, sans allumettes ou sans amadou, nous serions fort embarrassés!
— Nous pourrions toujours faire du feu comme les sauvages, répondit Harbert, en frottant deux morceaux de bois secs l'un contre l'autre?
— Eh bien!essayez, mon garçon, et nous verrons si vous arriverez à autre chose qu'à vous rompre les bras!
— Cependant, c'est un procédé très simple et très usité dans les îles du Pacifique.
— Je ne dis pas non, répondit Pencroff, mais il faut croire que les sauvages connaissent la manière de s'y prendre, ou qu'ils emploient un bois particulier, car, plus d'une fois déjà, j'ai voulu me procurer du feu de cette façon, et je n'ai jamais pu y parvenir!J'avoue donc que je préfère les allumettes!Où sont mes allumettes?»
Pencroff chercha dans sa veste la boîte qui ne le quittait jamais, car il était un fumeur acharné.Il ne la trouva pas.Il fouilla les poches de son pantalon, et, à sa stupéfaction profonde, il ne trouva point davantage la boîte en question.
«Voilà qui est bête, et plus que bête!dit-il en regardant Harbert.Cette boîte sera tombée de ma poche, et je l'ai perdue!Mais, vous, Harbert, est-ce que vous n'avez rien, ni briquet, ni quoi que ce soit qui puisse servir à faire du feu?
— Non, Pencroff!»
Le marin sortit, suivi du jeune garçon, et se grattant le front avec vivacité.Sur le sable, dans les roches, près de la berge de la rivière, tous deux cherchèrent avec le plus grand soin, mais inutilement.La boîte était en cuivre et n'eût point échappé à leurs yeux.
«Pencroff, demanda Harbert, n'as-tu pas jeté cette boîte hors de la nacelle?
— Je m'en suis bien gardé, répondit le marin.Mais, quand on a été secoués comme nous venons de l'être, un si mince objet peut avoir disparu.Ma pipe, elle-même, m'a bien quitté!Satanée boîte!Où peut-elle être?
— Eh bien, la mer se retire, dit Harbert, courons à l'endroit où nous avons pris terre.»
Il était peu probable qu'on retrouvât cette boîte que les lames avaient dû rouler au milieu des galets, à marée haute, mais il était bon de tenir compte de cette circonstance.Harbert et Pencroff se dirigèrent rapidement vers le point où ils avaient atterri la veille, à deux cents pas environ des Cheminées.
Là, au milieu des galets, dans le creux des roches, les recherches furent faites minutieusement.Résultat nul.Si la boîte était tombée en cet endroit, elle avait dû être entraînée par les flots.À mesure que la mer se retirait, le marin fouillait tous les interstices des roches, sans rien trouver.C'était une perte grave dans la circonstance, et, pour le moment, irréparable.
Pencroff ne cacha point son désappointement très vif.Son front s'était fortement plissé.Il ne prononçait pas une seule parole.Harbert voulut le consoler en faisant observer que, très probablement, les allumettes auraient été mouillées par l'eau de mer, et qu'il eût été impossible de s'en servir.
«Mais non, mon garçon, répondit le marin.Elles étaient dans une boîte en cuivre qui fermait bien!Et maintenant, comment faire?
— Nous trouverons certainement moyen de nous procurer du feu, dit Harbert.M Smith ou M Spilett ne seront pas à court comme nous!
— Oui, répondit Pencroff, mais, en attendant, nous sommes sans feu, et nos compagnons ne trouveront qu'un triste repas à leur retour!
— Mais, dit vivement Harbert, il n'est pas possible qu'ils n'aient ni amadou, ni allumettes!
— J'en doute, répondit le marin en secouant la tête.D'abord Nab et M Smith ne fument pas, et je crains bien que M Spilett n'ait plutôt conservé son carnet que sa boîte d'allumettes!»
Harbert ne répondit pas.La perte de la boîte était évidemment un fait regrettable.Toutefois, le jeune garçon comptait bien que l'on se procurerait du feu d'une manière ou d'une autre.Pencroff, plus expérimenté, et bien qu'il ne fût point homme à s'embarrasser de peu, ni de beaucoup, n'en jugeait pas ainsi.En tout cas, il n'y avait qu'un parti à prendre: attendre le retour de Nab et du reporter.Mais il fallait renoncer au repas d'œufs durcis qu'il voulait leur préparer, et le régime de chair crue ne lui semblait, ni pour eux, ni pour lui-même, une perspective agréable.
Avant de retourner aux Cheminées, le marin et Harbert, dans le cas où le feu leur manquerait définitivement, firent une nouvelle récolte de lithodomes, et ils reprirent silencieusement le chemin de leur demeure.
Pencroff, les yeux fixés à terre, cherchait toujours son introuvable boîte.Il remonta même la rive gauche de la rivière depuis son embouchure jusqu'à l'angle où le train de bois avait été amarré.
Il revint sur le plateau supérieur, il le parcourut en tous sens, il chercha dans les hautes herbes sur la lisière de la forêt, — le tout vainement.
Il était cinq heures du soir, quand Harbert et lui rentrèrent aux Cheminées.Inutile de dire que les couloirs furent fouillés jusque dans leurs plus sombres coins, et qu'il fallut y renoncer décidément.
Vers six heures, au moment où le soleil disparaissait derrière les hautes terres de l'ouest, Harbert, qui allait et venait sur la grève, signala le retour de Nab et de Gédéon Spilett.
Ils revenaient seuls!...Le jeune garçon éprouva un inexprimable serrement de cœur.Le marin ne s'était point trompé dans ses pressentiments.
L'ingénieur Cyrus Smith n'avait pu être retrouvé!
Le reporter, en arrivant, s'assit sur une roche, sans mot dire.Épuisé de fatigue, mourant de faim, il n'avait pas la force de prononcer une parole!
Quant à Nab, ses yeux rougis prouvaient combien il avait pleuré, et de nouvelles larmes qu'il ne put retenir dirent trop clairement qu'il avait perdu tout espoir!
Le reporter fit le récit des recherches tentées pour retrouver Cyrus Smith.Nab et lui avaient parcouru la côte sur un espace de plus de huit milles, et, par conséquent, bien au delà du point où s'était effectuée l'avant-dernière chute du ballon, chute qui avait été suivie de la disparition de l'ingénieur et du chien Top.La grève était déserte.Nulle trace, nulle empreinte.Pas un caillou fraîchement retourné, pas un indice sur le sable, pas une marque d'un pied humain sur toute cette partie du littoral.Il était évident qu'aucun habitant ne fréquentait cette portion de la côte.La mer était aussi déserte que le rivage, et c'était là, à quelques centaines de pieds de la côte, que l'ingénieur avait trouvé son tombeau.
En ce moment, Nab se leva, et d'une voix qui dénotait combien les sentiments d'espoir résistaient en lui:
«Non!s'écria-t-il, non!Il n'est pas mort!Non!cela n'est pas!Lui!allons donc!Moi!n'importe quel autre, possible!mais lui!jamais.C'est un homme à revenir de tout!...»
Puis, la force l'abandonnant:
«Ah!je n'en puis plus!» murmura-t-il.
Harbert courut à lui.
«Nab, dit le jeune garçon, nous le retrouverons!Dieu nous le rendra!Mais en attendant, vous avez faim!Mangez, mangez un peu, je vous en prie!»
Et, ce disant, il offrait au pauvre nègre quelques poignées de coquillages, maigre et insuffisante nourriture!
Nab n'avait pas mangé depuis bien des heures, mais il refusa.Privé de son maître, Nab ne pouvait ou ne voulait plus vivre!
Quant à Gédéon Spilett, il dévora ces mollusques; puis, il se coucha sur le sable au pied d'une roche.
Il était exténué, mais calme.
Alors, Harbert s'approcha de lui, et, lui prenant la main:
«Monsieur, dit-il, nous avons découvert un abri où vous serez mieux qu'ici.Voici la nuit qui vient.Venez vous reposer!Demain, nous verrons...»
Le reporter se leva, et, guidé par le jeune garçon, il se dirigea vers les Cheminées.En ce moment, Pencroff s'approcha de lui, et, du ton le plus naturel, il lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas sur lui une allumette.
Le reporter s'arrêta, chercha dans ses poches, n'y trouva rien et dit:
«J'en avais, mais j'ai dû tout jeter...»
Le marin appela Nab alors, lui fit la même demande, et reçut la même réponse.
«Malédiction!» s'écria le marin, qui ne put retenir ce mot.
Le reporter l'entendit, et, allant à Pencroff:
«Pas une allumette?dit-il.
— Pas une, et par conséquent pas de feu!
— Ah!s'écria Nab, s'il était là, mon maître, il saurait bien vous en faire!»
Les quatre naufragés restèrent immobiles et se regardèrent, non sans inquiétude.Ce fut Harbert qui le premier rompit le silence, en disant:
«Monsieur Spilett, vous êtes fumeur, vous avez toujours des allumettes sur vous!Peut-être n'avez-vous pas bien cherché?Cherchez encore!Une seule allumette nous suffirait!»
Le reporter fouilla de nouveau ses poches de pantalon, de gilet, de paletot, et enfin, à la grande joie de Pencroff, non moins qu'à son extrême surprise, il sentit un petit morceau de bois engagé dans la doublure de son gilet.Ses doigts avaient saisi ce petit morceau de bois à travers l'étoffe, mais ils ne pouvaient le retirer.Comme ce devait être une allumette, et une seule, il s'agissait de ne point en érailler le phosphore.
«Voulez-vous me laisser faire?» lui dit le jeune garçon.
Et fort adroitement, sans le casser, il parvint à retirer ce petit morceau de bois, ce misérable et précieux fétu, qui, pour ces pauvres gens, avait une si grande importance!Il était intact.
«Une allumette!s'écria Pencroff.Ah!c'est comme si nous en avions une cargaison tout entière!»
Il prit l'allumette, et, suivi de ses compagnons, il regagna les Cheminées.
Ce petit morceau de bois, que dans les pays habités on prodigue avec tant d'indifférence, et dont la valeur est nulle, il fallait ici s'en servir avec une extrême précaution.Le marin s'assura qu'il était bien sec.Puis, cela fait:
«Il faudrait du papier, dit-il.
— En voici», répondit Gédéon Spilett, qui, après quelque hésitation, déchira une feuille de son carnet.
Pencroff prit le morceau de papier que lui tendait le reporter, et il s'accroupit devant le foyer.Là, quelques poignées d'herbes, de feuilles et de mousses sèches furent placées sous les fagots et disposées de manière que l'air pût circuler aisément et enflammer rapidement le bois mort.
Alors, Pencroff plia le morceau de papier en forme de cornet, ainsi que font les fumeurs de pipe par les grands vents, puis, il l'introduisit entre les mousses.
Prenant ensuite un galet légèrement raboteux, il l'essuya avec soin, et, non sans que le cœur lui battît, il frotta doucement l'allumette, en retenant sa respiration.
Le premier frottement ne produisit aucun effet.
Pencroff n'avait pas appuyé assez vivement, craignant d'érailler le phosphore.
«Non, je ne pourrai pas, dit-il, ma main tremble...L'allumette raterait...Je ne peux pas...je ne veux pas!...»
Et se relevant, il chargea Harbert de le remplacer.
Certes, le jeune garçon n'avait de sa vie été aussi impressionné.Le cœur lui battait fort.Prométhée allant dérober le feu du ciel ne devait pas être plus ému!Il n'hésita pas, cependant, et frotta rapidement le galet.Un petit grésillement se fit entendre et une légère flamme bleuâtre jaillit en produisant une fumée âcre.Harbert retourna doucement l'allumette, de manière à alimenter la flamme, puis, il la glissa dans le cornet de papier.
Le papier prit feu en quelques secondes, et les mousses brûlèrent aussitôt.Quelques instants plus tard, le bois sec craquait, et une joyeuse flamme, activée par le vigoureux souffle du marin, se développait au milieu de l'obscurité.
«Enfin, s'écria Pencroff en se relevant, je n'ai jamais été si ému de ma vie!»
Il est certain que ce feu faisait bien sur le foyer de pierres plates.La fumée s'en allait facilement par l'étroit conduit, la cheminée tirait, et une agréable chaleur ne tarda pas à se répandre.
Quant à ce feu, il fallait prendre garde de ne plus le laisser éteindre, et conserver toujours quelque braise sous la cendre.Mais ce n'était qu'une affaire de soin et d'attention, puisque le bois ne manquait pas, et que la provision pourrait toujours être renouvelée en temps utile.
Pencroff songea tout d'abord à utiliser le foyer, en préparant un souper plus nourrissant qu'un plat de lithodomes.Deux douzaines d'œufs furent apportées par Harbert.Le reporter, accoté dans un coin, regardait ces apprêts sans rien dire.Une triple pensée tendait son esprit.Cyrus vit-il encore?
S'il vit, où peut-il être?S'il a survécu à sa chute, comment expliquer qu'il n'ait pas trouvé le moyen de faire connaître son existence?Quant à Nab, il rôdait sur la grève.Ce n'était plus qu'un corps sans âme.
Pencroff, qui connaissait cinquante-deux manières d'accommoder les œufs, n'avait pas le choix en ce moment.Il dut se contenter de les introduire dans les cendres chaudes, et de les laisser durcir à petit feu.En quelques minutes, la cuisson fut opérée, et le marin invita le reporter à prendre sa part du souper.
Tel fut le premier repas des naufragés sur cette côte inconnue.Ces œufs durcis étaient excellents, et, comme l'œuf contient tous les éléments indispensables à la nourriture de l'homme, ces pauvres gens s'en trouvèrent fort bien et se sentirent réconfortés.
Ah!si l'un d'eux n'eût pas manqué à ce repas!Si les cinq prisonniers échappés de Richmond eussent été tous là, sous ces roches amoncelées, devant ce feu pétillant et clair, sur ce sable sec, peut-être n'auraient-ils eu que des actions de grâces à rendre au ciel!Mais le plus ingénieux, le plus savant aussi, celui qui était leur chef incontesté, Cyrus Smith, manquait, hélas!et son corps n'avait pu même obtenir une sépulture!
Ainsi se passa cette journée du 25 mars.La nuit était venue.On entendait au dehors le vent siffler et le ressac monotone battre la côte.Les galets, poussés et ramenés par les lames, roulaient avec un fracas assourdissant.
Le reporter s'était retiré au fond d'un obscur couloir, après avoir sommairement noté les incidents de ce jour: la première apparition de cette terre nouvelle, la disparition de l'ingénieur, l'exploration de la côte, l'incident des allumettes, etc.; et, la fatigue aidant, il parvint à trouver quelque repos dans le sommeil.
Harbert, lui, s'endormit bientôt.Quant au marin, veillant d'un œil, il passa la nuit près du foyer, auquel il n'épargna pas le combustible.Un seul des naufragés ne reposa pas dans les Cheminées.Ce fut l'inconsolable, le désespéré Nab, qui, cette nuit tout entière, et malgré ce que lui dirent ses compagnons pour l'engager à prendre du repos, erra sur la grève en appelant son maître!
CHAPITRE VI
L'inventaire des objets possédés par ces naufragés de l'air, jetés sur une côte qui paraissait être inhabitée, sera promptement établi.
Ils n'avaient rien, sauf les habits qu'ils portaient au moment de la catastrophe.Il faut cependant mentionner un carnet et une montre que Gédéon Spilett avait conservée par mégarde sans doute, mais pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche.Les passagers de la nacelle avaient tout jeté au dehors pour alléger l'aérostat.
Les héros imaginaires de Daniel de Foe ou de Wyss, aussi bien que les Selkirk et les Raynal, naufragés à Juan-Fernandez ou à l'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénuement aussi absolu.Ou ils tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelque épave arrivait à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie.Ils ne se trouvaient pas tout d'abord absolument désarmés en face de la nature.Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile.De rien, il leur faudrait arriver à tout!
Et si encore Cyrus Smith eût été avec eux, si l'ingénieur eût pu mettre sa science pratique, son esprit inventif, au service de cette situation, peut-être tout espoir n'eût-il pas été perdu!Hélas!
Il ne fallait plus compter revoir Cyrus Smith.
Les naufragés ne devaient rien attendre que d'eux-mêmes, et de cette Providence qui n'abandonne jamais ceux dont la foi est sincère.
Mais, avant tout, devaient-ils s'installer sur cette partie de la côte, sans chercher à savoir à quel continent elle appartenait, si elle était habitée, ou si ce littoral n'était que le rivage d'une île déserte?
C'était une question importante à résoudre et dans le plus bref délai.De sa solution sortiraient les mesures à prendre.Toutefois, suivant l'avis de Pencroff, il parut convenable d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une exploration.Il fallait, en effet, préparer des vivres et se procurer une alimentation plus fortifiante que celle uniquement due à des œufs ou des mollusques.Les explorateurs, exposés à supporter de longues fatigues, sans un abri pour y reposer leur tête, devaient, avant tout, refaire leurs forces.
Les Cheminées offraient une retraite suffisante provisoirement.Le feu était allumé, et il serait facile de conserver des braises.Pour le moment, les coquillages et les œufs ne manquaient pas dans les rochers et sur la grève.On trouverait bien le moyen de tuer quelques-uns de ces pigeons qui volaient par centaines à la crête du plateau, fût-ce à coups de bâton ou à coups de pierre.Peut-être les arbres de la forêt voisine donneraient-ils des fruits comestibles?Enfin, l'eau douce était là.Il fut donc convenu que, pendant quelques jours, on resterait aux Cheminées, afin de s'y préparer pour une exploration, soit sur le littoral, soit à l'intérieur du pays.
Ce projet convenait particulièrement à Nab.Entêté dans ses idées comme dans ses pressentiments, il n'avait aucune hâte d'abandonner cette portion de la côte, théâtre de la catastrophe.Il ne croyait pas, il ne voulait pas croire à la perte de Cyrus Smith.
Non, il ne lui semblait pas possible qu'un tel homme eût fini de cette vulgaire façon, emporté par un coup de mer, noyé dans les flots, à quelques centaines de pas d'un rivage!Tant que les lames n'auraient pas rejeté le corps de l'ingénieur, tant que lui, Nab, n'aurait pas vu de ses yeux, touché de ses mains, le cadavre de son maître, il ne croirait pas à sa mort!
Et cette idée s'enracina plus que jamais dans son cœur obstiné.Illusion peut-être, illusion respectable toutefois, que le marin ne voulut pas détruire!Pour lui, il n'était plus d'espoir, et l'ingénieur avait bien réellement péri dans les flots, mais avec Nab, il n'y avait pas à discuter.
C'était comme le chien qui ne peut quitter la place où est tombé son maître, et sa douleur était telle que, probablement, il ne lui survivrait pas.
Ce matin-là, 26 mars, dès l'aube, Nab avait repris sur la côte la direction du nord, et il était retourné là où la mer, sans doute, s'était refermée sur l'infortuné Smith.
Le déjeuner de ce jour fut uniquement composé d'œufs de pigeon et de lithodomes.Harbert avait trouvé du sel déposé dans le creux des roches par évaporation, et cette substance minérale vint fort à propos.
Ce repas terminé, Pencroff demanda au reporter si celui-ci voulait les accompagner dans la forêt, où Harbert et lui allaient essayer de chasser!Mais, toute réflexion faite, il était nécessaire que quelqu'un restât, afin d'entretenir le feu, et pour le cas, fort improbable, où Nab aurait eu besoin d'aide.Le reporter resta donc.
«En chasse, Harbert, dit le marin.Nous trouverons des munitions sur notre route, et nous couperons notre fusil dans la forêt.»
Mais, au moment de partir, Harbert fit observer que, puisque l'amadou manquait, il serait peut-être prudent de le remplacer par une autre substance.
«Laquelle?demanda Pencroff.
— Le linge brûlé, répondit le jeune garçon.Cela peut, au besoin, servir d'amadou.»
Le marin trouva l'avis fort sensé.Seulement, il avait l'inconvénient de nécessiter le sacrifice d'un morceau de mouchoir.Néanmoins, la chose en valait la peine, et le mouchoir à grands carreaux de Pencroff fut bientôt réduit, pour une partie, à l'état de chiffon à demi brûlé.Cette matière inflammable fut déposée dans la chambre centrale, au fond d'une petite cavité du roc, à l'abri de tout vent et de toute humidité.
Il était alors neuf heures du matin.Le temps menaçait, et la brise soufflait du sud-est.Harbert et Pencroff tournèrent l'angle des Cheminées, non sans avoir jeté un regard sur la fumée qui se tordait à une pointe de roc; puis, ils remontèrent la rive gauche de la rivière.
Arrivé à la forêt, Pencroff cassa au premier arbre deux solides branches qu'il transforma en gourdins, et dont Harbert usa la pointe sur une roche.Ah!que n'eût-il donné pour avoir un couteau!Puis, les deux chasseurs s'avancèrent dans les hautes herbes, en suivant la berge.À partir du coude qui reportait son cours dans le sud-ouest, la rivière se rétrécissait peu à peu, et ses rives formaient un lit très encaissé recouvert par le double arceau des arbres.Pencroff, afin de ne pas s'égarer, résolut de suivre le cours d'eau qui le ramènerait toujours à son point de départ.Mais la berge n'était pas sans présenter quelques obstacles, ici des arbres dont les branches flexibles se courbaient jusqu'au niveau du courant, là des lianes ou des épines qu'il fallait briser à coups de bâton.Souvent, Harbert se glissait entre les souches brisées avec la prestesse d'un jeune chat, et il disparaissait dans le taillis.Mais Pencroff le rappelait aussitôt en le priant de ne point s'éloigner.
Cependant, le marin observait avec attention la disposition et la nature des lieux.Sur cette rive gauche, le sol était plat et remontait insensiblement vers l'intérieur.Quelquefois humide, il prenait alors une apparence marécageuse.
On y sentait tout un réseau sous-jacent de filets liquides qui, par quelque faille souterraine, devaient s'épancher vers la rivière.Quelquefois aussi, un ruisseau coulait à travers le taillis, que l'on traversait sans peine.La rive opposée paraissait être plus accidentée, et la vallée, dont la rivière occupait le thalweg, s'y dessinait plus nettement.La colline, couverte d'arbres disposés par étages, formait un rideau qui masquait le regard.Sur cette rive droite, la marche eût été difficile, car les déclivités s'y abaissaient brusquement, et les arbres, courbés sur l'eau, ne se maintenaient que par la puissance de leurs racines.
Inutile d'ajouter que cette forêt, aussi bien que la côte déjà parcourue, était vierge de toute empreinte humaine.Pencroff n'y remarqua que des traces de quadrupèdes, des passées fraîches d'animaux, dont il ne pouvait reconnaître l'espèce.Très certainement, — et ce fut aussi l'opinion d'Harbert, — quelques-unes avaient été laissées par des fauves formidables avec lesquels il y aurait à compter sans doute; mais nulle part la marque d'une hache sur un tronc d'arbre, ni les restes d'un feu éteint, ni l'empreinte d'un pas; ce dont on devait se féliciter peut-être, car sur cette terre, en plein Pacifique, la présence de l'homme eût été peut-être plus à craindre qu'à désirer.
Harbert et Pencroff, causant à peine, car les difficultés de la route étaient grandes, n'avançaient que fort lentement, et, après une heure de marche, ils avaient à peine franchis un mille.Jusqu'alors, la chasse n'avait pas été fructueuse.Cependant, quelques oiseaux chantaient et voletaient sous la ramure, et se montraient très farouches, comme si l'homme leur eût instinctivement inspiré une juste crainte.Entre autres volatiles, Harbert signala, dans une partie marécageuse de la forêt, un oiseau à bec aigu et allongé, qui ressemblait anatomiquement à un martin-pêcheur.Toutefois, il se distinguait de ce dernier par son plumage assez rude, revêtu d'un éclat métallique.
«Ce doit être un «jacamar», dit Harbert, en essayant d'approcher l'animal à bonne portée.
— Ce serait bien l'occasion de goûter du jacamar, répondit le marin, si cet oiseau-là était d'humeur à se laisser rôtir!»
En ce moment, une pierre, adroitement et vigoureusement lancée par le jeune garçon, vint frapper le volatile à la naissance de l'aile; mais le coup ne fut pas suffisant, car le jacamar s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et disparut en un instant.
«Maladroit que je suis!s'écria Harbert.
— Eh non, mon garçon!répondit le marin.Le coup était bien porté, et plus d'un aurait manqué l'oiseau.Allons!ne vous dépitez pas!Nous le rattraperons un autre jour!»
L'exploration continua.À mesure que les chasseurs s'avançaient, les arbres, plus espacés, devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles.Pencroff cherchait vainement quelques-uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d'usages de la vie domestique, et dont la présence a été signalée jusqu'au quarantième parallèle dans l'hémisphère boréal et jusqu'au trente-cinquième seulement dans l'hémisphère austral.
Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des «douglas», semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, et des sapins admirables, mesurant cent cinquante pieds de hauteur.En ce moment, une volée d'oiseaux de petite taille et d'un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s'éparpillèrent entre les branches, semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d'un fin duvet.Harbert ramassa quelques-unes de ces plumes, et, après les avoir examinées:
«Ce sont des «couroucous», dit-il.
— Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, répondit Pencroff; mais enfin, s'ils sont bons à manger?...
— Ils sont bons à manger, et même leur chair est très délicate, reprit Harbert.D'ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton.»
Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d'un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux.Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture.On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d'appui.
Les chasseurs se redressèrent alors, et, avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des files entières de ces couroucous, qui ne songeaient point à s'envoler et se laissèrent stupidement abattre.Une centaine jonchait déjà le sol, quand les autres se décidèrent à fuir.
«Bien, dit Pencroff, voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous!On le prendrait à la main!»
Le marin enfila les couroucous, comme des mauviettes, au moyen d'une baguette flexible, et l'exploration continua.On put observer que le cours d'eau s'arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud, mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s'alimenter de la fonte des neiges qui tapissaient les flancs du cône central.
L'objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des Cheminées la plus grande quantité possible de gibier.On ne pouvait dire que le but jusqu'ici eût été atteint.Aussi le marin poursuivait-il activement ses recherches, et maugréait-il quand quelque animal, qu'il n'avait pas même le temps de reconnaître, s'enfuyait entre les hautes herbes.Si encore il avait eu le chien Top!
Mais Top avait disparu en même temps que son maître et probablement péri avec lui!
Vers trois heures après midi, de nouvelles bandes d'oiseaux furent entrevues à travers certains arbres, dont ils becquetaient les baies aromatiques, entre autres des genévriers.Soudain, un véritable appel de trompette résonna dans la forêt.Ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces gallinacés que l'on nomme «tétras» aux États-Unis.
Bientôt on en vit quelques couples, au plumage varié de fauve et de brun, et à la queue brune.Harbert reconnut les mâles aux deux ailerons pointus, formés par les pennes relevées de leur cou.Pencroff jugea indispensable de s'emparer de l'un de ces gallinacés, gros comme une poule, et dont la chair vaut celle de la gélinotte.Mais c'était difficile, car ils ne se laissaient point approcher.Après plusieurs tentatives infructueuses, qui n'eurent d'autre résultat que d'effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon:
«Décidément, puisqu'on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne.
— Comme une carpe?s'écria Harbert, très surpris de la proposition.
— Comme une carpe», répondit sérieusement le marin.
Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras, ayant chacun de deux à trois œufs.Il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids, auxquels leurs propriétaires ne pouvaient manquer de revenir.Ce fut autour d'eux qu'il imagina de tendre ses lignes, — non des lignes à collets, mais de véritables lignes à hameçon.Il emmena Harbert à quelque distance des nids, et là il prépara ses engins singuliers avec le soin qu'eût apporté un disciple d'Isaac Walton.Harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre, tout en doutant de la réussite.Les lignes furent faites de minces lianes, rattachées l'une à l'autre et longues de quinze à vingt pieds.De grosses épines très fortes, à pointes recourbées, que fournit un buisson d'acacias nains, furent liées aux extrémités des lianes en guise d'hameçon.Quant à l'appât, de gros vers rouges qui rampaient sur le sol en tinrent lieu.
Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d'hameçons près des nids de tétras; puis il revint prendre l'autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre.Tous deux alors attendirent patiemment.Harbert, il faut le dire, ne comptait pas beaucoup sur le succès de l'inventif Pencroff.Une grande demi-heure s'écoula, mais, ainsi que l'avait prévu le marin, plusieurs couples de tétras revinrent à leurs nids.Ils sautillaient, becquetant le sol, et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs, qui, d'ailleurs, avaient eu soin de se placer sous le vent des gallinacés.
Certes, le jeune garçon, à ce moment, se sentit intéressé très vivement.Il retenait son souffle, et Pencroff, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les lèvres avancées comme s'il allait goûter un morceau de tétras, respirait à peine.
Cependant, les gallinacés se promenaient entre les hameçons, sans trop s'en préoccuper.Pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts, comme si les vers eussent été encore vivants.
À coup sûr, le marin, en ce moment, éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne, qui, lui, ne voit pas venir sa proie à travers les eaux.
Les secousses éveillèrent bientôt l'attention des gallinacés, et les hameçons furent attaqués à coups de bec.Trois tétras, très voraces sans doute, avalèrent à la fois l'appât et l'hameçon.Soudain, d'un coup sec, Pencroff «ferra» son engin, et des battements d'aile lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris.
«Hurrah!» s'écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant.
Harbert avait battu des mains.C'était la première fois qu'il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin, très modeste, lui affirma qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et que, d'ailleurs, il n'avait pas le mérite de l'invention.
«Et en tout cas, ajouta-t-il, dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d'autres!»
Les tétras furent attachés par les pattes, et Pencroff, heureux de ne point revenir les mains vides et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure.
La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s'agissait que de redescendre le cours, et, vers six heures, assez fatigués de leur excursion, Harbert et Pencroff rentraient aux Cheminées.
CHAPITRE VII
Gédéon Spilett, immobile, les bras croisés, était alors sur la grève, regardant la mer, dont l'horizon se confondait dans l'est avec un gros nuage noir qui montait rapidement vers le zénith.Le vent était déjà fort, et il fraîchissait avec le déclin du jour.Tout le ciel avait un mauvais aspect, et les premiers symptômes d'un coup de vent se manifestaient visiblement.
Harbert entra dans les Cheminées, et Pencroff se dirigea vers le reporter.Celui-ci, très absorbé, ne le vit pas venir.
«Nous allons avoir une mauvaise nuit, Monsieur Spilett!dit le marin.De la pluie et du vent à faire la joie des pétrels!»
Le reporter, se retournant alors, aperçut Pencroff, et ses premières paroles furent celles-ci:
«À quelle distance de la côte la nacelle a-t-elle, selon vous, reçu ce coup de mer qui a emporté notre compagnon?»
Le marin ne s'attendait pas à cette question.Il réfléchit un instant et répondit:
«À deux encablures, au plus.
— Mais qu'est-ce qu'une encablure?demanda Gédéon Spilett.
— Cent vingt brasses environ ou six cents pieds.
— Ainsi, dit le reporter, Cyrus Smith aurait disparu à douze cents pieds au plus du rivage?
— Environ, répondit Pencroff.
— Et son chien aussi?
— Aussi.
— Ce qui m'étonne, ajouta le reporter, en admettant que notre compagnon ait péri, c'est que Top ait également trouvé la mort, et que ni le corps du chien, ni celui de son maître n'aient été rejetés au rivage!
— Ce n'est pas étonnant, avec une mer aussi forte, répondit le marin.D'ailleurs, il se peut que les courants les aient portés plus loin sur la côte.
— Ainsi, c'est bien votre avis que notre compagnon a péri dans les flots?demanda encore une fois le reporter.
— C'est mon avis.
— Mon avis, à moi, dit Gédéon Spilett, sauf ce que je dois à votre expérience, Pencroff, c'est que le double fait de la disparition absolue de Cyrus et de Top, vivants ou morts, a quelque chose d'inexplicable et d'invraisemblable.
— Je voudrais penser comme vous, Monsieur Spilett, répondit Pencroff.Malheureusement, ma conviction est faite!»
Cela dit, le marin revint vers les Cheminées.Un bon feu pétillait sur le foyer.Harbert venait d'y jeter une brassée de bois sec, et la flamme projetait de grandes clartés dans les parties sombres du couloir.
Pencroff s'occupa aussitôt de préparer le dîner.Il lui parut convenable d'introduire dans le menu quelque pièce de résistance, car tous avaient besoin de réparer leurs forces.Les chapelets de couroucous furent conservés pour le lendemain, mais on pluma deux tétras, et bientôt, embrochés dans une baguette, les gallinacés rôtissaient devant un feu flambant.
À sept heures du soir, Nab n'était pas encore de retour.Cette absence prolongée ne pouvait qu'inquiéter Pencroff au sujet du nègre.Il devait craindre ou qu'il lui fût arrivé quelque accident sur cette terre inconnue, ou que le malheureux eût fait quelque coup de désespoir.Mais Harbert tira de cette absence des conséquences toutes différentes.Pour lui, si Nab ne revenait pas, c'est qu'il s'était produit une circonstance nouvelle, qui l'avait engagé à prolonger ses recherches.Or, tout ce qui était nouveau ne pouvait l'être qu'à l'avantage de Cyrus Smith.
Pourquoi Nab n'était-il pas rentré, si un espoir quelconque ne le retenait pas?Peut-être avait-il trouvé quelque indice, une empreinte de pas, un reste d'épave qui l'avait mis sur la voie?Peut-être suivait-il en ce moment une piste certaine?Peut-être était-il près de son maître?...
Ainsi raisonnait le jeune garçon.Ainsi parla-t-il.
Ses compagnons le laissèrent dire.Seul, le reporter l'approuvait du geste.Mais, pour Pencroff, ce qui était probable, c'est que Nab avait poussé plus loin que la veille ses recherches sur le littoral, et qu'il ne pouvait encore être de retour.
Cependant, Harbert, très agité par de vagues pressentiments, manifesta plusieurs fois l'intention d'aller au-devant de Nab.Mais Pencroff lui fit comprendre que ce serait là une course inutile, que, dans cette obscurité et par ce déplorable temps, il ne pourrait retrouver les traces de Nab, et que mieux valait attendre.Si le lendemain Nab n'avait pas reparu, Pencroff n'hésiterait pas à se joindre à Harbert pour aller à la recherche de Nab.
Gédéon Spilett approuva l'opinion du marin sur ce point qu'il ne fallait pas se diviser, et Harbert dut renoncer à son projet; mais deux grosses larmes tombèrent de ses yeux.
Le reporter ne put se retenir d'embrasser le généreux enfant.
Le mauvais temps s'était absolument déclaré.Un coup de vent de sud-est passait sur la côte avec une violence sans égale.On entendait la mer, qui baissait alors, mugir contre la lisière des premières roches, au large du littoral.La pluie, pulvérisée par l'ouragan, s'enlevait comme un brouillard liquide.
On eût dit des haillons de vapeurs qui traînaient sur la côte, dont les galets bruissaient violemment, comme des tombereaux de cailloux qui se vident.Le sable, soulevé par le vent, se mêlait aux averses et en rendait l'assaut insoutenable.Il y avait dans l'air autant de poussière minérale que de poussière aqueuse.Entre l'embouchure de la rivière et le pan de la muraille, de grands remous tourbillonnaient, et les couches d'air qui s'échappaient de ce maelström, ne trouvant d'autre issue que l'étroite vallée au fond de laquelle se soulevait le cours d'eau, s'y engouffraient avec une irrésistible violence.Aussi la fumée du foyer, repoussée par l'étroit boyau, se rabattait-elle fréquemment, emplissant les couloirs et les rendant inhabitables.
C'est pourquoi, dès que les tétras furent cuits, Pencroff laissa tomber le feu, et ne conserva plus que des braises enfouies sous les cendres.
À huit heures, Nab n'avait pas encore reparu; mais on pouvait admettre maintenant que cet effroyable temps l'avait seul empêché de revenir, et qu'il avait dû chercher refuge dans quelque cavité, pour attendre la fin de la tourmente ou tout au moins le retour du jour.Quant à aller au-devant de lui, à tenter de le retrouver dans ces conditions, c'était impossible.
Le gibier forma l'unique plat du souper.On mangea volontiers de cette viande, qui était excellente.
Pencroff et Harbert, dont une longue excursion avait surexcité l'appétit, dévorèrent.
Puis, chacun se retira dans le coin où il avait déjà reposé la nuit précédente, et Harbert ne tarda pas à s'endormir près du marin, qui s'était étendu le long du foyer.Au dehors, avec la nuit qui s'avançait, la tempête prenait des proportions formidables.C'était un coup de vent comparable à celui qui avait emporté les prisonniers depuis Richmond jusqu'à cette terre du Pacifique.Tempêtes fréquentes pendant ces temps d'équinoxe, fécondes en catastrophes, terribles surtout sur ce large champ, qui n'oppose aucun obstacle à leur fureur!On comprend donc qu'une côte ainsi exposée à l'est, c'est-à-dire directement aux coups de l'ouragan, et frappée de plein fouet, fût battue avec une force dont aucune description ne peut donner l'idée.
Très heureusement, l'entassement de roches qui formait les Cheminées était solide.C'étaient d'énormes quartiers de granit, dont quelques-uns pourtant, insuffisamment équilibrés, semblaient trembler sur leur base.Pencroff sentait cela, et sous sa main, appuyée aux parois, couraient de rapides frémissements.Mais enfin il se répétait, et avec raison, qu'il n'y avait rien à craindre, et que sa retraite improvisée ne s'effondrerait pas.
Toutefois, il entendait le bruit des pierres, détachées du sommet du plateau et arrachées par les remous du vent, qui tombaient sur la grève.Quelques-unes roulaient même à la partie supérieure des Cheminées, ou y volaient en éclats, quand elles étaient projetées perpendiculairement.Deux fois, le marin se releva et vint en rampant à l'orifice du couloir, afin d'observer au dehors.Mais ces éboulements, peu considérables, ne constituaient aucun danger, et il reprit sa place devant le foyer, dont les braises crépitaient sous la cendre.
Malgré les fureurs de l'ouragan, le fracas de la tempête, le tonnerre de la tourmente, Harbert dormait profondément.Le sommeil finit même par s'emparer de Pencroff, que sa vie de marin avait habitué à toutes ces violences.Seul, Gédéon Spilett était tenu éveillé par l'inquiétude.Il se reprochait de ne pas avoir accompagné Nab.On a vu que tout espoir ne l'avait pas abandonné.Les pressentiments qui avaient agité Harbert n'avaient pas cessé de l'agiter aussi.Sa pensée était concentrée sur Nab.Pourquoi Nab n'était-il pas revenu?Il se retournait sur sa couche de sable, donnant à peine une vague attention à cette lutte des éléments.
Parfois, ses yeux, appesantis par la fatigue, se fermaient un instant, mais quelque rapide pensée les rouvrait presque aussitôt.
Cependant, la nuit s'avançait, et il pouvait être deux heures du matin, quand Pencroff, profondément endormi alors, fut secoué vigoureusement.
«Qu'est-ce?» s'écria-t-il, en s'éveillant et en reprenant ses idées avec cette promptitude particulière aux gens de mer.
Le reporter était penché sur lui, et lui disait:
«Écoutez, Pencroff, écoutez!»
Le marin prêta l'oreille et ne distingua aucun bruit étranger à celui des rafales.
«C'est le vent, dit-il.
— Non, répondit Gédéon Spilett, en écoutant de nouveau, j'ai cru entendre...
— Quoi?
— Les aboiements d'un chien!
— Un chien!s'écria Pencroff, qui se releva d'un bond.
— Oui...des aboiements...
— Ce n'est pas possible!répondit le marin.Et, d'ailleurs, comment, avec les mugissements de la tempête...
— Tenez...écoutez...» dit le reporter.
Pencroff écouta plus attentivement, et il crut, en effet, dans un instant d'accalmie, entendre des aboiements éloignés.
«Eh bien!...dit le reporter, en serrant la main du marin.
— Oui...oui!...répondit Pencroff.
— C'est Top!C'est Top!...» s'écria Harbert, qui venait de s'éveiller, et tous trois s'élancèrent vers l'orifice des Cheminées.
Ils eurent une peine extrême à sortir.Le vent les repoussait.Mais enfin, ils y parvinrent, et ne purent se tenir debout qu'en s'accotant contre les roches.
Ils regardèrent, ils ne pouvaient parler.
L'obscurité était absolue.La mer, le ciel, la terre, se confondaient dans une égale intensité des ténèbres.Il semblait qu'il n'y eût pas un atome de lumière diffuse dans l'atmosphère.
Pendant quelques minutes, le reporter et ses deux compagnons demeurèrent ainsi, comme écrasés par la rafale, trempés par la pluie, aveuglés par le sable.
Puis, ils entendirent encore une fois ces aboiements dans un répit de la tourmente, et ils reconnurent qu'ils devaient être assez éloignés.
Ce ne pouvait être que Top qui aboyait ainsi!
Mais était-il seul ou accompagné?Il est plus probable qu'il était seul, car, en admettant que Nab fût avec lui, Nab se serait dirigé en toute hâte vers les Cheminées.
Le marin pressa la main du reporter, dont il ne pouvait se faire entendre, et d'une façon qui signifiait: «Attendez!» puis, il rentra dans le couloir.Un instant après, il ressortait avec un fagot allumé, il le projetait dans les ténèbres, et il poussait des sifflements aigus.
À ce signal, qui était comme attendu, on eût pu le croire, des aboiements plus rapprochés répondirent, et bientôt un chien se précipita dans le couloir.
Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett y rentrèrent à sa suite.Une brassée de bois sec fut jetée sur les charbons.Le couloir s'éclaira d'une vive flamme.
«C'est Top!» s'écria Harbert.
C'était Top, en effet, un magnifique anglo-normand, qui tenait de ces deux races croisées la vitesse des jambes et la finesse de l'odorat, les deux qualités par excellence du chien courant.
C'était le chien de l'ingénieur Cyrus Smith.
Mais il était seul!Ni son maître, ni Nab ne l'accompagnaient!
Cependant, comment son instinct avait-il pu le conduire jusqu'aux Cheminées, qu'il ne connaissait pas?Cela paraissait inexplicable, surtout au milieu de cette nuit noire, et par une telle tempête!Mais, détail plus inexplicable encore, Top n'était ni fatigué, ni épuisé, ni même souillé de vase ou de sable!...
Harbert l'avait attiré vers lui et lui pressait la tête entre ses mains.Le chien se laissait faire et frottait son cou sur les mains du jeune garçon.
«Si le chien est retrouvé, le maître se retrouvera aussi!dit le reporter.
— Dieu le veuille!répondit Harbert.Partons!Top nous guidera!»
Pencroff ne fit pas une objection.Il sentait bien que l'arrivée de Top pouvait donner un démenti à ses conjectures.
«En route!» dit-il.
Pencroff recouvrit avec soin les charbons du foyer.
Il plaça quelques morceaux de bois sous les cendres, de manière à retrouver du feu au retour.Puis, précédé du chien, qui semblait l'inviter à venir par de petits aboiements, et suivi du reporter et du jeune garçon, il s'élança au dehors, après avoir pris les restes du souper.
La tempête était alors dans toute sa violence, et peut-être même à son maximum d'intensité.La lune, nouvelle alors, et, par conséquent, en conjonction avec le soleil, ne laissait pas filtrer la moindre lueur à travers les nuages.Suivre une route rectiligne devenait difficile.Le mieux était de s'en rapporter à l'instinct de Top.Ce qui fut fait.Le reporter et le jeune garçon marchaient derrière le chien, et le marin fermait la marche.Aucun échange de paroles n'eût été possible.La pluie ne tombait pas très abondamment, car elle se pulvérisait au souffle de l'ouragan, mais l'ouragan était terrible.
Toutefois, une circonstance favorisa très heureusement le marin et ses deux compagnons.En effet, le vent chassait du sud-est, et, par conséquent, il les poussait de dos.Ce sable qu'il projetait avec violence, et qui n'eût pas été supportable, ils le recevaient par derrière, et, à la condition de ne point se retourner, ils ne pouvaient en être incommodés de façon à gêner leur marche.En somme, ils allaient souvent plus vite qu'ils ne le voulaient, et précipitaient leurs pas afin de ne point être renversés, mais un immense espoir doublait leurs forces, et ce n'était plus à l'aventure, cette fois, qu'ils remontaient le rivage.Ils ne mettaient pas en doute que Nab n'eût retrouvé son maître, et qu'il ne leur eût envoyé le fidèle chien.Mais l'ingénieur était-il vivant, ou Nab ne mandait-il ses compagnons que pour rendre les derniers devoirs au cadavre de l'infortuné Smith?
Après avoir dépassé le pan coupé de la haute terre dont ils s'étaient prudemment écartés, Harbert, le reporter et Pencroff s'arrêtèrent pour reprendre haleine.Le retour du rocher les abritait contre le vent, et ils respiraient après cette marche d'un quart d'heure, qui avait été plutôt une course.
À ce moment, ils pouvaient s'entendre, se répondre, et le jeune garçon ayant prononcé le nom de Cyrus Smith, Top aboya à petits coups, comme s'il eût voulu dire que son maître était sauvé.
«Sauvé, n'est-ce pas?répétait Harbert, sauvé, Top?»
Et le chien aboyait comme pour répondre.
La marche fut reprise.Il était environ deux heures et demie du matin.La mer commençait à monter, et, poussée par le vent, cette marée, qui était une marée de syzygie, menaçait d'être très forte.Les grandes lames tonnaient contre la lisière d'écueils, et elles l'assaillaient avec une telle violence, que, très probablement, elles devaient passer par-dessus l'îlot, absolument invisible alors.Cette longue digue ne couvrait donc plus la côte, qui était directement exposée aux chocs du large.
Dès que le marin et ses compagnons se furent détachés du pan coupé, le vent les frappa de nouveau avec une extrême fureur.Courbés, tendant le dos à la rafale, ils marchaient très vite, suivant Top, qui n'hésitait pas sur la direction à prendre.Ils remontaient au nord, ayant sur leur droite une interminable crête de lames, qui déferlait avec un assourdissant fracas, et sur leur gauche une obscure contrée dont il était impossible de saisir l'aspect.
Mais ils sentaient bien qu'elle devait être relativement plate, car l'ouragan passait maintenant au-dessus d'eux sans les prendre en retour, effet qui se produisait quand il frappait la muraille de granit.
À quatre heures du matin, on pouvait estimer qu'une distance de cinq milles avait été franchie.Les nuages s'étaient légèrement relevés et ne traînaient plus sur le sol.La rafale, moins humide, se propageait en courants d'air très vifs, plus secs et plus froids.Insuffisamment protégés par leurs vêtements, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett devaient souffrir cruellement, mais pas une plainte ne s'échappait de leurs lèvres.Ils étaient décidés à suivre Top jusqu'où l'intelligent animal voudrait les conduire.
Vers cinq heures, le jour commença à se faire.Au zénith d'abord, où les vapeurs étaient moins épaisses, quelques nuances grisâtres découpèrent le bord des nuages, et bientôt, sous une bande opaque, un trait plus lumineux dessina nettement l'horizon de mer.La crête des lames se piqua légèrement de lueurs fauves, et l'écume se refit blanche.En même temps, sur la gauche, les parties accidentées du littoral commençaient à s'estomper confusément, mais ce n'était encore que du gris sur du noir.
À six heures du matin, le jour était fait.Les nuages couraient avec une extrême rapidité dans une zone relativement haute.Le marin et ses compagnons étaient alors à six milles environ des Cheminées.Ils suivaient une grève très plate, bordée au large par une lisière de roches dont les têtes seulement émergeaient alors, car on était au plein de la mer.Sur la gauche, la contrée, qu'accidentaient quelques dunes hérissées de chardons, offrait l'aspect assez sauvage d'une vaste région sablonneuse.Le littoral était peu découpé, et n'offrait d'autre barrière à l'Océan qu'une chaîne assez irrégulière de monticules.Çà et là, un ou deux arbres grimaçaient, couchés vers l'ouest, les branches projetées dans cette direction.Bien en arrière, dans le sud-ouest, s'arrondissait la lisière de la dernière forêt.En ce moment, Top donna des signes non équivoques d'agitation.Il allait en avant, revenait au marin, et semblait l'engager à hâter le pas.Le chien avait alors quitté la grève, et, poussé par son admirable instinct, sans montrer une seule hésitation, il s'était engagé entre les dunes.
On le suivit.Le pays paraissait être absolument désert.Pas un être vivant ne l'animait.
La lisière des dunes, fort large, était composée de monticules, et même de collines très capricieusement distribuées.C'était comme une petite Suisse de sable, et il ne fallait rien moins qu'un instinct prodigieux pour s'y reconnaître.
Cinq minutes après avoir quitté la grève, le reporter et ses compagnons arrivaient devant une sorte d'excavation creusée au revers d'une haute dune.Là, Top s'arrêta et jeta un aboiement clair.Spilett, Harbert et Pencroff pénétrèrent dans cette grotte.
Nab était là, agenouillé près d'un corps étendu sur un lit d'herbes...
Ce corps était celui de l'ingénieur Cyrus Smith.
CHAPITRE VIII
Nab ne bougea pas.Le marin ne lui jeta qu'un mot.
«Vivant!» s'écria-t-il.
Nab ne répondit pas.Gédéon Pilett et Pencroff devinrent pâles.Harbert joignit les mains et demeura immobile.Mais il était évident que le pauvre nègre, absorbé dans sa douleur, n'avait ni vu ses compagnons ni entendu les paroles du marin.
Le reporter s'agenouilla près de ce corps sans mouvement, et posa son oreille sur la poitrine de l'ingénieur, dont il entr'ouvrit les vêtements.Une minute — un siècle!— s'écoula, pendant qu'il cherchait à surprendre quelque battement du cœur.
Nab s'était redressé un peu et regardait sans voir.
Le désespoir n'eût pu altérer davantage un visage d'homme.Nab était méconnaissable, épuisé par la fatigue, brisé par la douleur.Il croyait son maître mort.
Gédéon Spilett, après une longue et attentive observation, se releva.
«Il vit!» dit-il.
Pencroff, à son tour, se mit à genoux près de Cyrus Smith; son oreille saisit aussi quelques battements, et ses lèvres, quelque souffle qui s'échappait des lèvres de l'ingénieur.
Harbert, sur un mot du reporter, s'élança au dehors pour chercher de l'eau.Il trouva à cent pas de là un ruisseau limpide, évidemment très grossi par les pluies de la veille, et qui filtrait à travers le sable.Mais rien pour mettre cette eau, pas une coquille dans ces dunes!Le jeune garçon dut se contenter de tremper son mouchoir dans le ruisseau, et il revint en courant vers la grotte.
Heureusement, ce mouchoir imbibé suffit à Gédéon Spilett, qui ne voulait qu'humecter les lèvres de l'ingénieur.Ces molécules d'eau fraîche produisirent un effet presque immédiat.Un soupir s'échappa de la poitrine de Cyrus Smith, et il sembla même qu'il essayait de prononcer quelques paroles.
«Nous le sauverons!» dit le reporter.
Nab avait repris espoir à ces paroles.Il déshabilla son maître, afin de voir si le corps ne présenterait pas quelque blessure.Ni la tête, ni le torse, ni les membres n'avaient de contusions, pas même d'écorchures, chose surprenante, puisque le corps de Cyrus Smith avait dû être roulé au milieu des roches; les mains elles-mêmes étaient intactes, et il était difficile d'expliquer comment l'ingénieur ne portait aucune trace des efforts qu'il avait dû faire pour franchir la ligne d'écueils.
Mais l'explication de cette circonstance viendrait plus tard.Quand Cyrus Smith pourrait parler, il dirait ce qui s'était passé.Pour le moment, il s'agissait de le rappeler à la vie, et il était probable que des frictions amèneraient ce résultat.
C'est ce qui fut fait avec la vareuse du marin.
L'ingénieur, réchauffé par ce rude massage, remua légèrement le bras, et sa respiration commença à se rétablir d'une façon plus régulière.Il mourait d'épuisement, et certes, sans l'arrivée du reporter et de ses compagnons, c'en était fait de Cyrus Smith.
«Vous l'avez donc cru mort, votre maître?demanda le marin à Nab.
— Oui!mort!répondit Nab, et si Top ne vous eût pas trouvés, si vous n'étiez pas venus, j'aurais enterré mon maître et je serais mort près de lui!»
On voit à quoi avait tenu la vie de Cyrus Smith!
Nab raconta alors ce qui s'était passé.La veille, après avoir quitté les Cheminées dès l'aube, il avait remonté la côte dans la direction du nord-nord et atteint la partie du littoral qu'il avait déjà visitée.
Là, sans aucun espoir, il l'avouait, Nab avait cherché sur le rivage, au milieu des roches, sur le sable, les plus légers indices qui pussent le guider.
Il avait examiné surtout la partie de la grève que la haute mer ne recouvrait pas, car, sur sa lisière, le flux et le reflux devaient avoir effacé tout indice.Nab n'espérait plus retrouver son maître vivant.C'était à la découverte d'un cadavre qu'il allait ainsi, un cadavre qu'il voulait ensevelir de ses propres mains!
Nab avait cherché longtemps.Ses efforts demeurèrent infructueux.Il ne semblait pas que cette côte déserte eût jamais été fréquentée par un être humain.Les coquillages, ceux que la mer ne pouvait atteindre, — et qui se rencontraient par millions au delà du relais des marées, — étaient intacts.Pas une coquille écrasée.Sur un espace de deux à trois cents yards, il n'existait pas trace d'un atterrissage, ni ancien, ni récent.
Nab s'était donc décidé à remonter la côte pendant quelques milles.Il se pouvait que les courants eussent porté un corps sur quelque point plus éloigné.
Lorsqu'un cadavre flotte à peu de distance d'un rivage plat, il est bien rare que le flot ne l'y rejette pas tôt ou tard.Nab le savait, et il voulait revoir son maître une dernière fois.
«Je longeai la côte pendant deux milles encore, je visitai toute la ligne des écueils à mer basse, toute la grève à mer haute, et je désespérais de rien trouver, quand hier, vers cinq heures du soir, je remarquai sur le sable des empreintes de pas.
— Des empreintes de pas?s'écria Pencroff.
— Oui!répondit Nab.
— Et ces empreintes commençaient aux écueils même?demanda le reporter.
— Non, répondit Nab, au relais de marée, seulement, car entre les relais et les récifs, les autres avaient dû être effacées.
— Continue, Nab, dit Gédéon Spilett.
— Quand je vis ces empreintes, je devins comme fou.Elles étaient très reconnaissables, et se dirigeaient vers les dunes.Je les suivis pendant un quart de mille, courant, mais prenant garde de les effacer.Cinq minutes après, comme la nuit se faisait, j'entendis les aboiements d'un chien.C'était Top, et Top me conduisit ici même, près de mon maître!»
Nab acheva son récit en disant quelle avait été sa douleur en retrouvant ce corps inanimé.Il avait essayé de surprendre en lui quelque reste de vie!
Maintenant qu'il l'avait retrouvé mort, il le voulait vivant!Tous ses efforts avaient été inutiles!Il n'avait plus qu'à rendre les derniers devoirs à celui qu'il aimait tant!
Nab avait alors songé à ses compagnons.Ceux-ci voudraient, sans doute, revoir une dernière fois l'infortuné!Top était là.Ne pouvait-il s'en rapporter à la sagacité de ce fidèle animal?Nab prononça à plusieurs reprises le nom du reporter, celui des compagnons de l'ingénieur que Top connaissait le plus.Puis, il lui montra le sud de la côte, et le chien s'élança dans la direction qui lui était indiquée.
On sait comment, guidé par un instinct que l'on peut regarder presque comme surnaturel, car l'animal n'avait jamais été aux Cheminées, Top y arriva cependant.
Les compagnons de Nab avaient écouté ce récit avec une extrême attention.
Il y avait pour eux quelque chose d'inexplicable à ce que Cyrus Smith, après les efforts qu'il avait dû faire pour échapper aux flots, en traversant les récifs, n'eût pas trace d'une égratignure.Et ce qui ne s'expliquait pas davantage, c'était que l'ingénieur eût pu gagner, à plus d'un mille de la côte, cette grotte perdue au milieu des dunes.
«Ainsi, Nab, dit le reporter, ce n'est pas toi qui as transporté ton maître jusqu'à cette place?
— Non, ce n'est pas moi, répondit Nab.
— Il est bien évident que M Smith y est venu seul, dit Pencroff.
— C'est évident, en effet, fit observer Gédéon Spilett, mais ce n'est pas croyable!»
On ne pourrait avoir l'explication de ce fait que de la bouche de l'ingénieur.Il fallait pour cela attendre que la parole lui fût revenue.Heureusement, la vie reprenait déjà son cours.Les frictions avaient rétabli la circulation du sang.Cyrus Smith remua de nouveau les bras, puis la tête, et quelques mots incompréhensibles s'échappèrent encore une fois de ses lèvres.
Nab, penché sur lui, l'appelait, mais l'ingénieur ne semblait pas entendre, et ses yeux étaient toujours fermés.La vie ne se révélait en lui que par le mouvement.Les sens n'y avaient encore aucune part.
Pencroff regretta bien de n'avoir pas de feu, ni de quoi s'en procurer, car il avait malheureusement oublié d'emporter le linge brûlé, qu'il eût facilement enflammé au choc de deux cailloux.Quant aux poches de l'ingénieur, elles étaient absolument vides, sauf celle de son gilet, qui contenait sa montre.Il fallait donc transporter Cyrus Smith aux Cheminées, et le plus tôt possible.Ce fut l'avis de tous.
Cependant, les soins qui furent prodigués à l'ingénieur devaient lui rendre la connaissance plus vite qu'on ne pouvait l'espérer.L'eau dont on humectait ses lèvres le ranimait peu à peu.Pencroff eut aussi l'idée de mêler à cette eau du jus de cette chair de tétras qu'il avait apportée.Harbert, ayant couru jusqu'au rivage, en revint avec deux grandes coquilles de bivalves.Le marin composa une sorte de mixture, et l'introduisit entre les lèvres de l'ingénieur, qui parut humer avidement ce mélange.
Ses yeux s'ouvrirent alors.Nab et le reporter s'étaient penchés sur lui.
«Mon maître!mon maître!» s'écria Nab.
L'ingénieur l'entendit.Il reconnut Nab et Spilett, puis ses deux autres compagnons, Harbert et le marin, et sa main pressa légèrement les leurs.Quelques mots s'échappèrent encore de sa bouche, — mots qu'il avait déjà prononcés, sans doute, et qui indiquaient quelles pensées tourmentaient, même alors, son esprit.Ces mots furent compris, cette fois.
«Île ou continent?murmura-t-il.
— Ah!s'écria Pencroff, qui ne put retenir cette exclamation.De par tous les diables, nous nous en moquons bien, pourvu que vous viviez, monsieur Cyrus!Île ou continent?On verra plus tard.»
L'ingénieur fit un léger signe affirmatif, et parut s'endormir.
On respecta ce sommeil, et le reporter prit immédiatement ses dispositions pour que l'ingénieur fût transporté dans les meilleures conditions.Nab, Harbert et Pencroff quittèrent la grotte et se dirigèrent vers une haute dune couronnée de quelques arbres rachitiques.Et, chemin faisant, le marin ne pouvait se retenir de répéter:
«Île ou continent!Songer à cela quand on n'a plus que le souffle!quel homme!»
Arrivés au sommet de la dune, Pencroff et ses deux compagnons, sans autres outils que leurs bras, dépouillèrent de ses principales branches un arbre assez malingre, sorte de pin maritime émacié par les vents; puis, de ces branches, on fit une litière qui, une fois recouverte de feuilles et d'herbes, permettrait de transporter l'ingénieur.
Ce fut l'affaire de quarante minutes environ, et il était dix heures quand le marin, Nab et Harbert revinrent auprès de Cyrus Smith, que Gédéon Spilett n'avait pas quitté.
L'ingénieur se réveillait alors de ce sommeil, ou plutôt de cet assoupissement dans lequel on l'avait trouvé.La coloration revenait à ses joues, qui avaient eu jusqu'ici la pâleur de la mort.Il se releva un peu, regarda autour de lui, et sembla demander où il se trouvait.
«Pouvez-vous m'entendre sans vous fatiguer, Cyrus?dit le reporter.
— Oui, répondit l'ingénieur.
— M'est avis, dit alors le marin, que M Smith vous entendra encore mieux, s'il revient à cette gelée de tétras, — car c'est du tétras, monsieur Cyrus», ajouta-t-il, en lui présentant quelque peu de cette gelée, à laquelle il mêla, cette fois, des parcelles de chair.
Cyrus Smith mâcha ces morceaux du tétras, dont les restes furent partagés entre ses trois compagnons, qui souffraient de la faim, et trouvèrent le déjeuner assez maigre.
«Bon!fit le marin, les victuailles nous attendent aux Cheminées, car il est bon que vous le sachiez, monsieur Cyrus, nous avons là-bas, dans le sud, une maison avec chambres, lits et foyer, et, dans l'office, quelques douzaines d'oiseaux que notre Harbert appelle des couroucous.Votre litière est prête, et, dès que vous vous en sentirez la force, nous vous transporterons à notre demeure.
— Merci, mon ami, répondit l'ingénieur, encore une heure ou deux, et nous pourrons partir...Et maintenant, parlez, Spilett.»
Le reporter fit alors le récit de ce qui s'était passé.Il raconta ces événements que devait ignorer Cyrus Smith, la dernière chute du ballon, l'atterrissage sur cette terre inconnue, qui semblait déserte, quelle qu'elle fût, soit une île, soit un continent, la découverte des Cheminées, les recherches entreprises pour retrouver l'ingénieur, le dévouement de Nab, tout ce qu'on devait à l'intelligence du fidèle Top, etc.
«Mais, demanda Cyrus Smith d'une voix encore affaiblie, vous ne m'avez donc pas ramassé sur la grève?
— Non, répondit le reporter.
— Et ce n'est pas vous qui m'avez rapporté dans cette grotte?
— Non.
— À quelle distance cette grotte est-elle donc des récifs?
— À un demi-mille environ, répondit Pencroff, et si vous êtes étonné, monsieur Cyrus, nous ne sommes pas moins surpris nous-mêmes de vous voir en cet endroit!
— En effet, répondit l'ingénieur, qui se ranimait peu à peu et prenait intérêt à ces détails, en effet, voilà qui est singulier!
— Mais, reprit le marin, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez été emporté par le coup de mer?»
Cyrus Smith rappela ses souvenirs.Il savait peu de chose.Le coup de mer l'avait arraché du filet de l'aérostat.Il s'enfonça d'abord à quelques brasses de profondeur.Revenu à la surface de la mer, dans cette demi-obscurité, il sentit un être vivant s'agiter près de lui.C'était Top, qui s'était précipité à son secours.En levant les yeux, il n'aperçut plus le ballon, qui, délesté de son poids et de celui du chien, était reparti comme une flèche.Il se vit, au milieu de ces flots courroucés, à une distance de la côte qui ne devait pas être inférieure à un demi-mille.Il tenta de lutter contre les lames en nageant avec vigueur.Top le soutenait par ses vêtements; mais un courant de foudre le saisit, le poussa vers le nord, et, après une demi-heure d'efforts, il coula, entraînant Top avec lui dans l'abîme.Depuis ce moment jusqu'au moment où il venait de se retrouver dans les bras de ses amis, il n'avait plus souvenir de rien.
«Cependant, reprit Pencroff, il faut que vous ayez été lancé sur le rivage, et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici, puisque Nab a retrouvé les empreintes de vos pas!
— Oui...il le faut...répondit l'ingénieur en réfléchissant.Et vous n'avez pas vu trace d'êtres humains sur cette côte?
— Pas trace, répondit le reporter.D'ailleurs, si par hasard quelque sauveur se fût rencontré là, juste à point, pourquoi vous aurait-il abandonné après vous avoir arraché aux flots?
— Vous avez raison, mon cher Spilett.— Dis-moi, Nab, ajouta l'ingénieur en se tournant vers son serviteur, ce n'est pas toi qui...tu n'aurais pas eu un moment d'absence...pendant lequel...Non, c'est absurde...Est-ce qu'il existe encore quelques-unes de ces empreintes?demanda Cyrus Smith.
— Oui, mon maître, répondit Nab, tenez, à l'entrée, sur le revers même de cette dune, dans un endroit abrité du vent et de la pluie.Les autres ont été effacées par la tempête.
— Pencroff, répondit Cyrus Smith, voulez-vous prendre mes souliers, et voir s'ils s'appliquent absolument à ces empreintes!»
Le marin fit ce que demandait l'ingénieur.Harbert et lui, guidés par Nab, allèrent à l'endroit où se trouvaient les empreintes, pendant que Cyrus Smith disait au reporter:
«Il s'est passé là des choses inexplicables!
— Inexplicables, en effet!répondit Gédéon Spilett.
— Mais n'y insistons pas en ce moment, mon cher Spilett, nous en causerons plus tard.»
Un instant après, le marin, Nab et Harbert rentraient.
Il n'y avait pas de doute possible.Les souliers de l'ingénieur s'appliquaient exactement aux empreintes conservées.Donc, c'était Cyrus Smith qui les avait laissées sur le sable.
«Allons, dit-il, c'est moi qui aurai éprouvé cette hallucination, cette absence que je mettais au compte de Nab!J'aurai marché comme un somnambule, sans avoir conscience de mes pas, et c'est Top qui, dans son instinct, m'aura conduit ici, après m'avoir arraché des flots...Viens, Top!Viens, mon chien!»
Le magnifique animal bondit jusqu'à son maître, en aboyant, et les caresses ne lui furent pas épargnées.
On conviendra qu'il n'y avait pas d'autre explication à donner aux faits qui avaient amené le sauvetage de Cyrus Smith, et qu'à Top revenait tout l'honneur de l'affaire.
Vers midi, Pencroff ayant demandé à Cyrus Smith si l'on pouvait le transporter, Cyrus Smith, pour toute réponse, et par un effort qui attestait la volonté la plus énergique, se leva.
Mais il dut s'appuyer sur le marin, car il serait tombé.
«Bon!bon!fit Pencroff!— La litière de monsieur l'ingénieur.»
La litière fut apportée.Les branches transversales avaient été recouvertes de mousses et de longues herbes.On y étendit Cyrus Smith, et l'on se dirigea vers la côte, Pencroff à une extrémité des brancards, Nab à l'autre.
C'étaient huit milles à franchir, mais comme on ne pourrait aller vite, et qu'il faudrait peut-être s'arrêter fréquemment, il fallait compter sur un laps de six heures au moins, avant d'avoir atteint les Cheminées.
Le vent était toujours violent, mais heureusement il ne pleuvait plus.Tout couché qu'il fut, l'ingénieur, accoudé sur son bras, observait la côte, surtout dans la partie opposée à la mer.Il ne parlait pas, mais il regardait, et certainement le dessin de cette contrée avec ses accidents de terrain, ses forêts, ses productions diverses, se grava dans son esprit.
Cependant, après deux heures de route, la fatigue l'emporta, et il s'endormit sur la litière.
À cinq heures et demie, la petite troupe arrivait au pan coupé, et, un peu après, devant les Cheminées.
Tous s'arrêtèrent, et la litière fut déposée sur le sable.Cyrus Smith dormait profondément et ne se réveilla pas.
Pencroff, à son extrême surprise, put alors constater que l'effroyable tempête de la veille avait modifié l'aspect des lieux.Des éboulements assez importants s'étaient produits.De gros quartiers de roche gisaient sur la grève, et un épais tapis d'herbes marines, varechs et algues, couvrait tout le rivage.Il était évident que la mer, passant par-dessus l'îlot, s'était portée jusqu'au pied de l'énorme courtine de granit.Devant l'orifice des Cheminées, le sol, profondément raviné, avait subi un violent assaut des lames.
Pencroff eut comme un pressentiment qui lui traversa l'esprit.Il se précipita dans le couloir.
Presque aussitôt, il en sortait, et demeurait immobile, regardant ses compagnons...
Le feu était éteint.Les cendres noyées n'étaient plus que vase.Le linge brûlé, qui devait servir d'amadou, avait disparu.La mer avait pénétré jusqu'au fond des couloirs, et tout bouleversé, tout détruit à l'intérieur des Cheminées!
CHAPITRE IX
En quelques mots, Gédéon Spilett, Harbert et Nab furent mis au courant de la situation.Cet accident, qui pouvait avoir des conséquences fort graves, — du moins Pencroff l'envisageait ainsi, — produisit des effets divers sur les compagnons de l'honnête marin.
Nab, tout à la joie d'avoir retrouvé son maître, n'écouta pas, ou plutôt ne voulut pas même se préoccuper de ce que disait Pencroff.
Harbert, lui, parut partager dans une certaine mesure les appréhensions du marin.
Quant au reporter, aux paroles de Pencroff, il répondit simplement:
«Sur ma foi, Pencroff, voilà qui m'est bien égal!
— Mais, je vous répète que nous n'avons plus de feu!
— Peuh!
— Ni aucun moyen de le rallumer.
— Baste!
— Pourtant, Monsieur Spilett...
— Est-ce que Cyrus n'est pas là?répondit le reporter.Est-ce qu'il n'est pas vivant, notre ingénieur?Il trouvera bien le moyen de nous faire du feu, lui!
— Et avec quoi?
— Avec rien.»
Qu'eût répondu Pencroff?Il n'eût pas répondu, car, au fond, il partageait la confiance que ses compagnons avaient en Cyrus Smith.L'ingénieur était pour eux un microcosme, un composé de toute la science et de toute l'intelligence humaine!Autant valait se trouver avec Cyrus dans une île déserte que sans Cyrus dans la plus industrieuse villa de l'Union.Avec lui, on ne pouvait manquer de rien.
Avec lui, on ne pouvait désespérer.On serait venu dire à ces braves gens qu'une éruption volcanique allait anéantir cette terre, que cette terre allait s'enfoncer dans les abîmes du Pacifique, qu'ils eussent imperturbablement répondu: «Cyrus est là!Voyez Cyrus!»
En attendant, toutefois, l'ingénieur était encore plongé dans une nouvelle prostration que le transport avait déterminée, et on ne pouvait faire appel à son ingéniosité en ce moment.Le souper devait nécessairement être fort maigre.En effet, toute la chair de tétras avait été consommée, et il n'existait aucun moyen de faire cuire un gibier quelconque.
D'ailleurs, les couroucous qui servaient de réserve avaient disparu.Il fallait donc aviser.
Avant tout, Cyrus Smith fut transporté dans le couloir central.Là, on parvint à lui arranger une couche d'algues et de varechs restés à peu près secs.
Le profond sommeil qui s'était emparé de lui ne pouvait que réparer rapidement ses forces, et mieux, sans doute, que ne l'eût fait une nourriture abondante.
La nuit était venue, et, avec elle, la température, modifiée par une saute du vent dans le nord-est, se refroidit sérieusement.Or, comme la mer avait détruit les cloisons établies par Pencroff en certains points des couloirs, des courants d'air s'établirent, qui rendirent les Cheminées peu habitables.L'ingénieur se fût donc trouvé dans des conditions assez mauvaises, si ses compagnons, se dépouillant de leur veste ou de leur vareuse, ne l'eussent soigneusement couvert.
Le souper, ce soir-là, ne se composa que de ces inévitables lithodomes, dont Harbert et Nab firent une ample récolte sur la grève.Cependant, à ces mollusques, le jeune garçon joignit une certaine quantité d'algues comestibles, qu'il ramassa sur de hautes roches dont la mer ne devait mouiller les parois qu'à l'époque des grandes marées.Ces algues, appartenant à la famille des fucacées, étaient des espèces de sargasse qui, sèches, fournissent une matière gélatineuse assez riche en éléments nutritifs.Le reporter et ses compagnons, après avoir absorbé une quantité considérable de lithodomes, sucèrent donc ces sargasses, auxquelles ils trouvèrent un goût très supportable, et il faut dire que, sur les rivages asiatiques, elles entrent pour une notable proportion dans l'alimentation des indigènes.
«N'importe!dit le marin, il est temps que M Cyrus nous vienne en aide.»
Cependant le froid devint très vif et, par malheur, il n'y avait aucun moyen de le combattre.
Le marin, véritablement vexé, chercha par tous les moyens possibles à se procurer du feu.Nab l'aida même dans cette opération.Il avait trouvé quelques mousses sèches, et, en frappant deux galets, il obtint des étincelles; mais la mousse, n'étant pas assez inflammable, ne prit pas, et, d'ailleurs, ces étincelles, qui n'étaient que du silex incandescent, n'avaient pas la consistance de celles qui s'échappent du morceau d'acier dans le briquet usuel.L'opération ne réussit donc pas.
Pencroff, bien qu'il n'eût aucune confiance dans le procédé, essaya ensuite de frotter deux morceaux de bois sec l'un contre l'autre, à la manière des sauvages.Certes, le mouvement que Nab et lui se donnèrent, s'il se fût transformé en chaleur, suivant les théories nouvelles, aurait suffi à faire bouillir une chaudière de steamer!Le résultat fut nul.Les morceaux de bois s'échauffèrent, voilà tout, et encore beaucoup moins que les opérateurs eux-mêmes.
Après une heure de travail, Pencroff était en nage, et il jeta les morceaux de bois avec dépit.
«Quand on me fera croire que les sauvages allument du feu de cette façon, dit-il, il fera chaud, même en hiver!J'allumerais plutôt mes bras en les frottant l'un contre l'autre!»
Le marin avait tort de nier le procédé.Il est constant que les sauvages enflamment le bois au moyen d'un frottement rapide.Mais toute espèce de bois n'est pas propre à cette opération, et puis, il y a «le coup», suivant l'expression consacrée, et il est probable que Pencroff n'avait pas «le coup.»
La mauvaise humeur de Pencroff ne fut pas de longue durée.Ces deux morceaux de bois rejetés par lui avaient été repris par Harbert, qui s'évertuait à les frotter de plus belle.Le robuste marin ne put retenir un éclat de rire, en voyant les efforts de l'adolescent pour réussir là où, lui, il avait échoué.
«Frottez, mon garçon, frottez!dit-il.
— Je frotte, répondit Harbert en riant, mais je n'ai pas d'autre prétention que de m'échauffer à mon tour au lieu de grelotter, et bientôt j'aurai aussi chaud que toi, Pencroff!»
Ce qui arriva.Quoi qu'il en fût, il fallut renoncer, pour cette nuit, à se procurer du feu.
Gédéon Spilett répéta une vingtième fois que Cyrus Smith ne serait pas embarrassé pour si peu.
Et, en attendant, il s'étendit dans un des couloirs, sur la couche de sable.Harbert, Nab et Pencroff l'imitèrent, tandis que Top dormait aux pieds de son maître.
Le lendemain, 28 mars, quand l'ingénieur se réveilla, vers huit heures du matin, il vit ses compagnons près de lui, qui guettaient son réveil, et, comme la veille, ses premières paroles furent:
«Île ou continent?»
On le voit, c'était son idée fixe.
«Bon!répondit Pencroff, nous n'en savons rien, monsieur Smith!
— Vous ne savez pas encore?...
— Mais nous le saurons, ajouta Pencroff, quand vous nous aurez piloté dans ce pays.
— Je crois être en état de l'essayer, répondit l'ingénieur, qui, sans trop d'efforts, se leva et se tint debout.
— Voilà qui est bon!s'écria le marin.
— Je mourais surtout d'épuisement, répondit Cyrus Smith.Mes amis, un peu de nourriture, et il n'y paraîtra plus.— Vous avez du feu, n'est-ce pas?»
Cette demande n'obtint pas une réponse immédiate.
Mais, après quelques instants:
«Hélas!nous n'avons pas de feu, dit Pencroff, ou plutôt, monsieur Cyrus, nous n'en avons plus!»
Et le marin fit le récit de ce qui s'était passé la veille.Il égaya l'ingénieur en lui racontant l'histoire de leur unique allumette, puis sa tentative avortée pour se procurer du feu à la façon des sauvages.
«Nous aviserons, répondit l'ingénieur, et si nous ne trouvons pas une substance analogue à l'amadou...
— Eh bien?demanda le marin.
— Eh bien, nous ferons des allumettes.
— Chimiques?
— Chimiques!
— Ce n'est pas plus difficile que cela», s'écria le reporter, en frappant sur l'épaule du marin.
Celui-ci ne trouvait pas la chose si simple, mais il ne protesta pas.Tous sortirent.Le temps était redevenu beau.Un vif soleil se levait sur l'horizon de la mer, et piquait de paillettes d'or les rugosités prismatiques de l'énorme muraille.
Après avoir jeté un rapide coup d'œil autour de lui, l'ingénieur s'assit sur un quartier de roche.Harbert lui offrit quelques poignées de moules et de sargasses, en disant:
«C'est tout ce que nous avons, monsieur Cyrus.
— Merci, mon garçon, répondit Cyrus Smith, cela suffira, — pour ce matin, du moins.»
Et il mangea avec appétit cette maigre nourriture, qu'il arrosa d'un peu d'eau fraîche, puisée à la rivière dans une vaste coquille.
Ses compagnons le regardaient sans parler.Puis, après s'être rassasié tant bien que mal, Cyrus Smith, croisant ses bras, dit:
«Ainsi, mes amis, vous ne savez pas encore si le sort nous a jetés sur un continent ou sur une île?
— Non, monsieur Cyrus, répondit le jeune garçon.
— Nous le saurons demain, reprit l'ingénieur.Jusque-là, il n'y a rien à faire.
— Si, répliqua Pencroff.
— Quoi donc?
— Du feu, dit le marin, qui, lui aussi, avait son idée fixe.
— Nous en ferons, Pencroff, répondit Cyrus Smith.— Pendant que vous me transportiez, hier, n'ai-je pas aperçu, dans l'ouest, une montagne qui domine cette contrée?
— Oui, répondit Gédéon Spilett, une montagne qui doit être assez élevée...
— Bien, reprit l'ingénieur.Demain, nous monterons à son sommet, et nous verrons si cette terre est une île ou un continent.Jusque-là, je le répète, rien à faire.
— Si, du feu!dit encore l'entêté marin.
— Mais on en fera, du feu!répliqua Gédéon Spilett.Un peu de patience, Pencroff!»
Le marin regarda Gédéon Spilett d'un air qui semblait dire: «S'il n'y a que vous pour en faire, nous ne tâterons pas du rôti de sitôt!» Mais il se tut.
Cependant Cyrus Smith n'avait point répondu.Il semblait fort peu préoccupé de cette question du feu.Pendant quelques instants, il demeura absorbé dans ses réflexions.Puis, reprenant la parole:
«Mes amis, dit-il, notre situation est peut-être déplorable, mais, en tout cas, elle est fort simple.
Ou nous sommes sur un continent, et alors, au prix de fatigues plus ou moins grandes, nous gagnerons quelque point habité, ou bien nous sommes sur une île.Dans ce dernier cas, de deux choses l'une: si l'île est habitée, nous verrons à nous tirer d'affaire avec ses habitants; si elle est déserte, nous verrons à nous tirer d'affaire tout seuls.
— Il est certain que rien n'est plus simple, répondit Pencroff.
— Mais, que ce soit un continent ou une île, demanda Gédéon Spilett, où pensez-vous, Cyrus, que cet ouragan nous ait jetés?
— Au juste, je ne puis le savoir, répondit l'ingénieur, mais les présomptions sont pour une terre du Pacifique.En effet, quand nous avons quitté Richmond, le vent soufflait du nord-est, et sa violence même prouve que sa direction n'a pas dû varier.Si cette direction s'est maintenue du nord-est au sud-ouest, nous avons traversé les états de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, le golfe du Mexique, le Mexique lui-même, dans sa partie étroite, puis une portion de l'océan Pacifique.Je n'estime pas à moins de six à sept mille milles la distance parcourue par le ballon, et, pour peu que le vent ait varié d'un demi-quart, il a dû nous porter soit sur l'archipel de Mendana, soit sur les Pomotou, soit même, s'il avait une vitesse plus grande que je ne le suppose, jusqu'aux terres de la Nouvelle-Zélande.Si cette dernière hypothèse s'est réalisée, notre rapatriement sera facile.Anglais ou Maoris, nous trouverons toujours à qui parler.Si, au contraire, cette côte appartient à quelque île déserte d'un archipel micronésien, peut-être pourrons-nous le reconnaître du haut de ce cône qui domine la contrée, et alors nous aviserons à nous établir ici, comme si nous ne devions jamais en sortir!
— Jamais!s'écria le reporter.Vous dites: jamais!mon cher Cyrus?
— Mieux vaut mettre les choses au pis tout de suite, répondit l'ingénieur, et ne se réserver que la surprise du mieux.
— Bien dit!répliqua Pencroff.Et il faut espérer aussi que cette île, si c'en est une, ne sera pas précisément située en dehors de la route des navires!Ce serait là véritablement jouer de malheur!
— Nous ne saurons à quoi nous en tenir qu'après avoir fait, et avant tout, l'ascension de la montagne, répondit l'ingénieur.
— Mais demain, monsieur Cyrus, demanda Harbert, serez-vous en état de supporter les fatigues de cette ascension?
— Je l'espère, répondit l'ingénieur, mais à la condition que maître Pencroff et toi, mon enfant, vous vous montriez chasseurs intelligents et adroits.
— Monsieur Cyrus, répondit le marin, puisque vous parlez de gibier, si, à mon retour, j'étais aussi certain de pouvoir le faire rôtir que je suis certain de le rapporter...
— Rapportez toujours, Pencroff», répondit Cyrus Smith.
Il fut donc convenu que l'ingénieur et le reporter passeraient la journée aux Cheminées, afin d'examiner le littoral et le plateau supérieur.Pendant ce temps, Nab, Harbert et le marin retourneraient à la forêt, y renouvelleraient la provision de bois, et feraient main-basse sur toute bête de plume ou de poil qui passerait à leur portée.
Ils partirent donc, vers dix heures du matin, Harbert confiant, Nab joyeux, Pencroff murmurant à part lui:
«Si, à mon retour, je trouve du feu à la maison, c'est que le tonnerre en personne sera venu l'allumer!»
Tous trois remontèrent la berge, et, arrivés au coude que formait la rivière, le marin, s'arrêtant, dit à ses deux compagnons:
«Commençons-nous par être chasseurs ou bûcherons?
— Chasseurs, répondit Harbert.Voilà déjà Top qui est en quête.
— Chassons donc, reprit le marin; puis, nous reviendrons ici faire notre provision de bois.»
Cela dit, Harbert, Nab et Pencroff, après avoir arraché trois bâtons au tronc d'un jeune sapin, suivirent Top, qui bondissait dans les grandes herbes.
Cette fois, les chasseurs, au lieu de longer le cours de la rivière, s'enfoncèrent plus directement au cœur même de la forêt.C'étaient toujours les mêmes arbres, appartenant pour la plupart à la famille des pins.En de certains endroits, moins pressés, isolés par bouquets, ces pins présentaient des dimensions considérables, et semblaient indiquer, par leur développement, que cette contrée se trouvait plus élevée en latitude que ne le supposait l'ingénieur.Quelques clairières, hérissées de souches rongées par le temps, étaient couvertes de bois mort, et formaient ainsi d'inépuisables réserves de combustible.Puis, la clairière passée, le taillis se resserrait et devenait presque impénétrable.
Se guider au milieu de ces massifs d'arbres, sans aucun chemin frayé, était chose assez difficile.Aussi, le marin, de temps en temps, jalonnait-il sa route en faisant quelques brisées qui devaient être aisément reconnaissables.Mais peut-être avait-il eu tort de ne pas remonter le cours d'eau, ainsi qu'Harbert et lui avaient fait pendant leur première excursion, car, après une heure de marche, pas un gibier ne s'était encore montré.Top, en courant sous les basses ramures, ne donnait l'éveil qu'à des oiseaux qu'on ne pouvait approcher.Les couroucous eux-mêmes étaient absolument invisibles, et il était probable que le marin serait forcé de revenir à cette partie marécageuse de la forêt, dans laquelle il avait si heureusement opéré sa pêche aux tétras.
«Eh!Pencroff, dit Nab d'un ton un peu sarcastique, si c'est là tout le gibier que vous avez promis de rapporter à mon maître, il ne faudra pas grand feu pour le faire rôtir!
— Patience, Nab, répondit le marin, ce n'est pas le gibier qui manquera au retour!
— Vous n'avez donc pas confiance en M Smith?
— Si.
— Mais vous ne croyez pas qu'il fera du feu?
— Je le croirai quand le bois flambera dans le foyer.
— Il flambera, puisque mon maître l'a dit!
— Nous verrons!»
Cependant, le soleil n'avait pas encore atteint le plus haut point de sa course au-dessus de l'horizon.
L'exploration continua donc, et fut utilement marquée par la découverte qu'Harbert fit d'un arbre dont les fruits étaient comestibles.C'était le pin pigeon, qui produit une amande excellente, très estimée dans les régions tempérées de l'Amérique et de l'Europe.Ces amandes étaient dans un parfait état de maturité, et Harbert les signala à ses deux compagnons, qui s'en régalèrent.
«Allons, dit Pencroff, des algues en guise de pain, des moules crues en guise de chair, et des amandes pour dessert, voilà bien le dîner de gens qui n'ont plus une seule allumette dans leur poche!
— Il ne faut pas se plaindre, répondit Harbert.
— Je ne me plains pas, mon garçon, répondit Pencroff.Seulement, je répète que la viande est un peu trop économisée dans ce genre de repas!
— Top a vu quelque chose!...» s'écria Nab, qui courut vers un fourré au milieu duquel le chien avait disparu en aboyant.
Aux aboiements de Top se mêlaient des grognements singuliers.
Le marin et Harbert avaient suivi Nab.S'il y avait là quelque gibier, ce n'était pas le moment de discuter comment on pourrait le faire cuire, mais bien comment on pourrait s'en emparer.
Les chasseurs, à peine entrés dans le taillis, virent Top aux prises avec un animal qu'il tenait par une oreille.Ce quadrupède était une espèce de porc long de deux pieds et demi environ, d'un brun noirâtre mais moins foncé au ventre, ayant un poil dur et peu épais, et dont les doigts, alors fortement appliqués sur le sol, semblaient réunis par des membranes.
Harbert crut reconnaître en cet animal un cabiai, c'est-à-dire un des plus grands échantillons de l'ordre des rongeurs.
Cependant, le cabiai ne se débattait pas contre le chien.Il roulait bêtement ses gros yeux profondément engagés dans une épaisse couche de graisse.Peut-être voyait-il des hommes pour la première fois.
Cependant, Nab, ayant assuré son bâton dans sa main, allait assommer le rongeur, quand celui-ci, s'arrachant aux dents de Top, qui ne garda qu'un bout de son oreille, poussa un vigoureux grognement, se précipita sur Harbert, le renversa à demi, et disparut à travers bois.
«Ah!le gueux!» s'écria Pencroff.
Aussitôt tous trois s'étaient lancés sur les traces de Top, et au moment où ils allaient le rejoindre, l'animal disparaissait sous les eaux d'une vaste mare, ombragée par de grands pins séculaires.
Nab, Harbert, Pencroff s'étaient arrêtés, immobiles.Top s'était jeté à l'eau, mais le cabiai, caché au fond de la mare, ne paraissait plus.
«Attendons, dit le jeune garçon, car il viendra bientôt respirer à la surface.
— Ne se noiera-t-il pas?demanda Nab.
— Non, répondit Harbert, puisqu'il a les pieds palmés, et c'est presque un amphibie.Mais guettons-le.»
Top était resté à la nage.Pencroff et ses deux compagnons allèrent occuper chacun un point de la berge, afin de couper toute retraite au cabiai, que le chien cherchait en nageant à la surface de la mare.
Harbert ne se trompait pas.Après quelques minutes, l'animal remonta au-dessus des eaux.Top d'un bond fut sur lui, et l'empêcha de plonger à nouveau.Un instant plus tard, le cabiai, traîné jusqu'à la berge, était assommé d'un coup du bâton de Nab.
«Hurrah!s'écria Pencroff, qui employait volontiers ce cri de triomphe.Rien qu'un charbon ardent, et ce rongeur sera rongé jusqu'aux os!»
Pencroff chargea le cabiai sur son épaule, et, jugeant à la hauteur du soleil qu'il devait être environ deux heures, il donna le signal du retour.
L'instinct de Top ne fut pas inutile aux chasseurs, qui, grâce à l'intelligent animal, purent retrouver le chemin déjà parcouru.Une demi-heure après, ils arrivaient au coude de la rivière.
Ainsi qu'il l'avait fait la première fois, Pencroff établit rapidement un train de bois, bien que, faute de feu, cela lui semblât une besogne inutile, et, le train suivant le fil de l'eau, on revint vers les Cheminées.
Mais, le marin n'en était pas à cinquante pas qu'il s'arrêtait, poussait de nouveau un hurrah formidable, et, tendant la main vers l'angle de la falaise:
«Harbert!Nab!Voyez!» s'écriait-il.
Une fumée s'échappait et tourbillonnait au-dessus des roches!
CHAPITRE X
Quelques instants après, les trois chasseurs se trouvaient devant un foyer pétillant.Cyrus Smith et le reporter étaient là.Pencroff les regardait l'un et l'autre, sans mot dire, son cabiai à la main.
«Eh bien, oui, mon brave, s'écria le reporter.Du feu, du vrai feu, qui rôtira parfaitement ce magnifique gibier dont nous nous régalerons tout à l'heure!
— Mais qui a allumé?...demanda Pencroff.
— Le soleil!»
La réponse de Gédéon Spilett était exacte.C'était le soleil qui avait fourni cette chaleur dont s'émerveillait Pencroff.Le marin ne voulait pas en croire ses yeux, et il était tellement ébahi, qu'il ne pensait pas à interroger l'ingénieur.
«Vous aviez donc une lentille, monsieur?demanda Harbert à Cyrus Smith.
— Non, mon enfant, répondit celui-ci, mais j'en ai fait une.»
Et il montra l'appareil qui lui avait servi de lentille.C'étaient tout simplement les deux verres qu'il avait enlevés à la montre du reporter et à la sienne.Après les avoir remplis d'eau et rendu leurs bords adhérents au moyen d'un peu de glaise, il s'était ainsi fabriqué une véritable lentille, qui, concentrant les rayons solaires sur une mousse bien sèche, en avait déterminé la combustion.
Le marin considéra l'appareil, puis il regarda l'ingénieur sans prononcer un mot.Seulement, son regard en disait long!Si, pour lui, Cyrus SMith n'était pas un dieu, c'était assurément plus qu'un homme.Enfin la parole lui revint, et il s'écria:
«Notez cela, Monsieur Spilett, notez cela sur votre papier!
— C'est noté», répondit le reporter.
Puis, Nab aidant, le marin disposa la broche, et le cabiai, convenablement vidé, grilla bientôt, comme un simple cochon de lait, devant une flamme claire et pétillante.
Les Cheminées étaient redevenues plus habitables, non seulement parce que les couloirs s'échauffaient au feu du foyer, mais parce que les cloisons de pierres et de sable avaient été rétablies.
On le voit, l'ingénieur et son compagnon avaient bien employé la journée.Cyrus Smith avait presque entièrement recouvré ses forces, et s'était essayé en montant sur le plateau supérieur.De ce point, son œil, accoutumé à évaluer les hauteurs et les distances, s'était longtemps fixé sur ce cône dont il voulait le lendemain atteindre la cime.Le mont, situé à six milles environ dans le nord-ouest, lui parut mesurer trois mille cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer.Par conséquent, le regard d'un observateur posté à son sommet pourrait parcourir l'horizon dans un rayon de cinquante milles au moins.
Il était donc probable que Cyrus Smith résoudrait aisément cette question «de continent ou d'île», à laquelle il donnait, non sans raison, le pas sur toutes les autres.
On soupa convenablement.La chair du cabiai fut déclarée excellente.Les sargasses et les amandes de pin pignon complétèrent ce repas, pendant lequel l'ingénieur parla peu.Il était préoccupé des projets du lendemain.Une ou deux fois, Pencroff émit quelques idées sur ce qu'il conviendrait de faire, mais Cyrus Smith, qui était évidemment un esprit méthodique, se contenta de secouer la tête.
«Demain, répétait-il, nous saurons à quoi nous en tenir, et nous agirons en conséquence.»
Le repas terminé, de nouvelles brassées de bois furent jetées sur le foyer, et les hôtes des Cheminées, y compris le fidèle Top, s'endormirent d'un profond sommeil.Aucun incident ne troubla cette nuit paisible, et le lendemain, — 29 mars, — frais et dispos, ils se réveillaient, prêts à entreprendre cette excursion qui devait fixer leur sort.
Tout était prêt pour le départ.Les restes du cabiai pouvaient nourrir pendant vingt-quatre heures encore Cyrus Smith et ses compagnons.D'ailleurs, ils espéraient bien se ravitailler en route.Comme les verres avaient été remis aux montres de l'ingénieur et du reporter, Pencroff brûla un peu de ce linge qui devait servir d'amadou.Quant au silex, il ne devait pas manquer dans ces terrains d'origine plutonienne.
Il était sept heures et demie du matin, quand les explorateurs, armés de bâtons, quittèrent les Cheminées.Suivant l'avis de Pencroff, il parut bon de prendre le chemin déjà parcouru à travers la forêt, quitte à revenir par une autre route.C'était aussi la voie la plus directe pour atteindre la montagne.On tourna donc l'angle sud, et on suivit la rive gauche de la rivière, qui fut abandonnée au point où elle se coudait vers le sud-ouest.Le sentier, déjà frayé sous les arbres verts, fut retrouvé, et, à neuf heures, Cyrus Smith et ses compagnons atteignaient la lisière occidentale de la forêt.
Le sol, jusqu'alors peu accidenté, marécageux d'abord, sec et sablonneux ensuite, accusait une légère pente, qui remontait du littoral vers l'intérieur de la contrée.Quelques animaux, très fuyards, avaient été entrevus sous les futaies.Top les faisait lever lestement, mais son maître le rappelait aussitôt, car le moment n'était pas venu de les poursuivre.Plus tard, on verrait.L'ingénieur n'était point homme à se laisser distraire de son idée fixe.On ne se serait même pas trompé en affirmant qu'il n'observait le pays, ni dans sa configuration, ni dans ses productions naturelles.Son seul objectif, c'était ce mont qu'il prétendait gravir, et il y allait tout droit.
À dix heures, on fit une halte de quelques minutes.Au sortir de la forêt, le système orographique de la contrée avait apparu aux regards.Le mont se composait de deux cônes.Le premier, tronqué à une hauteur de deux mille cinq cents pieds environ, était soutenu par de capricieux contreforts, qui semblaient se ramifier comme les griffes d'une immense serre appliquée sur le sol.Entre ces contreforts se creusaient autant de vallées étroites, hérissées d'arbres, dont les derniers bouquets s'élevaient jusqu'à la troncature du premier cône.Toutefois, la végétation paraissait être moins fournie dans la partie de la montagne exposée au nord-est, et on y apercevait des zébrures assez profondes, qui devaient être des coulées laviques.Sur le premier cône reposait un second cône, légèrement arrondi à sa cime, et qui se tenait un peu de travers.On eût dit un vaste chapeau rond placé sur l'oreille.Il semblait formé d'une terre dénudée, que perçaient en maint endroit des roches rougeâtres.
C'était le sommet de ce second cône qu'il convenait d'atteindre, et l'arête des contreforts devait offrir la meilleure route pour y arriver.
«Nous sommes sur un terrain volcanique», avait dit Cyrus Smith, et ses compagnons, le suivant, commencèrent à s'élever peu à peu sur le dos d'un contrefort, qui, par une ligne sinueuse et par conséquent plus aisément franchissable, aboutissait au premier plateau.
Les intumescences étaient nombreuses sur ce sol, que les forces plutoniennes avaient évidemment convulsionné.Çà et là, blocs erratiques, débris nombreux de basalte, pierres ponces, obsidiennes.Par bouquets isolés, s'élevaient de ces conifères, qui, quelques centaines de pieds plus bas, au fond des étroites gorges, formaient d'épais massifs, presque impénétrables aux rayons du soleil.
Pendant cette première partie de l'ascension sur les rampes inférieures, Harbert fit remarquer des empreintes qui indiquaient le passage récent de grands animaux, fauves ou autres.
«Ces bêtes-là ne nous céderont peut-être pas volontiers leur domaine?dit Pencroff.
— Eh bien, répondit le reporter, qui avait déjà chassé le tigre aux Indes et le lion en Afrique, nous verrons à nous en débarrasser.Mais, en attendant, tenons-nous sur nos gardes!»
Cependant, on s'élevait peu à peu.La route, accrue par des détours et des obstacles qui ne pouvaient être franchis directement, était longue.Quelquefois aussi, le sol manquait subitement, et l'on se trouvait sur le bord de profondes crevasses qu'il fallait tourner.À revenir ainsi sur ses pas, afin de suivre quelque sentier praticable, c'était du temps employé et des fatigues subies.À midi, quand la petite troupe fit halte pour déjeuner au pied d'un large bouquet de sapins, près d'un petit ruisseau qui s'en allait en cascade, elle se trouvait encore à mi-chemin du premier plateau, qui, dès lors, ne serait vraisemblablement atteint qu'à la nuit tombante.De ce point, l'horizon de mer se développait plus largement; mais, sur la droite, le regard, arrêté par le promontoire aigu du sud-est, ne pouvait déterminer si la côte se rattachait par un brusque retour à quelque terre d'arrière plan.À gauche, le rayon de vue gagnait bien quelques milles au nord; toutefois, dès le nord-ouest, au point qu'occupaient les explorateurs, il était coupé net par l'arête d'un contrefort bizarrement taillé, qui formait comme la puissante culée du cône central.On ne pouvait donc rien pressentir encore de la question que voulait résoudre Cyrus Smith.
À une heure, l'ascension fut reprise.Il fallut biaiser vers le sud-ouest et s'engager de nouveau dans des taillis assez épais.Là, sous le couvert des arbres, voletaient plusieurs couples de gallinacés de la famille des faisans.C'étaient des «tragopans», ornés d'un fanon charnu qui pendait sur leurs gorges, et de deux minces cornes cylindriques, plantées en arrière de leurs yeux.Parmi ces couples, de la taille d'un coq, la femelle était uniformément brune, tandis que le mâle resplendissait sous son plumage rouge, semé de petites larmes blanches.
Gédéon Spilett, d'un coup de pierre, adroitement et vigoureusement lancé, tua un de ces tragopans, que Pencroff, affamé par le grand air, ne regarda pas sans quelque convoitise.
Après avoir quitté ce taillis, les ascensionnistes, se faisant la courte échelle, gravirent sur un espace de cent pieds un talus très raide, et atteignirent un étage supérieur, peu fourni d'arbres, dont le sol prenait une apparence volcanique.Il s'agissait alors de revenir vers l'est, en décrivant des lacets qui rendaient les pentes plus praticables, car elles étaient alors fort raides, et chacun devait choisir avec soin l'endroit où se posait son pied.Nab et Harbert tenaient la tête, Pencroff la queue; entre eux, Cyrus et le reporter.Les animaux qui fréquentaient ces hauteurs — et les traces ne manquaient pas — devaient nécessairement appartenir à ces races, au pied sûr et à l'échine souple, des chamois ou des isards.On en vit quelques-uns, mais ce ne fut pas le nom que leur donna Pencroff, car, à un certain moment:
«Des moutons!» s'écria-t-il.
Tous s'étaient arrêtés à cinquante pas d'une demi-douzaine d'animaux de grande taille, aux fortes cornes courbées en arrière et aplaties vers la pointe, à la toison laineuse, cachée sous de longs poils soyeux de couleur fauve.
Ce n'étaient point des moutons ordinaires, mais une espèce communément répandue dans les régions montagneuses des zones tempérées, à laquelle Harbert donna le nom de mouflons.
«Ont-ils des gigots et des côtelettes?demanda le marin.
— Oui, répondit Harbert.
— Eh bien, ce sont des moutons!» dit Pencroff.
Ces animaux, immobiles entre les débris de basalte, regardaient d'un œil étonné, comme s'ils voyaient pour la première fois des bipèdes humains.Puis, leur crainte subitement éveillée, ils disparurent en bondissant sur les roches.
«Au revoir!» leur cria Pencroff d'un ton si comique, que Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert et Nab ne purent s'empêcher de rire.
L'ascension continua.On pouvait fréquemment observer, sur certaines déclivités, des traces de laves, très capricieusement striées.De petites solfatares coupaient parfois la route suivie par les ascensionnistes, et il fallait en prolonger les bords.En quelques points, le soufre avait déposé sous la forme de concrétions cristallines, au milieu de ces matières qui précèdent généralement les épanchements laviques, pouzzolanes à grains irréguliers et fortement torréfiés, cendres blanchâtres faites d'une infinité de petits cristaux feldspathiques.Aux approches du premier plateau, formé par la troncature du cône inférieur, les difficultés de l'ascension furent très prononcées.Vers quatre heures, l'extrême zone des arbres avait été dépassée.Il ne restait plus, çà et là, que quelques pins grimaçants et décharnés, qui devaient avoir la vie dure pour résister, à cette hauteur, aux grands vents du large.
Heureusement pour l'ingénieur et ses compagnons, le temps était beau, l'atmosphère tranquille, car une violente brise, à une altitude de trois mille pieds, eût gêné leurs évolutions.La pureté du ciel au zénith se sentait à travers la transparence de l'air.Un calme parfait régnait autour d'eux.Ils ne voyaient plus le soleil, alors caché par le vaste écran du cône supérieur, qui masquait le demi-horizon de l'ouest, et dont l'ombre énorme, s'allongeant jusqu'au littoral, croissait à mesure que l'astre radieux s'abaissait dans sa course diurne.Quelques vapeurs, brumes plutôt que nuages, commençaient à se montrer dans l'est, et se coloraient de toutes les couleurs spectrales sous l'action des rayons solaires.
Cinq cents pieds seulement séparaient alors les explorateurs du plateau qu'ils voulaient atteindre, afin d'y établir un campement pour la nuit, mais ces cinq cents pieds s'accrurent de plus de deux milles par les zigzags qu'il fallut décrire.Le sol, pour ainsi dire, manquait sous le pied.Les pentes présentaient souvent un angle tellement ouvert, que l'on glissait sur les coulées de laves, quand les stries, usées par l'air, n'offraient pas un point d'appui suffisant.Enfin, le soir se faisait peu à peu, et il était presque nuit, quand Cyrus Smith et ses compagnons, très fatigués par une ascension de sept heures, arrivèrent au plateau du premier cône.
Il fut alors question d'organiser le campement, et de réparer ses forces, en soupant d'abord, en dormant ensuite.Ce second étage de la montagne s'élevait sur une base de roches, au milieu desquelles on trouva facilement une retraite.Le combustible n'était pas abondant.Cependant, on pouvait obtenir du feu au moyen des mousses et des broussailles sèches qui hérissaient certaines portions du plateau.Pendant que le marin préparait son foyer sur des pierres qu'il disposa à cet usage, Nab et Harbert s'occupèrent de l'approvisionner en combustible.
Ils revinrent bientôt avec leur charge de broussailles.
Le briquet fut battu, le linge brûlé recueillit les étincelles du silex, et, sous le souffle de Nab, un feu pétillant se développa, en quelques instants, à l'abri des roches.
Ce feu n'était destiné qu'à combattre la température un peu froide de la nuit, et il ne fut pas employé à la cuisson du faisan, que Nab réservait pour le lendemain.Les restes du cabiai et quelques douzaines d'amandes de pin pignon formèrent les éléments du souper.Il n'était pas encore six heures et demie que tout était terminé.
Cyrus Smith eut alors la pensée d'explorer, dans la demi-obscurité, cette large assise circulaire qui supportait le cône supérieur de la montagne.Avant de prendre quelque repos, il voulait savoir si ce cône pourrait être tourné à sa base, pour le cas où ses flancs, trop déclives, le rendraient inaccessible jusqu'à son sommet.Cette question ne laissait pas de le préoccuper, car il était possible que, du côté où le chapeau s'inclinait, c'est-à-dire vers le nord, le plateau ne fût pas praticable.Or, si la cime de la montagne ne pouvait être atteinte, d'une part, et si, de l'autre, on ne pouvait contourner la base du cône, il serait impossible d'examiner la portion occidentale de la contrée, et le but de l'ascension serait en partie manqué.
Donc, l'ingénieur, sans tenir compte de ses fatigues, laissant Pencroff et Nab organiser la couchée, et Gédéon Spilett noter les incidents du jour, commença à suivre la lisière circulaire du plateau, en se dirigeant vers le nord.Harbert l'accompagnait.
La nuit était belle et tranquille, l'obscurité peu profonde encore.Cyrus Smith et le jeune garçon marchaient l'un près de l'autre, sans parler.En de certains endroits, le plateau s'ouvrait largement devant eux, et ils passaient sans encombre.En d'autres, obstrué par les éboulis, il n'offrait qu'une étroite sente, sur laquelle deux personnes ne pouvaient marcher de front.Il arriva même qu'après une marche de vingt minutes, Cyrus Smith et Harbert durent s'arrêter.À partir de ce point, le talus des deux cônes affleurait.Plus d'épaulement qui séparât les deux parties de la montagne.La contourner sur des pentes inclinées à près de soixante-dix degrés devenait impraticable.
Mais, si l'ingénieur et le jeune garçon durent renoncer à suivre une direction circulaire, en revanche, la possibilité leur fut alors donnée de reprendre directement l'ascension du cône.En effet, devant eux s'ouvrait un éventrement profond du massif.C'était l'égueulement du cratère supérieur, le goulot, si l'on veut, par lequel s'échappaient les matières éruptives liquides, à l'époque où le volcan était encore en activité.Les laves durcies, les scories encroûtées formaient une sorte d'escalier naturel, aux marches largement dessinées, qui devaient faciliter l'accès du sommet de la montagne.Un coup d'œil suffit à Cyrus Smith pour reconnaître cette disposition, et, sans hésiter, suivi du jeune garçon, il s'engagea dans l'énorme crevasse, au milieu d'une obscurité croissante.
C'était encore une hauteur de mille pieds à franchir.
Les déclivités intérieures du cratère seraient-elles praticables?On le verrait bien.L'ingénieur continuerait sa marche ascensionnelle, tant qu'il ne serait pas arrêté.Heureusement, ces déclivités, très allongées et très sinueuses, décrivaient un large pas de vis à l'intérieur du volcan, et favorisaient la marche en hauteur.
Quant au volcan lui-même, on ne pouvait douter qu'il ne fût complètement éteint.Pas une fumée ne s'échappait de ses flancs.Pas une flamme ne se décelait dans les cavités profondes.Pas un grondement, pas un murmure, pas un tressaillement ne sortait de ce puits obscur, qui se creusait peut-être jusqu'aux entrailles du globe.L'atmosphère même, au dedans de ce cratère, n'était saturée d'aucune vapeur sulfureuse.C'était plus que le sommeil d'un volcan, c'était sa complète extinction.
La tentative de Cyrus Smith devait réussir.Peu à peu, Harbert et lui, en remontant sur les parois internes, virent le cratère s'élargir au-dessus de leur tête.Le rayon de cette portion circulaire du ciel, encadrée par les bords du cône, s'accrut sensiblement.À chaque pas, pour ainsi dire, que firent Cyrus Smith et Harbert, de nouvelles étoiles entrèrent dans le champ de leur vision.Les magnifiques constellations de ce ciel austral resplendissaient.Au zénith, brillaient d'un pur éclat la splendide Antarès du Scorpion, et, non loin, cette B du Centaure que l'on croit être l'étoile la plus rapprochée du globe terrestre.Puis, à mesure que s'évasait le cratère, apparurent Fomalhaut du Poisson, le Triangle austral, et enfin, presque au pôle antarctique du monde, cette étincelante Croix du Sud, qui remplace la Polaire de l'hémisphère boréal.
Il était près de huit heures, quand Cyrus Smith et Harbert mirent le pied sur la crête supérieure du mont, au sommet du cône.
L'obscurité était complète alors, et ne permettait pas au regard de s'étendre sur un rayon de deux milles.La mer entourait-elle cette terre inconnue, ou cette terre se rattachait-elle, dans l'ouest, à quelque continent du Pacifique?On ne pouvait encore le reconnaître.Vers l'ouest, une bande nuageuse, nettement dessinée à l'horizon, accroissait les ténèbres, et l'œil ne savait découvrir si le ciel et l'eau s'y confondaient sur une même ligne circulaire.
Mais, en un point de cet horizon, une vague lueur parut soudain, qui descendait lentement, à mesure que le nuage montait vers le zénith.
C'était le croissant délié de la lune, déjà près de disparaître.Mais sa lumière suffit à dessiner nettement la ligne horizontale, alors détachée du nuage, et l'ingénieur put voir son image tremblotante se refléter un instant sur une surface liquide.
Cyrus Smith saisit la main du jeune garçon, et, d'une voix grave:
«Une île!» dit-il, au moment où le croissant lunaire s'éteignait dans les flots.
CHAPITRE XI
Une demi-heure plus tard, Cyrus Smith et Harbert étaient de retour au campement.L'ingénieur se bornait à dire à ses compagnons que la terre sur laquelle le hasard les avait jetés était une île, et que, le lendemain, on aviserait.Puis, chacun s'arrangea de son mieux pour dormir, et, dans ce trou de basalte, à une hauteur de deux mille cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer, par une nuit paisible, «les insulaires» goûtèrent un repos profond.
Le lendemain, 30 mars, après un déjeuner sommaire, dont le tragopan rôti fit tous les frais, l'ingénieur voulut remonter au sommet du volcan, afin d'observer avec attention l'île dans laquelle lui et les siens étaient emprisonnés pour la vie, peut-être, si cette île était située à une grande distance de toute terre, ou si elle ne se trouvait pas sur le chemin des navires qui visitent les archipels de l'océan Pacifique.Cette fois, ses compagnons le suivirent dans cette nouvelle exploration.Eux aussi, ils voulaient voir cette île à laquelle ils allaient demander de subvenir à tous leurs besoins.
Il devait être sept heures du matin environ, quand Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gédéon Spilett et Nab quittèrent le campement.Aucun ne paraissait inquiet de la situation qui lui était faite.Ils avaient foi en eux, sans doute, mais il faut observer que le point d'appui de cette foi n'était pas le même chez Cyrus Smith que chez ses compagnons.
L'ingénieur avait confiance, parce qu'il se sentait capable d'arracher à cette nature sauvage tout ce qui serait nécessaire à la vie de ses compagnons et à la sienne, et ceux-ci ne redoutaient rien, précisément parce que Cyrus Smith était avec eux.Cette nuance se comprendra.Pencroff surtout, depuis l'incident du feu rallumé, n'aurait pas désespéré un instant, quand bien même il se fût trouvé sur un roc nu, si l'ingénieur eût été avec lui sur ce roc.
«Bah!dit-il, nous sommes sortis de Richmond, sans la permission des autorités!Ce serait bien le diable si nous ne parvenions pas un jour ou l'autre à partir d'un lieu où personne ne nous retiendra certainement!»
Cyrus Smith suivit le même chemin que la veille.On contourna le cône par le plateau qui formait épaulement, jusqu'à la gueule de l'énorme crevasse.
Le temps était magnifique.Le soleil montait sur un ciel pur et couvrait de ses rayons tout le flanc oriental de la montagne.
Le cratère fut abordé.Il était bien tel que l'ingénieur l'avait reconnu dans l'ombre, c'est-à-dire un vaste entonnoir qui allait en s'évasant jusqu'à une hauteur de mille pieds au-dessus du plateau.Au bas de la crevasse, de larges et épaisses coulées de laves serpentaient sur les flancs du mont et jalonnaient ainsi la route des matières éruptives jusqu'aux vallées inférieures qui sillonnaient la portion septentrionale de l'île.
L'intérieur du cratère, dont l'inclinaison ne dépassait pas trente-cinq à quarante degrés, ne présentait ni difficultés ni obstacles à l'ascension.
On y remarquait les traces de laves très anciennes, qui probablement s'épanchaient par le sommet du cône, avant que cette crevasse latérale leur eût ouvert une voie nouvelle.
Quant à la cheminée volcanique qui établissait la communication entre les couches souterraines et le cratère, on ne pouvait en estimer la profondeur par le regard, car elle se perdait dans l'obscurité.Mais, quant à l'extinction complète du volcan, elle n'était pas douteuse.
Avant huit heures, Cyrus Smith et ses compagnons étaient réunis au sommet du cratère, sur une intumescence conique qui en boursouflait le bord septentrional.
«La mer!la mer partout!» s'écrièrent-ils, comme si leurs lèvres n'eussent pu retenir ce mot qui faisait d'eux des insulaires.
La mer, en effet, l'immense nappe d'eau circulaire autour d'eux!Peut-être, en remontant au sommet du cône, Cyrus Smith avait-il eu l'espoir de découvrir quelque côte, quelque île rapprochée, qu'il n'avait pu apercevoir la veille pendant l'obscurité.Mais rien n'apparut jusqu'aux limites de l'horizon, c'est-à-dire sur un rayon de plus de cinquante milles.Aucune terre en vue.Pas une voile.Toute cette immensité était déserte, et l'île occupait le centre d'une circonférence qui semblait être infinie.
L'ingénieur et ses compagnons, muets, immobiles, parcoururent du regard, pendant quelques minutes, tous les points de l'Océan.Cet Océan, leurs yeux le fouillèrent jusqu'à ses plus extrêmes limites.Mais Pencroff, qui possédait une si merveilleuse puissance de vision, ne vit rien, et certainement, si une terre se fût relevée à l'horizon, quand bien même elle n'eût apparu que sous l'apparence d'une insaisissable vapeur, le marin l'aurait indubitablement reconnue, car c'étaient deux véritables télescopes que la nature avait fixés sous son arcade sourcilière!De l'Océan, les regards se reportèrent sur l'île qu'ils dominaient tout entière, et la première question qui fut posée le fut par Gédéon Spilett, en ces termes: «Quelle peut être la grandeur de cette île?»
Véritablement, elle ne paraissait pas considérable au milieu de cet immense Océan.
Cyrus Smith réfléchit pendant quelques instants; il observa attentivement le périmètre de l'île, en tenant compte de la hauteur à laquelle il se trouvait placé; puis:
«Mes amis, dit-il, je ne crois pas me tromper en donnant au littoral de l'île un développement de plus de cent milles.
— Et conséquemment, sa superficie?...
— Il est difficile de l'apprécier, répondit l'ingénieur, car elle est trop capricieusement découpée.»
Si Cyrus Smith ne se trompait pas dans son évaluation, l'île avait, à peu de chose près, l'étendue de Malte ou Zante, dans la Méditerranée; mais elle était, à la fois, beaucoup plus irrégulière, et moins riche en caps, promontoires, pointes, baies, anses ou criques.Sa forme, véritablement étrange, surprenait le regard, et quand Gédéon Spilett, sur le conseil de l'ingénieur, en eut dessiné les contours, on trouva qu'elle ressemblait à quelque fantastique animal, une sorte de ptéropode monstrueux, qui eût été endormi à la surface du Pacifique.
Voici, en effet, la configuration exacte de cette île, qu'il importe de faire connaître, et dont la carte fut immédiatement dressée par le reporter avec une précision suffisante.
La portion est du littoral, c'est-à-dire celle sur laquelle les naufragés avaient atterri, s'échancrait largement et bordait une vaste baie terminée au sud-est par un cap aigu, qu'une pointe avait caché à Pencroff, lors de sa première exploration.Au nord-est, deux autres caps fermaient la baie, et entre eux se creusait un étroit golfe qui ressemblait à la mâchoire entr'ouverte de quelque formidable squale.
Du nord-est au nord-ouest, la côte s'arrondissait comme le crâne aplati d'un fauve, pour se relever en formant une sorte de gibbosité qui n'assignait pas un dessin très déterminé à cette partie de l'île, dont le centre était occupé par la montagne volcanique.De ce point, le littoral courait assez régulièrement nord et sud, creusé, aux deux tiers de son périmètre, par une étroite crique, à partir de laquelle il finissait en une longue queue, semblable à l'appendice caudal d'un gigantesque alligator.
Cette queue formait une véritable presqu'île qui s'allongeait de plus de trente milles en mer, à compter du cap sud-est de l'île, déjà mentionné, et elle s'arrondissait en décrivant une rade foraine, largement ouverte, que dessinait le littoral inférieur de cette terre si étrangement découpée.
Dans sa plus petite largeur, c'est-à-dire entre les Cheminées et la crique observée sur la côte occidentale qui lui correspondait en latitude, l'île mesurait dix milles seulement; mais sa plus grande longueur, de la mâchoire du nord-est à l'extrémité de la queue du sud-ouest, ne comptait pas moins de trente milles.
Quant à l'intérieur de l'île, son aspect général était celui-ci: très boisée dans toute sa portion méridionale depuis la montagne jusqu'au littoral, elle était aride et sablonneuse dans sa partie septentrionale.Entre le volcan et la côte est, Cyrus Smith et ses compagnons furent assez surpris de voir un lac, encadré dans sa bordure d'arbres verts, dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.Vu de cette hauteur, le lac semblait être au même niveau que la mer, mais, réflexion faite, l'ingénieur expliqua à ses compagnons que l'altitude de cette petite nappe d'eau devait être de trois cents pieds, car le plateau qui lui servait de bassin n'était que le prolongement de celui de la côte.
«C'est donc un lac d'eau douce?demanda Pencroff.
— Nécessairement, répondit l'ingénieur, car il doit être alimenté par les eaux qui s'écoulent de la montagne.
— J'aperçois une petite rivière qui s'y jette, dit Harbert, en montrant un étroit ruisseau, dont la source devait s'épancher dans les contreforts de l'ouest.
— En effet, répondit Cyrus Smith, et puisque ce ruisseau alimente le lac il est probable que du côté de la mer il existe un déversoir par lequel s'échappe le trop-plein des eaux.Nous verrons cela à notre retour.»
Ce petit cours d'eau, assez sinueux, et la rivière déjà reconnue, tel était le système hydrographique, du moins tel il se développait aux yeux des explorateurs.Cependant, il était possible que, sous ces masses d'arbres qui faisaient des deux tiers de l'île une forêt immense, d'autres rios s'écoulassent vers la mer.On devait même le supposer, tant cette région se montrait fertile et riche des plus magnifiques échantillons de la flore des zones tempérées.Quant à la partie septentrionale, nul indice d'eaux courantes; peut-être des eaux stagnantes dans la portion marécageuse du nord-est, mais voilà tout; en somme, des dunes, des sables, une aridité très prononcée qui contrastait vivement avec l'opulence du sol dans sa plus grande étendue.
Le volcan n'occupait pas la partie centrale de l'île.Il se dressait, au contraire, dans la région du nord-ouest, et semblait marquer la limite des deux zones.Au sud-ouest, au sud et au sud-est, les premiers étages des contreforts disparaissaient sous des masses de verdure.Au nord, au contraire, on pouvait suivre leurs ramifications, qui allaient mourir sur les plaines de sable.C'était aussi de ce côté qu'au temps des éruptions, les épanchements s'étaient frayés un passage, et une large chaussée de laves se prolongeait jusqu'à cette étroite mâchoire qui formait golfe au nord-est.
Cyrus Smith et les siens demeurèrent une heure ainsi au sommet de la montagne.L'île se développait sous leurs regards comme un plan en relief avec ses teintes diverses, vertes pour les forêts, jaunes pour les sables, bleues pour les eaux.Ils la saisissaient dans tout son ensemble, et ce sol caché sous l'immense verdure, le thalweg des vallées ombreuses, l'intérieur des gorges étroites, creusées au pied du volcan, échappaient seuls à leurs investigations.
Restait une question grave à résoudre, et qui devait singulièrement influer sur l'avenir des naufragés.
L'île était-elle habitée?
Ce fut le reporter qui posa cette question, à laquelle il semblait que l'on pût déjà répondre négativement, après le minutieux examen qui venait d'être fait des diverses régions de l'île.
Nulle part on n'apercevait l'œuvre de la main humaine.Pas une agglomération de cases, pas une cabane isolée, pas une pêcherie sur le littoral.Aucune fumée ne s'élevait dans l'air et ne trahissait la présence de l'homme.Il est vrai, une distance de trente milles environ séparait les observateurs des points extrêmes, c'est-à-dire de cette queue qui se projetait au sud-ouest, et il eût été difficile, même aux yeux de Pencroff, d'y découvrir une habitation.On ne pouvait, non plus, soulever ce rideau de verdure qui couvrait les trois quarts de l'île, et voir s'il abritait ou non quelque bourgade.
Mais, généralement, les insulaires, dans ces étroits espaces émergés des flots du Pacifique, habitent plutôt le littoral, et le littoral paraissait être absolument désert.
Jusqu'à plus complète exploration, on pouvait donc admettre que l'île était inhabitée.
Mais était-elle fréquentée, au moins temporairement, par les indigènes des îles voisines?À cette question, il était difficile de répondre.Aucune terre n'apparaissait dans un rayon d'environ cinquante milles.Mais cinquante milles peuvent être facilement franchis, soit par des praos malais, soit par de grandes pirogues polynésiennes.Tout dépendait donc de la situation de l'île, de son isolement sur le Pacifique, ou de sa proximité des archipels.
Cyrus Smith parviendrait-il sans instruments à relever plus tard sa position en latitude et en longitude?Ce serait difficile.Dans le doute, il était donc convenable de prendre certaines précautions contre une descente possible des indigènes voisins.
L'exploration de l'île était achevée, sa configuration déterminée, son relief coté, son étendue calculée, son hydrographie et son orographie reconnues.La disposition des forêts et des plaines avait été relevée d'une manière générale sur le plan du reporter.Il n'y avait plus qu'à redescendre les pentes de la montagne, et à explorer le sol au triple point de vue de ses ressources minérales, végétales et animales.
Mais, avant de donner à ses compagnons le signal du départ, Cyrus Smith leur dit de sa voix calme et grave:
«Voici, mes amis, l'étroit coin de terre sur lequel la main du Tout-Puissant nous a jetés.C'est ici que nous allons vivre, longtemps peut-être.Peut-être aussi, un secours inattendu nous arrivera-t-il, si quelque navire passe par hasard...Je dis par hasard, car cette île est peu importante; elle n'offre même pas un port qui puisse servir de relâche aux bâtiments, et il est à craindre qu'elle ne soit située en dehors des routes ordinairement suivies, c'est-à-dire trop au sud pour les navires qui fréquentent les archipels du Pacifique, trop au nord pour ceux qui se rendent à l'Australie en doublant le cap Horn.Je ne veux rien vous dissimuler de la situation...
— Et vous avez raison, mon cher Cyrus, répondit vivement le reporter.Vous avez affaire à des hommes.Ils ont confiance en vous, et vous pouvez compter sur eux.— N'est-ce pas, mes amis?
— Je vous obéirai en tout, monsieur Cyrus, dit Harbert, qui saisit la main de l'ingénieur.
— Mon maître, toujours et partout!s'écria Nab.
— Quant à moi, dit le marin, que je perde mon nom si je boude à la besogne, et si vous le voulez bien, monsieur Smith, nous ferons de cette île une petite Amérique!Nous y bâtirons des villes, nous y établirons des chemins de fer, nous y installerons des télégraphes, et un beau jour, quand elle sera bien transformée, bien aménagée, bien civilisée, nous irons l'offrir au gouvernement de l'Union!Seulement, je demande une chose.
— Laquelle?répondit le reporter.
— C'est de ne plus nous considérer comme des naufragés, mais bien comme des colons qui sont venus ici pour coloniser!»
Cyrus Smith ne put s'empêcher de sourire, et la motion du marin fut adoptée.Puis, il remercia ses compagnons, et ajouta qu'il comptait sur leur énergie et sur l'aide du ciel.
«Eh bien!en route pour les Cheminées!s'écria Pencroff.
— Un instant, mes amis, répondit l'ingénieur, il me paraît bon de donner un nom à cette île, ainsi qu'aux caps, aux promontoires, aux cours d'eau que nous avons sous les yeux.
— Très bon, dit le reporter.Cela simplifiera à l'avenir les instructions que nous pourrons avoir à donner ou à suivre.
— En effet, reprit le marin, c'est déjà quelque chose de pouvoir dire où l'on va et d'où l'on vient.Au moins, on a l'air d'être quelque part.
— Les Cheminées, par exemple, dit Harbert.
— Juste!répondit Pencroff.Ce nom-là, c'était déjà plus commode, et cela m'est venu tout seul.Garderons-nous à notre premier campement ce nom de Cheminées, monsieur Cyrus?
— Oui, Pencroff, puisque vous l'avez baptisé ainsi.
— Bon, quant aux autres, ce sera facile, reprit le marin, qui était en verve.Donnons-leur des noms comme faisaient les Robinsons dont Harbert m'a lu plus d'une fois l'histoire: «la baie Providence», la «pointe des Cachalots», le «cap de l'Espoir trompé»!...
— Ou plutôt les noms de M Smith, répondit Harbert, de M Spilett, de Nab!...
— Mon nom!s'écria Nab, en montrant ses dents étincelantes de blancheur.
— Pourquoi pas?répliqua Pencroff.Le «port Nab», cela ferait très bien!Et le «cap Gédéon...»
— Je préférerais des noms empruntés à notre pays, répondit le reporter, et qui nous rappelleraient l'Amérique.
— Oui, pour les principaux, dit alors Cyrus Smith, pour ceux des baies ou des mers, je l'admets volontiers.Que nous donnions à cette vaste baie de l'est le nom de baie de l'Union, par exemple, à cette large échancrure du sud, celui de baie Washington, au mont qui nous porte en ce moment, celui de mont Franklin, à ce lac qui s'étend sous nos regards, celui de lac Grant, rien de mieux, mes amis.Ces noms nous rappelleront notre pays et ceux des grands citoyens qui l'ont honoré; mais pour les rivières, les golfes, les caps, les promontoires, que nous apercevons du haut de cette montagne, choisissons des dénominations que rappellent plutôt leur configuration particulière.Elles se graveront mieux dans notre esprit, et seront en même temps plus pratiques.La forme de l'île est assez étrange pour que nous ne soyons pas embarrassés d'imaginer des noms qui fassent figure.Quant aux cours d'eau que nous ne connaissons pas, aux diverses parties de la forêt que nous explorerons plus tard, aux criques qui seront découvertes dans la suite, nous les baptiserons à mesure qu'ils se présenteront à nous.Qu'en pensez-vous, mes amis?»
La proposition de l'ingénieur fut unanimement admise par ses compagnons.L'île était là sous leurs yeux comme une carte déployée, et il n'y avait qu'un nom à mettre à tous ses angles rentrants ou sortants, comme à tous ses reliefs.Gédéon Spilett les inscrirait à mesure, et la nomenclature géographique de l'île serait définitivement adoptée.
Tout d'abord, on nomma baie de l'Union, baie Washington et mont Franklin, les deux baies et la montagne, ainsi que l'avait fait l'ingénieur.
«Maintenant, dit le reporter, à cette presqu'île qui se projette au sud-ouest de l'île, je proposerai de donner le nom de presqu'île Serpentine, et celui de promontoire du Reptile (Reptile-end) à la queue recourbée qui la termine, car c'est véritablement une queue de reptile.
— Adopté, dit l'ingénieur.
— À présent, dit Harbert, cette autre extrémité de l'île, ce golfe qui ressemble si singulièrement à une mâchoire ouverte, appelons-le golfe du Requin (Shark-gulf).
— Bien trouvé!s'écria Pencroff, et nous compléterons l'image en nommant cap Mandibule (Mandible-cape) les deux parties de la mâchoire.
— Mais il y a deux caps, fit observer le reporter.
— Eh bien!répondit Pencroff, nous aurons le cap Mandibule-Nord et le cap Mandibule-Sud.
— Ils sont inscrits, répondit Gédéon Spilett.
— Reste à nommer la pointe à l'extrémité sud-est de l'île, dit Pencroff.
— C'est-à-dire l'extrémité de la baie de l'Union?répondit Harbert.
— Cap de la Griffe (Claw-cape)», s'écria aussitôt Nab, qui voulait aussi, lui, être parrain d'un morceau quelconque de son domaine.
Et, en vérité, Nab avait trouvé une dénomination excellente, car ce cap représentait bien la puissante griffe de l'animal fantastique que figurait cette île si singulièrement dessinée.
Pencroff était enchanté de la tournure que prenaient les choses, et les imaginations, un peu surexcitées, eurent bientôt donné:
À la rivière qui fournissait l'eau potable aux colons, et près de laquelle le ballon les avait jetés, le nom de la Mercy, — un véritable remerciement à la Providence; à l'îlot sur lequel les naufragés avaient pris pied tout d'abord, le nom de l'îlot du Salut (Safety-island); au plateau qui couronnait la haute muraille de granit, au-dessus des Cheminées, et d'où le regard pouvait embrasser toute la vaste baie, le nom de plateau de Grande-vue; enfin à tout ce massif d'impénétrables bois qui couvraient la presqu'île Serpentine, le nom de forêts du Far-West.
La nomenclature des parties visibles et connues de l'île était ainsi terminée, et, plus tard, on la compléterait au fur et à mesure des nouvelles découvertes.
Quant à l'orientation de l'île, l'ingénieur l'avait déterminée approximativement par la hauteur et la position du soleil, ce qui mettait à l'est la baie de l'Union et tout le plateau de Grande-vue.Mais le lendemain, en prenant l'heure exacte du lever et du coucher du soleil, et en relevant sa position au demi-temps écoulé entre ce lever et ce coucher, il comptait fixer exactement le nord de l'île, car, par suite de sa situation dans l'hémisphère austral, le soleil, au moment précis de sa culmination, passait au nord, et non pas au midi, comme, en son mouvement apparent, il semble le faire pour les lieux situés dans l'hémisphère boréal.
Tout était donc terminé, et les colons n'avaient plus qu'à redescendre le mont Franklin pour revenir aux Cheminées, lorsque Pencroff de s'écrier:
«Eh bien!nous sommes de fameux étourdis!